(Sources principales : GIPPM-1, GIPPM-2, LPA, SADP, SSÉPO, SAHC, IPHAF).
(paragraphe en chantier)
Pour les mots latins, les tableaux ci-dessous montrent
l'évolution du nombre de syllabes jusqu'aux langues romanes actuelles.
On constate que le roumain et surtout l'italien ont une forte
tendance à conserver le nombre de syllabes, avec conservation de
nombreux
Cette considération permet, je pense, de dégager pour le roumain et l'italien une notion de conservatisme, peut-être de "caractère savant". À l'opposé, le français montre un caractère très "populaire" de l'évolution du latin. Le caractère populaire des syncopes était déjà bien présent dans l'Antiquité (Prob, témoignage calidus...). Les apocopes ont dû commencer plus tardivement, en s'inscrivant sans doute au départ dans un phénomène d'alternance (du même type que l'espagnol grande / gran, bueno / buen).
L'occitan occupe une place intermédiaire. Concernant les
Dissyllabes latins
| aboutissement des |
||||||
|
latin
|
roumain
|
italien
|
espagnol
|
catalan
|
occitan
|
français
|
| mūrŭ(m) |
aroum mur A | muro | muro | mur
[ |
mur
[ |
mur A |
| bŏnŭ(m) |
bun A | buono/buon A | bueno/buen A | bon A | bòn A | bon A |
| bŏnă(m) |
bună | buona | buena | bona |
bòna |
bonne |
| pŏntĕ(m) |
punte | ponte | puente | pont A | pònt A | pont A |
Tableau ci-dessus : aboutissement de quelques mots latins de deux
syllabes (
Paroxytons trissyllabes latins
| aboutissement des |
||||||
|
latin
|
roumain
|
italien
|
espagnol
|
catalan
|
occitan
|
français
|
| argĕntŭ(m) |
argint A | argento |
- |
argent A | argènt A | argent A |
| sēcūrŭm(m) |
sigur A | sicuro |
seguro |
segur A | segur A | seür > sûr A ds |
| cătēnă(m) |
ist.r. cadine |
catena |
cadena |
cadena |
cadena |
chaîne ds |
Tableau ci-dessus : aboutissement de quelques
Paroxytons latins de plus de trois syllabes
| aboutissement
des |
||||||
|
latin
|
roumain
|
italien
|
espagnol
|
catalan
|
occitan
|
français
|
| sānĭtātĕ(m) |
sănătate |
a.it. sanitate it.m. sanità A |
gal. saidade |
a.cat. sentat
S A |
santat,
sandat S A |
santé
S A |
| cīvĭtātĕ(m) |
citat
S A |
a.it. cittate,
-de S it.m. città S A |
ciudad
S A |
ciutat
S A |
ciutat
S A |
cité
S A |
| dŏrmītōrĭŭ(m) |
dormitor A | - |
dormidor A | - |
dormidor A | dortoir S A |
| habēbātis |
aveați
/ave̯ats/ |
avevate |
habíais ds | havíeu ds | aviatz A ds | aviez A ds |
| armātūră(m) |
armătură |
armatura |
armadura |
armadura |
armadura |
armeüre > armure ds |
Tableau ci-dessus : aboutissement de quelques
Un autre processus peut contracter les mots : la disparition d'une
consonne intervocalique, suivie d'une
Proparoxytons latins
| aboutissement des |
||||||
|
latin
|
roumain
|
italien
|
espagnol
|
catalan
|
occitan
|
français
|
| ŏcŭlŭ(m) |
ochiu S |
occhio
S |
ojo
S |
ull
S A |
uelh
S A |
œil
S A |
| vĭrĭdĕ(m) |
verde S |
verde
S |
verde
S |
verd
S A |
verd
S A |
vert
S A |
| lăcrĭmă(m) |
lacrămă |
lacrima |
lágrima |
llàgrima |
lagrema
B |
larme
S |
| mastĭcăt |
mestecă |
mastica |
masca
S |
mastega
B |
mastega
B |
mâche
S |
| sēmĭnăt |
seamănă |
semina |
sembra
S |
sembra
S |
samena
B |
sème
S |
| lĭttĕră(m) |
litera |
lettera |
letra
S |
lletra
S |
letra
S |
lettre
S |
| lĕpŏrĕ(m) |
iepure |
lepre
S |
liebre
S |
llebre
S |
lèbre
S |
lièvre
S |
| ăsĭnŭ(m) |
asin A | asino |
asno
S |
ase
A |
ase
A |
âne
S |
| jŭvĕnĕ(m) |
june S |
giovane |
joven
A |
jove
A |
jove
A/joine S |
jeune
S |
| crēscĕrĕ |
crește A |
crescere |
crecer
A |
créixer
A |
crèisser
A |
croître
S |
| hŏspĭtĕ(m) |
oaspete |
ospite |
huesped
A |
oste
S |
òste
S |
hôte
S |
Tableau ci-dessus : aboutissement de quelques proparoxytons dans diverses langues romanes. On voit que le roumain et l'italien ont fortement tendance à conserver le nombre de syllabes, alors que le français raccourcit tous les mots latins par des syncopes (S). (Pour ŏcŭlŭs et vĭrĭdĭs, la syncope est panromane : elle devait déjà exister en latin parlé commun). L'occitan occupe une position "intermédiaire", avec très souvent un raccourcissement des mots par syncope, ou par apocope (A), ou bien une conservation du nombre de syllabes par un processus original de basculement de l'accent (B).
Idée générale : par pur
Mais les mots à trois syllabes ne sont pas rares : certaines voyelles
Pour Avēniōnem > Avinhon, Jules Ronjat estime que la voyelle prétonique s'est maintenue par l'influence du CS *Avinh < Avēniō (GIPPM-1:365).
Voir CDVSF pour l'ancien français : "une voyelle en
syllabe fermée ne tombe jamais" ; je pense que cette règle s'applique
aussi à l'occitan. Philippe Ségéral établit des règles concernant le
maintien ou la syncope des syllabes prétoniques (PH-2020:280). Pour les verbes, je me permets de
remarquer (
(PFÉH:40 :
Exemples :
aestĭmārĕ > AO ȩsmar,
"aimer" (
artĕmīsĭă(m) / artĕmēsĭă(m) > artemisa, lim armisa, dial.oïl armise / (*armeise >) armoise (FEW 25:363b-364a voit dans artemisa une forme demi-savante)
dormĭtōrĭŭm > dormidor, "dortoir"
jānŭārĭŭm > AO genovier > AO gervier "janvier"
monasterĭŭm > Monastier, Mostier
Monasteriolum > Montreuil (93) (Monterel 1203, Monstrueil 1360).
Réduction plus poussée du nombre de syllabes en français par rapport à l'occitan :
- Pour l'occitan, certaines consonnes ne sont pas
sēcūrŭm > oc segur
/ a.fr. seür
> "sûr"
- Pour les verbes latins de quatre syllabes ou plus (adjūtārĕ "aider", mastĭcārĕ "mâcher"), il existe souvent deux variantes en occitan (ci-dessus) : la variante non syncopée (ajudar) et la variante syncopée (aidar), alors qu'en français, seule la variante syncopée existe ("aider").
- Pour les séquences R-Ly, R-Ny, en toponymie, tendance à une syncope plus fréquence en français : Aurēlĭācŭm > Aurillac / Orly.
(DENLF:368) nom d'homme Jovenius, Juvenius > Joviniacum, Juveniacum > Joigny (89), Jeugny (10), Jagny (78), Juignac (16), Juigné (49 2 communes, 44, 72, 10 (1)). À l'opposé, on a une syllabe de plus dans Juvignac en domaine d'oc (34), mais aussi en domaine d'oïl avec Juvigné (53) et les nombreux Juvigny. La présence de ny a sans doute eu tendance à bloquer la syncope car en prétonique, dans cīvĭtātĕm, on n'a que des aboutissements syncopés : "cité", ciutat (v préconsonantique).
(1) Pour Juigné et peut-être Joigny, Juignac, ign = gn (à l'origine, le i n'est sans doute pas prononcé).
intāmĭnārĕ > entamer (
contāmĭnārĕ > contaminer (
*allūmĭnārĕ > allumer ("emprunt au latin populaire" ? : CNRTL), ancien occitan : alumenar, alumnar.
Remarque : voici l'étude de quelques cas où deux syllabes prétoniques semblent en syllabe ouverte, et ne présentent pas de syncope :
- calamèu, "chalumeau" (< calamellum), je pense que l'influence savante a pu jouer car calamus était un roseau à écrire ;
- canabas, canabassier, canabiera... chenevis, chanevis < *canapūtium, canevas (picard) (mais l'étymon peut avoir 2 n : canapis ou cannapis ;
- (Luberon, mais étymon trop incertain : Λουεριώνοϛ Louerion de Strabon Géogr. IV, 6, 3 très critiqué)
Dans ce chapitre, j'entends par "apocopes"
les deux phénomènes suivants :
- la disparition des voyelles finales -u, -e, -o, -i, par exemple :
mūrŭ(m) > mur, mūrōs > murs
Cette disparition date approximativement des VIIe et VIIIe siècles.
- la
disparition des syllabes finales des
ăsĭnŭ(m) > ase "âne"
C'est ce que j'appelle l'apocope de type occitan (ci-dessous). Elle doit se comprendre comme un prolongement de l'apocope précédente :
ăsĭnŭ(m) > *aseno > asen > ase "âne"
La dernière étape, la perte de la consonne
devenue finale (-n), se termine
au cours du XIe siècle (pour asen).
En dehors de ce grand changement, il y a eu d'autres types d'apocopes, sans doute à des époques très variables. Ci-dessous je mentionne des apocopes anciennes, d'époque latine :
Les
La particule
enclitique
Certaines formes à l'impératif ont été apocopées : addīcĕ > addīc, ēdūcĕ > ēdūc. Selon ÉGCOL:300, l'accent tonique s'est conservé sur la deuxième syllabe, alors que la règle 2 voudrait que l'accent se porte sur la première syllabe.
La particule
enclitique -nē "est-ce
que ?" peut être soudée à la fin d'un mot. Celui-ci peut alors subir l'
ĕgōnē > egōn "est-ce que c'est moi ?"
vĭdĕsnē > vĭden "est-ce que tu vois ?"
Selon ÉGCOL:300, l'accent tonique s'est conservé sur la deuxième syllabe, alors que la règle 2 voudrait que l'accent se porte sur la première syllabe.
Loi
universelle de simplification de la langue
C'est une loi universelle que les langues évoluent vers une
simplification, simplification qui est limitée par la contrainte de
compréhension par l'interlocuteur. La disparition de la fin d'un mot
peut ainsi s'expliquer dans le cadre de la simplification de la langue,
de la volonté d'augmenter le débit des paroles (référence ?). La
disparition de voyelles internes peut aussi s'expliquer de cette manière
(syncopes ci-dessous).
Limites à la simplification de la
langue
Outre la contrainte de la compréhension par l'interlocuteur, pour les
langues romanes, la
Dans les déclinaisons, un compromis a été trouvé pour certaines formes
où le s final se conserve mais
la voyelle précédente se perd (formes
déclinées ci-dessous), par exemple : dūrŭs
> AO
(CSS) durs
"dur". Puis le
Par ailleurs, selon l'environnement du mot dans la phrase, l'apocope
peut se réaliser ou non. Pour l'italien et l'espagnol actuels, qui sont
les langues romanes les moins affectées par l'apocope, on observe quand
même des alternances de phonétique
Scénario pour l'occitan (à préciser)
Jules Ronjat pense ainsi que dans un état très ancien, l'occitan a dû connaître des alternances du type italien ou espagnol ci-dessus : mare / mar, uno / un... (voir GIPPM-1:222). L'une ou l'autre forme alternante ancienne a dû être retenue dans la langue actuelle. Dans son œuvre, il envisage parfois le rôle du -s du pluriel, mais on peut lui reprocher d'omettre généralement la distinction CS / CR qui était de règle en AO, notamment avec le -s du CSS.
Il reste sans doute à réaliser une grande analyse systématique de tous
ces facteurs sur l'évolution de la
(GIPPM-1:219)
(GIPPM-1:205, 219).
Dans l'étude historique du français, le terme d'
Cette
Les apocopes se sont peut-être produites dans ces langues vers la même
période, vers les VIIe et VIIIe siècles.
Sous quelle forme se trouvaient -u, -e, -o, -i au moment de leur disparition ?
(à l'étude) Par exemple, -ŭ a évolué en -o
vers la fin du Ve siècle.
À mieux étudier.
Je donne ici en vrac les mots à étudier :
gradum > AO variante graze
*melicem > melese, melze "mélèze"
rumicem > romese
juvenem > joine, fr. jeune...
Je donne deux exemples que j'ai relevés :
nŭcĕ(m)
> nose / notz "noix"
ădjăcĕntĕm
> *ădjăcĕ(m) > aise /
aitz "aise"
À première vue, dans les variantes oc nose, aise, on pourrait voir une survivance de -ĕ latin. Mais il peut s'agir aussi d'un e épenthique, qui serait apparu après apocope dans une étape de -c- à -z- (voir palatalisations de ce, ci).
En occitan, -a,
Il est mieux conservé en occitan qu'en français.
Voir aussi influence de a sur les syncopes
ci-dessous.
Voici un tableau de mots témoins montrant l'
|
latin
|
italien
|
espagnol
|
français
|
occitan
|
catalan
|
romanche
|
frioulan
|
|
ŭ
|
|||||||
| mūrŭ(m) | muro |
muro |
mur |
mur |
mur |
mir |
mûr |
| ŏc(ŭ)lŭ(m) | occhio |
ojo |
œil |
uelh |
ull |
ögl |
voli |
| dūrŭ(m) | duro |
duro |
dur |
dur |
dur |
dir |
dûr |
|
ĕ,
ē
|
|||||||
| mărĕ | mare |
mar |
mer |
mar |
mar |
mar |
mâr |
| pŏntĕ(m) | ponte |
puente |
pont |
pònt |
pont |
punt |
puint |
| mĕdĭĕtātĕ(m) | metà |
mitad |
moitié (1) |
mitat |
meitat |
mesadad |
metât |
| tardē | tardi |
tarde |
tard |
tard |
tard |
tard |
tart |
| căntārĕ | cantare |
cantar |
chanter |
cantar |
cantar |
cantar |
cjantâ |
|
ō
|
|||||||
| căntō "je chante" |
canto |
canto |
a.fr. chant |
AO cant a canto |
AC cant |
a.r. ? |
a.fri. ? |
|
ī
|
|||||||
| n. mūrī "les murs" |
muri |
a.esp. ? |
a.fr. CSP mur |
AO CSP mur |
AC CSP mur |
a.r. ? |
a.fri. ? |
|
après muta
cum liquida
|
|||||||
|
fĕbrĕ(m)
|
febbre
|
fiebre
|
fièvre
|
fèbre
|
febre
|
fiera
|
fiere
|
Ci-dessus : devenir des voyelles finales latines -u, -e, -o, -i pour quelques mots en italien, espagnol, français, occitan, catalan et dans les langues rhéto-romanes (romanche et frioulan).
(Pour le romanche : pledari.ch, dialecte sursilvan ; pour le frioulan : claap.org)
Le -m caractéristique de l'
On voit que l'
(1) Pour mĕdĭĕtātĕm : voir évolution de mĕdĭĕtātĕm en français.
Ci-dessus, les mots pŏntĕ(m),
ŏcŭlŭ(m), dūrŭ(m) portent la
Quand la voyelle finale est suivie d'une consonne, sa chute en français est datée du courant du VIIe siècle (IPHAF:196).
Quand la voyelle est en finale absolue (souvent à cause de la perte du -m final à la prononciation), sa chute en français est datée du VIIIe siècle (IPHAF:197).
(AO) CSS |
(AO) CSP |
pluriel actuel |
|
|
|
|
|
|
| pŏns
> AO pons (1) |
pŏntĕ(m) > pòn(t) (2) |
pŏntēs > pŏntī > AO pon(t) (3) | pŏntēs > pòn(t)s |
| ŏcŭlŭs > AO uelhs | ŏc(ŭ)lŭ(m)
>
uelh |
ŏcŭlī > AO uelh | ŏc(ŭ)lōs > uelhs |
|
dūrŭs
> AO durs
|
dūrŭ(m)
> dur
|
dūrī > AO dur
|
dūrōs
> durs
|
Tableau : "Apocope" des voyelles finales latines -u, -o, -e, -i du latin à l'occitan : ces voyelles sont représentées en rouge, elles disparaissent lors du passage du latin à l'ancien occitan. L'occitan actuel est hérité des deux premières colonnes, où l'on voit notamment l'origine du -s du pluriel. Les deux dernières colonnes donnent les cas de l'AO qui ont disparu sans laisser de descendance.
Français :
(a.fr.) CSS |
(a.fr.) CSP |
pluriel actuel |
|
|
|
|
|
|
| pōns > a.fr. pons | pŏntĕ(m) > "pont" | pŏntēs > *pŏntī > a.fr. pont |
pŏntēs > "ponts" |
| ŏcŭlŭs > a.fr. ialz | ŏc(ŭ)lŭ(m) > "œil" | ŏcŭlī > a.fr. ueil | ŏc(ŭ)lōs > "yeux" |
|
dūrŭs
> a.fr. durs
|
dūrŭ(m)
> "dur"
|
dūrī > a.fr. dur
|
dūrōs > "durs"
|
Tableau : "Apocope" des voyelles finales latines -u, -o, -e, -i du latin au français : ces voyelles sont représentées en rouge, elles disparaissent lors du passage du latin à l'ancien français. Le français actuel ne se trouve que dans les deux colonnes à en-têtes bleus. Les deux autres colonnes donnent les cas de l'a.fr. qui ont disparu sans laisser de descendance.
La même chute de la voyelle finale est observable pour certaines formes conjuguées au présent (3e.p.s. : IPHAF:196, SADP:148)
Voir aussi Indicatif présent (évolution de la 1e conjugaison).
Le tableau ci-dessous montre les faits suivants.
1. Le -o
latin est conservé en italien, langue sans apocope, alors qu'il
disparaît en OA et en
a.fr.. Rapidement
apparaissent des formes avec une "voyelle de soutien" : -e,
-i dès l' OA
(mais pas en a.fr.
?).
Remarque : (GIPPM-3:153-154) : le -o
latin est conservé jusqu'en OM
dans de nombreuses régions alpines jusqu'à Forcalquier,
Saint-Étienne-les-Orgues, et aussi en Ardèche : Tournon, Saint-Agrève,
Annonay).
2. Pour l'occitan, si la
consonne devenue finale était
|
latin
|
italien
|
AO
|
a.fr.
|
| căntō | canto |
cant (cante, -i) GAP | (je) chant "je chante" |
| cōgnōscō | conosco | con |
? "je connais" |
| crēscō | cresco | cr |
(je) crois (de croître) |
| dŏrmĭō > *dŏrmō | dormo | d |
(je) dorm "je dors" |
| dīcō | dico | dic, di MEAO | (je) dic "je dis" |
| plăcĕō | piaccio | ? |
(je)
plaz /plats/, plais
"je plais" |
| pĕrdō | perdo | p |
(je) pert "je perds" |
| *prĕcō | prego | pr |
(je) pri / proi... "(je) prie" |
| vĭncō | vinco | v |
(je) veinc "je vaincs" |
| l.v.
|
voglio | vuolh MEAO | (je)
vueil "je veux" |
Tableau : évolution de la voyelle latine -ō (en rouge) de la première personne du singulier à l'indicatif présent : conservation en italien, chute en ancien occitan et en ancien français. Pour l'évolution de la consonne devenue finale, voir ci-dessous. Les formes actuelles canti, "je chante"... sont des réfections.
Voir cantăt, cantănt... à "p,
t, k, s, f".
(GIPPM-1:267-268) (r.g.f.d.e.a.) "Nos parlers n'admettent pas en fin
de syllabe un
(SSMML:271) "En gallo-roman, les voyelles latines
finales autres que a n'ont survécu, sous la forme d'un
(1) (T =
Remarque personnelle : Il convient
de nuancer cette généralisation : un
Dans certaines régions de la
Par exemple :
nĭgrŭ(m) > negr > negre /
g neguer
Voir aussi ci-dessous.
À continuer.
(loi des
Selon Yves-Charles Morin en franco-provençal, -o
est conservé après muta cum liquida.
Par exemple : quădrŭm > caro
/karo/, pătrĕm
> pare /paré/.
(SADP:142, 151).
Cette partie est essentiellement le fruit de réflexions personnelles : il faudrait chercher davantage de sources. Je pense que ce domaine est nettement sous-étudié. Jules Ronjat étudie bien le devenir de consonnes devenues finales, mais son étude est incomplète. Voir cependant pour d latin : GIPPM-2:95-98.
Pour le français, Tobias Scheer traite le problème (PH-2020:421-425). La situation est bien différente de l'occitan.
Suite à la chute de la voyelle finale, si la consonne devenue finale
était
Pour l'occitan :
GIPPM-2:2 : "[...] ; quant aux consonnes devenues
finales en roman, un fait général est que, les
Pour le français :
PH-2020:421 : "Comme de nombreuses langues
(allemand, turc, russe, etc. Iverson et Salmons 2011), l'AF pratique le dévoisement en finale des
obstruantes voisées, et ce synchroniquement : masc. AF froit, fém.
Remarque : le durcissement de la consonne finale se produit aussi dans
d'autres cas, comme la
On peut distinguer trois situations (la quatrième situation ne montre pas un durcissement) :
1. Si en latin, la consonne
était intervocalique
prātŭ(m) > (sonor.)*/praːdó/ > */prad/ > AO prat /prat/ "pré"
2. Si en latin, la consonne
était
sanguĭnĕ(m) > */sangé/ > */sang/ > AO sanc /sank/ "sang"
3. Si en latin, la consonne
était intervocalique
pĕdĕ(m) /pé
nōdŭm
/nóːðʋ/ > */nó
4. Pour la quatrième situation
(en latin, la consonne était
pŏntĕm
> pònt "pont" (voir
pon
/ pont)
præstō > prest
"prêt"
arcŭ(m)
> arc "arc"
*brŭncŭm
> AO
brọnc "saillie"
cīnquĕ
> cinc "cinq"
cŏgnōscō
> *cŏnōscō
> AO con
germ
bank > banc "banc"
a.b.fr. *frank
> franc "franc"
germ
*blank > blanc "blanc"
Le phénomène de durcissement de la consonne devenue finale concerne au
moins l'occitan, le franco-provençal, le catalan, le français (pour les
langues rhéto-romanes : romanche, frioulan, ladin : à vérifier).
Pour l'occitan, même si les
consonnes finales sont en général amuïes en Basse-Provence, les
consonnes finales durcies sont encore prononcées dans d'autres
dialectes. En français comme pour le provençal, quand ces consonnes
durcies n'ont plus été prononcées, la graphie les a souvent oubliées et
dans certains cas on est revenu à une graphie latinisante (grand,
sang... aux dépens de grant,
sanc). Voir les problèmes
d'orthographes (ci-dessous).
Pour le français, on peut citer comme exemples de consonnes finales durcies :
- "clef" (jadis le -f était prononcé) ;
- "neuf" ;
- "dix" ;
- "vert" < */vérdé/
< vĭrĭdĕm (jadis le -t de "vert" était prononcé).
Encore pour le français, les attestations anciennes sont nombreuses, avec parfois des traces dans la prononciation française d'aujourd'hui :
- a.fr. lonc "long" (-k était maintenu encore récemment en liaison : "long hiver" /lõk ̮ivèːr/)
-
a.fr. sanc
"sang" (-k est parfois maintenu
en liaison : "sang impur" /sãk ̮è̃puːr/) ;
- a.fr. grant "grand" (-t est maintenu en liaison : "grand homme" /grãt ̮òm/) ;
- a.fr. mont "monde" ;
- a.fr. corp "corbeau" (< corbus) ;
...
Voir aussi l'ancien fr-pr
Bourc (-k
maintenu en liaison dans "Bourg-en-Bresse").
Phonétiquement, ce durcissement s'explique par une "interruption anticipée de la vibration des cordes vocales en fin d'énoncé" (Wikipédia : dévoisement final).
On peut penser que la prononciation dans les
départements 59, 57, 54,
88, et de la Wallonie montrent
un tel type de durcissement après la chute "récente" des voyelles
finales atones : voir ALF "auge" [ó
Position préconsonantique :
Je pense que l'arrivée en position préconsonantique a pu jouer un rôle.
L'arrivée en position préconsonantique se produit :
- devant le -s
- devant un mot commençant par une consonne
;
- dans des syncopes (voir jovene > juefne).
Dans ces cas, il y a concurrence entre durcissement de la consonne et
sa vocalisation
souvent observée en occitan (exemple : ci-dessous clāvĭs > claus "clé"). Le
résultat dépend probablement des contacts consonantiques ; aspect à
étudier.
Cependant, dans les mots nécessairement suivis
d'autres mots, le durcissement de la consonne ne semble pas se réaliser.
Par exemple pour ăpŭd
> AO
ab "avec",
la forme ab est restée
ultra-dominante jusqu'au XIIIe siècle. La forme ap,
avec b durci en p,
est connue dans deux seules occurrences (DOM) :
ap petdres
"avec des pierres" PassClerm ; ap
que fos vertadiers "même si c'était vrai" AmSesc. La consonne -p
est suivie, dans ces deux cas, de consonnes
Le schéma général est (exemple) :
prātŭ(m) > (sonor.)*/praːdó/ > */prad/ > AO prat /prat/ "pré"
Une longue série de mots latins dont la dernière syllabe commençait par
une consonne
Cette partie est rédigée à partir d'une réflexion personnelle (juillet 2019).
- Comment ont été construits les dérivés de lop "loup" (lobet "petit loup"), de fuòc "feu" (fogau "foyer"), de pauc "peu" (pauquet "petit peu")... ?
- Peut-on dater leur formation ?
Les dérivés ont presque systématiquement la consonne radicale finale
sous sa forme
p : lŭpŭm, lŭpăm > lop,
loba → lobet, lobat,
lobaton, lobiera, lobatiera... ;
t : prātŭm > prat → pradet, pradàs, pradau, pradèl, pradier... ;
c : fŏcŭm > fòc, fuòc → afogar, fogairon, fogau, foganha, fogatge, foguẹnc, foguiẹnc... ;
- Donc les dérivés n'ont pas été construits par suffixation sur la
consonne durcie (après apocope)
de lop, prat, f(i)òc... Sinon
on aurait obtenu
- On peut en déduire que les dérivés
ont été forgés avant le durcissement de la consonne devenue finale,
c'est-à-dire avant les apocopes (avant les VIIe ,
VIIIe siècles). Ou du moins, un certain nombre d'entre eux
datent de cette époque, suffisamment pour qu'ils aient induit des
analogies sur les autres dérivés, ou bien ils ont pu eux-mêmes être
dérivés plus tard (lobat → lobatiera).
Par exemple si on envisage une création dérivationnelle aux Ve,
VIe, début VIIe
- Voir aussi trauchar
"trouer" (ci-dessous) dont l'
- Il est possible que certains dérivés aient été forgés dans une époque
encore plus ancienne, avant les
sonorisations (avant l'an 400) : *lopettu,
*focale. Ces dérivés déjà constitués auraient
donc subi eux-même les sonorisations.
- On peut même envisager la formation de ces dérivés avant
la mutation vocalique : *lŭpĭttŭ(m),
*fŏcālĕ(m), mais une étude au cas par cas s'impose. Et il faut
déjouer les pièges des formes qui ont été latinisées à partir de formes
vulgaires (à supposer qu'on trouve une forme écrite vers l'an 800 *lŭpĭttŭm, "petit loup", cela ne
signifie pas forcément que*lŭpĭttŭm
a existé en l'an 300, les clercs ayant pour habitude de latiniser des
mots vulgaires dans des actes latins).
Dans la partie "Sonorisations", je montre la
diphtongue latine au empêche
la sonorisation de se réaliser au niveau de la consonne
Voir notamment : Étude
des dérivés (pauc / pauquet ; fuòc /
fogau).
Plusieurs familles de mots dérivent de mots latins avec au
traucŭm > trauc → AO trauquet, traucar, traucable, traucador, trauquilhar trauquilós...
aussi n.oc.m.
trauchar (TDF, FEW 13/2:230b),
trauchilhar FEW 13/2:231a)
Il ne faut pas en déduire que trauquet,
traucar... sont construits sur trauc
: par comparaison avec le cas général ci-dessus (lobet,
fogau...), on peut estimer qu'ils sont pour une bonne part
hérités de formes plus anciennes que la forme trauc
: *trauquetto, *traucare
(avant le VIIe siècle). Ces formes pourraient être issues
dans cette hypothèse de *trauco
"trou", avec un /k/ qui a échappé aux sonorisations.
On peut remonter plus loin : les formes n.oc.m. trauchar
"trouer", enrauchar "enrouer",
montrent la quatrième palatalisation (ka > cha pour k
en
Il est possible que leurs
Exemple :
lŭpŭm > (sonor.) */lóːbó/ > */lób/ > AO lop /lóp/ "loup"
Pour le fr "loup", -p représente une graphie
étymologisante (CNRTL
"loup", voir ci-dessous lŭpŭs),
alors que pour oc lop,
-p provient de l'évolution
Par contre si la consonne est suivie de -a, il n'y aura pas apocope et elle n'a aucune raison de redevenir sourde (loba "louve").
Pour les dérivés : lobet "louveteau", lobatiera "tanière de loup"..., voir ci-dessus étude des dérivés.
|
LPC
|
|
LPT1
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -p- |
> |
-b- |
> |
-b |
> |
-p |
| *cannăpĕm |
AO canep "chanvre" | |||||
| căpŭt
> *căpŭm |
*/kabʋ/ > */kabó/ |
*/kab/ |
cap "tête, chef..." | |||
| lŭpŭ(m) |
*/lóbʋ/ > */lóbó/ |
*/lób/ |
l |
|||
| nāpŭ(m) | */nabʋ/ > */nabó/ | */nab/ |
AO nap "navet" | |||
| ŏpŭ(m) | */òbʋ/ > */òbó/ | */òb/ |
AO |
|||
| prŏpĕ |
*/pròbé/ |
*/pròb/ |
AO pr |
|||
| trŏpō | */tròbó/ |
*/truòb/, */truèb/ | AO
truop, truep (1) "(je) trouve" |
|||
| sæpĕ(m) |
*/séː
bé/ |
*/séb/ |
AO s "haie", voir sebissa |
|||
| săpĭt |
*/sabé/ |
*/sab/ |
AO
sap > saup "(il) sait" |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de p devenu final. En bleu : formes verbales (ci-dessus).
(1) Pour truop, truep (GAP:268), voir diphtongaison
romane de ò (normalement
très limitée en occitan).
Exemple :
prātŭ(m) > (sonor.) */praːdó/ > */prad/ > AO prat /prat/ "pré"
Par contre si la consonne est suivie de -a, il n'y aura pas apocope et elle n'a aucune raison de redevenir sourde (-atam > -ada "-ée").
Pour les
dérivés : pradet, pradàs..., voir ci-dessus l'étude
des dérivés.
Voir aussi prononciation de sud [sut].
Exemples :
|
LPC
|
|
LPC, LPT1
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -t- |
> |
-d- |
> |
-d |
> |
-t |
| abbātĕ(m) |
*/abbadé/ |
*/abad/ |
abat
"abbé" |
|||
| -ātŭ(m) (cantātŭm) |
*/-aːdʋ/
> */-adó/ |
*/-ad/ |
-at "-é" (cantat "chanté") |
|||
| -ātĕ(m) (cīvītātĕm) |
*/-aːdé/ |
*/-ad/ |
-at "-é" (ciutat "cité") |
|||
| blĭtŭ(m) |
*/blédʋ/ > */blédó/ |
*/bléd/ |
blet
"betterave" |
|||
| mūtĕ(m) |
*/mʋːdé/ |
*/mud/ |
AO
mut (1) "(que je) change" |
|||
| mūtŭ(m) |
*/mʋːdʋ/
> */mʋdó/ |
*/mud/ |
mut
"muet" |
|||
| prātŭ(m) |
*/praːdʋ/
> */pradó/ |
*/prad/ |
prat
"pré" |
|||
| après diphtongue au | ||||||
| cautŭ(m) |
*/kawtʋ/ > */kawtó/ |
*/kawt/ |
AO caut
"prudent" |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de t devenu final. En bleu : formes verbales.
(1) Au subjonctif : PBremRNov Tu van canson demandan IV, 50 : "Car mos fins cors, ce no·s muda / me dis c’ieu no·m mut" "car mon cœur parfait, qui ne change pas, me dit de ne pas changer"
Il n'est question ici que de c
qui a échappé aux troisièmes
palatalisations, donc situé devant -o,
-u. (S'il est devant -a,
il ne parviendra pas en position finale).
Exemple :
ămīcŭ(m) > (sonor.) */amiːgó/ > */amig/ > AO amic /amik/ "ami"
Par contre si la consonne est suivie de -a, il n'y aura pas apocope et elle n'a aucune raison de redevenir sourde (ămīcăm > amiga "amie").
Pour les dérivés : fŏcŭs "feu" → afogar "mettre le feu", fogairon "petit foyer", fogau "foyer", foganha "cuisine"... voir ci-dessus l'étude des dérivés.
Cas de -auc-
: l'étude
de -auc- montre que la
sonorisation de c n'a sans
doute jamais eu lieu en domaine d'oc (aucăm
> auca "oie").
Dérivés dans le cas de -auc-
: *traucŭm "trou" → traucar,
trauquilhar... Voir ci-dessus l'étude
des dérivés de au + consonne
sourde.
Exemples :
|
LPC
|
|
LPC, LPT
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -c-
(+ o,u) (intervocalique) |
> |
-g- |
> |
-g |
> |
-c |
| ămīcŭ(m) |
*amigu > *amigo |
*/amig/ |
amic
"ami" |
|||
| dīcō |
digo |
*/dig/ |
AO dic "(je) dis" |
|||
| *festūcŭ(m) |
*festūgu
> *festugo |
*/festug/ |
AO festuc "fétu" | |||
| fŏcŭ(m) |
*fuògu > *fuògo |
*/fʋòg/ |
fuòc
"feu" |
|||
| après
diphtongue au |
||||||
| -auc-
(+ o,u) |
> |
-auc- |
> |
-c |
> |
-c |
| *traucŭ(m) |
*traucu > *trauco |
*/trawk/ |
trauc
"trou" |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de k intervocalique devenu final. En bleu : formes verbales (ci-dessus).
Exemple :
nāsŭ(m) > (sonor.) */naːzó/ > */naz/ > AO nas /nas/ "nez"
À continuer.
Exemples :
|
LPC
|
|
LPC, LPT
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -s- |
> |
-z- |
> |
-z |
> |
-s |
| nāsŭ(m) |
*/naːzʋ/
>
*/nazó/ |
*/naz/ |
nas
"nez" |
|||
| -d- / |
> |
-/ |
> |
-/ |
> |
-s |
| nūdŭm |
*/nʋː |
*/nʋz/ |
nus
"nu" |
|||
| vĭdĕt |
*/vé |
*/véz/ |
ves (HLPA:73) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de s et d intervocaliques devenus finaux. En bleu : formes verbales (ci-dessus).
Je ne connais pas de cas d'apocope menant au résultat d'un f
en position finale, voir évolution
de f intervocalique.
Voir voyelle
+ tĭ, tĕ + voyelle et voyelle
+ c + e / i.
Aboutissement -tz
:
|
LPC
|
|
LPC, LPT
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -k-
(+ e, i) > - -t(ĕ, ĭ) |
> |
- |
> |
-dz |
> |
-tz
/ts/> -/s/ |
| dĕcĕ(m) |
*/dè |
*/dèdz/ |
dètz
"dix" |
|||
| dīcĭt |
*/diː |
*/didz/ |
AO ditz, dis "(je) dis" |
|||
| pălātĭŭ(m) |
AO
palatz, palaitz "palais" |
|||||
| plăcĕt |
*/pla |
*/pladz/ |
AO
platz, plas "(il) plaît" |
|||
| prĕtĭŭm |
pretz
"prix" |
|||||
| pŭtĕŭ(m) |
*/pó |
*/pódz/ |
potz
"puits" |
|||
| spătĭŭ(m) |
AO espatz "espace" | |||||
| Ūcĕtĭŭm |
Usètz,
Usès "Uzès" |
|||||
| vĭtĭŭ(m) |
AO v |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de
Les consonnes
De même pour les groupes
Pour consonne + v latin, il
s'agit quasiment
toujours de r ou l + v.
Par ailleurs, deux faits caractérisent l'évolution de v latin :
- v
latin peut s'amuïr
au contact de ŭ subséquent
(servŭs > serŭs "esclave") ;
- pour v
latin après l et r,
on assiste fréquemment à une évolution latine de type cŏrvŭs > cŏrbŭs.
Ainsi il existe une double alternance :
- v / ∅ après consonne et devant ŭ > -f / -∅ ;
- v / b après l, r > -f / -p.
Cela mène aux trois variantes en couleur
dans le tableau ci-dessous (-p, -f / -v,
-∅) avec en plus la voie savante
Il faut bien constater que -f est
peu attesté en AO (tableau ci-dessous), on trouve souvent
Exemples (voir tous les exemples à évolution latine de type cŏrvŭs > cŏrbŭs) :
|
LPC
|
|
AO, occitan
|
| -Cv- /Cw/ |
> |
-Cp -Cv [f?], -Cf -C |
| sălvŭ(m) |
(adj.)
AO
salp, saub,
salv,
salf, sal,
fr "sauf" |
|
| cĕrvŭ(m) |
AO
c |
|
| -Cb- |
> |
-Cp |
| cŏrbĕ(m) | AO c |
|
| lŭmbŭ(m) | AO l |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de "consonne + v, b devenu finaux".
Pour consonne + v :
En bleu : /w/ > /p/ en position finale ;
En vert : /w/ > /f/ en position finale ;
En mauve : aboutissements par amuïssement de v au contact de o, u ;
En rouge : /w/ > /v/ par la voie savante (mots en -i, -ia).
(1) Pour lŭmbŭm > AO l
Voir aussi prononciation
de nòrd [nòrt].
Exemples :
|
LPC
|
|
PO
|
|
AO
|
| -Cd- |
> |
-Cd | > |
-Ct |
| călĭdŭm > căldŭ(m) |
*/kald/, */kaʋ̯d/ | AO caut
"chaud" |
||
| grandĕ(m) |
*/grand/ |
AO grant
/ gran "grand" (1) |
||
| lār(ĭ)dŭ(m) |
*/lard/ |
AO lart
"lard" |
||
| pĕrdĭt | */pèrd/ |
AO p |
||
| tĕndĭt | */tènd/ |
AO t |
||
| vĭr(ĭ)dĕ(m) |
*/verd/ |
AO vert
"vert" |
||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de "consonne + d devenu final". En bleu : formes verbales.
(1) Pour grandĕm > AO grant / gran, voir ci-dessus alternance de type pon / pont.
Après consonne, le g s'était maintenu, aboutissant à -c, qui n'est plus prononcé actuellement dans notre région :
lŏngŭ(m) > AO lonc "long"
sanguine(m)
>
*sangue(m) > AO sanc
-ing (suffixe d'origine germanique) > -enc (arlatenc, avinhonenc...)
tengō
lat.pop. > AO
tenc "je tiens" (GAP:348) ;
plangō
> planc / planh (GAP:339) ; dans les verbes en -gĕre
> -nher, il y a souvent nivellement en -nh
: frangŏ > franh, (GAP:334) ungŏ
> onh, (GAP:338), pungŏ
> ponh (GAP:341)
burgu(m)
> AO borc
"bourg"
largu(m) > AO larc "large"
Exemples :
|
LPC
|
|
LPC, LPT
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -Cg- |
> |
-Cg- | > |
-Cg- | > |
-Ck |
|
|
-ing(o) | -ing |
-enc | |||
|
bŭrgŭ(m) |
*burgu > *burgo |
*burg |
AO b |
|||
| gŭrgĕ(m) > *gŭrgŭ | *gorgu > *górgo |
*górg |
AO g |
|||
| largŭ(m) | largu > largo |
*larg | AO larc "large" | |||
|
lŏngŭ(m) |
*longu > *longo |
*long |
> AO lonc "long" | |||
| plangō |
plango |
*plang | AO planc "(je) plains" | |||
|
sanguinĕ(m) > *sanguĕ(m) |
*sangue |
*sang | AO sanc "sang" | |||
|
lat.pop.
tengō |
*tengo |
*teng |
AO tenc "je tiens" (GAP:348) | |||
| *vĕngō | vengo | */vèng/ | AO venc "(je) viens" | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de "consonne + g devenu final". En bleu : formes verbales.
En occitan, la pratique de l'écrit s'est progressivement perdue
(surtout au XVe siècle), puis de nombreux mots (sanc,
borc, gorc, aglant...) ont perdu la prononciation de cette
consonne finale. Mais celle-ci se prononce encore dans certaines régions
(-c final, -t
final...).
Au XIXe siècle, lorsque les philologues occitans ont réétabli des normes écrites, souvent comme ces consonnes finales ne se prononçaient plus, il n'a sans doute pas été question d'écrire sanc, gorc, aglant. Mais sous l'influence du latin, ou bien du français (lui-même influencé par le latin), on a écrit sang, gorg, agland. Cette attitude n'a pas forcément été consciente ; les graphies mistralienne comme occitane ont donc réadopté la consonne latine.
Je cite PCLO:77,78 à propos des consonnes occlusives :
(j.m.c.g.) "En
occitan, cap de mot ["la fin d'un mot"]
s’acaba pas foneticament per una consonanta obstruenta (oclusiva o
fricativa) sonòra. Pasmens la grafia nòta tot còp en fin de mot de
letras que nòtan normalament aquelas obstruentas sonòras (b, d, g, z).
Segon lo cas o lo dialècte, aquelas letras son prononciadas sordas ([p],
[t], [k] o [t
Cette façon d'écrire est sans doute raisonnable, mais il ne faut pas oublier :
- qu'elle court-circuite une partie de l'histoire de l'occitan ;
- qu'elle est en porte-à-faux au regard des régions où
l'on prononce encore la consonne finale.
Certains cas (comme grand
ci-dessous) sont complexes.
- Globalement, pour les mots latins en -ndŭm,
-ndĕm, avec l'amuïssement de la consonne -t
(< -d) de l'AO, la conservation de -t
à l'écrit a paru incongruë en occitan moderne, tout comme en français.
Une graphie latinisante avec -nd a alors souvent été adoptée (en
français : "grand", "gland"). Dans oc
monde, les anciennes variantes
m
- Pour les adjectifs notamment, comme ci-dessus, l'ancienne alternance
gran / grant s'efface
tardivement au moment de l'amuïssement de la consonne finale, mais l'influence du féminin (granda)
favorise le choix de l'orthographe grand
(en plus de l'influence du latin). Cependant grant
[grãnt] est conservé dans certaines vallées alpines (voir ALF carte 663 : stfi05).
- Pour aglan "gland" (< glans, glandĭs), l'AO présente bien l'alternance CRS aglan / aglant, et l'a.fr. présente bien le seul aboutissement glant. Le choix du français actuel est de faire réapparaître le -d latin à l'écrit. Le DBFP donne aglan, le DOGMO donne aglan, agland. Mais agland a une orthographe influencée par le latin ou le français, et ne correspond à aucune prononciation connue en domaine d'oc (ALF carte 648, TDF). Par contre le mot est prononcé avec le -t dans les vallées occitanes d'Italie (ALF carte 648), et il est conforme à l'histoire de l'occitan.
En position intervocalique, les consonnes
Ces deux consonnes latines b
et v se rejoignent en /v/ au
cours du Ier siècle (voir b, waw).
Lorsque
ce /v/ devient final au VIIe-VIIIe siècle, en
occitan, contrairement au français, il ne subit pas un durcissement,
mais une vocalisation : vocalisation
de
-v, exemple : nŏvŭm
> oc.
nòu, fr. neuf.
(Voir à ce dernier lien la liste des mots concernés). Voir waw
: v final.
Pour expliquer cette
différence entre français et occitan, voir mon hypothèse à : cause
de la vocalisation de v / b
en occitan.
|
LPC
|
|
LPC
|
|
PO
|
|
AO, occitan
|
| -v- / |
> |
/ |
> |
-v |
> |
-u
(vocalisation) |
| -b- / |
> |
> |
> |
|||
| clăvĕ(m) | */klav/ |
clau
"clef" |
||||
| vīvĭ(t) |
*/viv/ |
viu "(il) vit" |
||||
| trăbĕ(m) |
*/trav/ |
trau
"poutre" |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : aboutissement de b, v devenus finaux. En bleu : formes verbales.
Les cas où g latin intervocalique est parvenu en finale sont très rares, puisque la règle générale est l'amuïssement de g devant e, i, o, u. Cependant dans de rares cas (notamment en gascon), le g s'est maintenu, aboutissant à -c :
fāgŭ(m) → g hac "hêtre"
Ugo > AO Uc "Hugues"
Traditionnellement, on considérait que d s'est spirantisé tardivement,
mais dans le site je considère plutôt que d
intervocalique était prononcé /
Le d latin parvenu en
position finale donne des aboutissements
variables, par exemple pour nōdŭm
"nœud" : nos, no, nòi, not, nots,
noc.... (ci-dessous).
Pour d : /d/ > /
Par contre si la consonne est suivie de -a,
il n'y a pas d'apocope et elle n'a aucune raison de subir le
durcissement (nuda, nusa
"nue"). Pour les dérivés, mêmes processus que ci-dessus,
pour arriver à : AO nud
Les mots latins pĕdĕm, fĭdĕm,
ont abouti à pe,
fe "pied, foi" dans tout le domaine d'oc, sauf niç fet
"foi" (GIPPM-2:95). Ci-dessous je donne quelques
variantes qui ont cependant été recensées.
pĕdĕm
"pied"
Pour "pied", voir carte 1012 de l'ALF. On ne trouve en effet que pè
pour tout le domaine d'oc. En AO également, seul p
Les mots français "piéton", "piétiner", "empiéter"... ne proviennent
pas d'un renforcement d'un
Concernant les dérivés occitans, on a : AO pezada
(> piada) "empreinte de pas", pezana
"piétin", pezelhar, pezilhar
"gond" (aussi, sans rapport étymologique : pēdŭcŭlŭm
> AO
pez
fĭdĕm "foi"
Les aboutissements de fĭdĕm
sont fe
/fé/, mais aussi fet
/fét/ (niç, DNF), et en AO sont attestés f
Le latin
laudĕ(m) "louange"
Les aboutissements sont AO lau, laus, laut "los, louange".
vĭdĕt "il voit"
vĭdĕt > */vé
- grădŭm "marche, degré"
Les aboutissements de grădŭm
sont (AO)
gra, gran, gras,
grat, graze "degré ; chenal". Aujourd'hui, on connaît (pr) gras,
(l)
grau
depuis Aigues-Mortes jusqu'en Catalogne (GIPPM-2:108).
-
vădŭm "gué, bas-fond"
Les aboutissements de vădŭm sont gas /gas/, /ga/, güas /gwa/ (art64 "lavoir" carte0755 ALF, voir GIPPM-2:96).
Les aboutissements de nōdŭm
sont (carte0915 ALF) pour résumer :
nos
/n
no
/n
nòi (bord) ;
not
/n
nu, nut (béar, la variante nu a une graphie étymologisante dans TDF : nud) ;
nots (notamment dans l'est des Landes, dans l'Ariège et l'Aude) ;
noc
/n
(d'autres thèmes que nos
sont utilisés : les dérivés nosèl,
nosèt de l'Aude au Lot-et-Garonne ; grop
sur le faîte des Alpes).
- nūdŭm,
nūdăm "nu, nue"
- crūdŭm,
crūdăm "cru, crue"
À continuer.
À continuer.
-/dj/- > -/t
Voir aussi la graphie catalane
gaudĭŭm > gaug "joie"
exagĭŭm > assag "essai"
mĕdĭŭm > mieg "demi"
pŏdĭŭm > pueg "puy, colline"
stŭdĭŭm > estug "étui"
Mais :
rŭbĕŭm > roge
*săbĭŭm > sage
sīmĭŭm > singe
(influence du féminin ?)
(tertĭŭm > tèrtz)
On observe en AO une alternance après -n, de type CRS pon / pont pour un groupe de mots, dont voici quelques exemples :
CRS fon / font < fŏntĕm ;
adj.n.i. cen / cent < cĕntŭm ;
CRS (a)glan / (a)glant < glandĕm ;
CRS gran / grant < grandĕm ;
CRP loms / lomps / lombes "reins" < lŭmbōs ;
CRS mercadan / mercadant < *mercātantĕm ;
CRS m
CRS m
CRS pon / pont < pŏntĕm ;
CRS pre
(remarque : pour
les problèmes de fermeture éventuelle de ĕ,
ŏ devant n
Cette alternance apparaît également en ancien français (a.fr. pon / pont "pont", den / dent "dent", mon / mont "monde", parfon / parfont "profond", cen / cent "cent").
Parmi ces mots, certains proviennent de mots
dĕns, dĕntĭs "dent" ;
fŏns,
fŏntĭs "source" ;
frŏns, frŏntĭs "front" ;
gens,
gentĭs "race" ;
glans, glandĭs "gland" ;
pŏns, pŏntĭs "pont" ;
mens,
mentĭs "esprit" ;
mŏns,
mŏntĭs "montagne" ;
etc.
D'autres proviennent de mots
mŭndŭs, mŭndī "monde" ;
grandĭs, grandĭs "grand" ;
prŏfŭndŭs, prŏfŭndī "profond" ;
etc.
Il est probable que l'alternance CRS pon / pont devait suivre une certaine répartition géographique. Seule une étude approfondie des textes AO pourrait préciser cette idée. Donc, à étudier. On peut
Les
Leur évolution linéaire à partir du latin mène à : CSS pons, CRS pont. Voir ci-dessus tableau des formes déclinées.
Mais leur évolution influencée par le schéma général AO CSS murs, CRS mur "mur" mène à : CSS pons, CRS pon. On a donc deux CRS possibles : pont et pon. Je pense que c'est là l'origine de l'alternance de type pont / pon.
CSS pons, CRS pont / pon "pont".
Par l'influence du CRS pont,
on pourrait envisager un autre CSS
Ainsi, l'alternance système de déclinaison du Moyen Âge.
Les
Leur évolution linéaire à partir du latin aurait mené à : CSS
Mais la forme CSS
CSS
m
La troisième variante pour le CRS (m
En OA, les
aboutissements de l'ancien
Cas de -nt :
Il y a souvent conservation des CRS et CRP de l'AO mais l'ancienne alternance pon
/ pont s'efface tardivement au moment de l'amuïssement
de
la consonne finale dans la plupart des régions, et l'on a
choisi d'écrire : s pònt, pl pònts (influence du latin et
peut-être de l'orthographe française). Le -t
final encore prononcé dans certaines régions (carte) témoigne d'un CRS pont
(ou bien d'une réfection plus tardive).
Voir ci-dessus consonnes explosives sonores.
(à continuer)
Voir n intervocalique devenu final.
Voir ci-dessous.
Une syncope est une contraction de syllabe à l'intérieur d'un mot, par disparition de la voyelle. (Voir "transformations phonétiques" : syncope).
Remarque sur les prétoniques
Généralement, en occitan, les
En français, on n'a que "sentier", "santé" : la disparition des prétoniques précède plus nettement les sonorisations (IPHAF:109).
sēmĭtārĭŭm
> (AO)
sendier / sentier "sentier",
sānĭtātĕm > (AO) sandat / santat "santé".
Voir aussi donzèla, Vinzèla, Colonzèlas / doncèla, Vincelles, La Colancelle...
Le processus de la
Au cours de l'évolution du latin vers les langues romanes, la loi de la conservation de l'accent (chapitre sur les voyelles) s'exerce, avec ses exceptions (perturbations de l'évolution de l'accent) : cela mène au fait que les voyelles accentuées ne disparaissent pas. Les autres voyelles (atones) peuvent disparaître ; cela dépend du contexte.
Concernant le français :
(PH-2020:204) « En somme, donc, toutes les
voyelles subissent la syncope sauf si elles sont 1° entravées ou 2°
toniques ou 3° initiales. Dit autrement, la syncope concerne les
voyelles en syllabe ouverte qui sont 1°
Voyelle prétonique initiale
(GIPPM-1:285)
Des syncopes n'ont pas cessé de se produire depuis le début de
l'histoire du latin, ou des langues en général. Elles sont provoquées
par la volonté d'accélérer le débit parlé (loi
de simplification, apocopes ci-dessus), et en latin s'exercèrent
peut-être aussi des lois
de limitation rythmiques.
Voir syncopes très anciennes.
On peut distinguer deux ensembles, qui doivent forcément se recouper
très largement :
- les syncopes d'époque républicaine (avant -27 avant J.-C.), attestées dans les textes, les commentaires des romains ;
- des syncopes représentées dans toutes les langues romanes (ou presque
toutes), donc communes à presque tout l'Empire Romain (voir protoroman).
(TMPE:xxi)
dans
-cŭlŭm
> -clŭm :
pĕrīcŭlŭm
> pĕrīclŭm ;
sæcŭlŭm
> saeclŭm ;
vĕhĭcŭlŭm
> vĕhĭclŭm ;
vĭncŭlŭm > vĭnclŭm ;
-mĭnŭs
> -mnŭs :
dŏmĭnŭs "maître"
> dŏmnŭs (voir aussi
ci-dessous dŏmnŭs comme étymon
panroman) ;
lāmĭnă "lame" > lāmnă (aussi Horace, Odes, II, 2) ;
tĕgŭmĕn,
tĕgĭmĕn "ce
qui recouvre" > tĕgmĕn ;
călĭdŭs
"chaud" > căldŭs ;
sŏlĭdŭs
"solide" > sŏldŭs,
vălĭdē
"fort, beaucoup" > văldē ;
(aussi : positŭs > postŭs ;
pŏpŭlŭs > pŏplŭs ;
mănĭpŭlārēs
"simple soldat" > mănŭplārēs
(aussi : mănĭplārĭs Ovide)
dextĕră > dextră ;
altĕrŭm > altrŭm.
(SADP:114),
dans Horace (Satires
2, 6, 64) :
lārĭdŭm
"lard" > lārdŭm
Dans Caton l'Ancien :
vĭrĭdĭs "vert" > vĭrdĭs.
Je rappelle que ces syncopes
(SAHC). Les syncopes
a. C1 liquide, glide ou /s/ suivi de C2 moins sonore.
vĭrĭdem > verde, vèrd
merŭlam > merlo, mèrle
eremŭm > ermo, èrme
solidŭm > soldo, sòu
polypŭm > polpo, polpe
colaphŭm > colpo, còp
vogido / vogida > vuoto / vuota ; vuech / vueja
digitŭm > dito, det
frigidŭm > freddo, freg (mais esp. frio < /friido/ : amuïssement
de g, SADP:126 note 15)
positŭm > posto, pòste
b. C1 /k/ suivi de C2 latérale
ocŭlum > occhio, uelh
specŭlum > specchio, espelh
pericŭlum > perilh, (mais italien
pericolo)
-culum : auricŭla > orecchia, aurelha
+ autres formes blâmées par Prob : angŭlus > anglus (mais italien angolo),
tribŭla > tribla, capitŭlum > capitlu, bapŭlo > baplo, mascŭlus
> masclus (mais italien mascolo). Il faut probablement voir Prob comme faisant partie d'une œuvre de
restauration du "bon parler", qui a en partie réussi.
c. Mélanges
dŏmĭnŭm
> dŏmnŭm (mais dŏmĭnĭcŭs, accentué différemment, a
bien été conservé pour donner le nom de personne Domèrgue...
et aussi dans dĭēs dŏmĭnĭcŭm >
dimenge "dimanche)". Voir aussi ci-dessus dŏmnŭs dans Plaute.
dicere > dire, dire
nitidŭm > netto
putidŭm > put "puant" (puzzo < *putium) mais aussi formes non syncopées (??)
putidam > puta, pute.
(à faire)
Syncopes [consonne-voyelle-CE]
En occitan, le groupe latin [consonne-voyelle-CE]
évolue généralement en [consonne-ZE],
rarement en [consonne-CE] : AO
ẹuse, sauze, sauzeda ; Vinzèla...
L'évolution ce > ze
témoigne d'une sonorisation
(troisième
palatalisation), donc la sonorisation s'est réalisée avant la
syncope. Il faut noter que derrière une consonne non vocalisée (n),
l'emploi de z est obligatoire
en occitan pour transcire /z/ : Vinzèla,
donzèla. De même en français : "donzelle".
Mais en français, d'après les mots présentés ci-dessous,
[consonne-voyelle-CE] évolue
généralement en [consonne-CE].
À l'exception de "demoiselle" (et "donzelle" si ce n'est pas un emprunt
à l'occitan), les mots sont de type [consonne-CE]
: "saussaie" (a.fr. sauçoie, sauçaye), Vincelles...
Donc il y a eu d'abord syncope, ensuite sonorisation.
Cŏlōnĭcĕllăs > Colonzèlas ou Coronzèlas (26) "Colonzelle"
Pour Colonzèlas (26), la
*dŏm(ĭ)nĭcĕllăm > AO donzèla / doncèla "demoiselle"
ēlĭcĕm > euse ;
sălĭcĕm > sause ;
*sălĭcētăm > AO sauzeda, fr "saussaie".
*Vīnĭcĕllăm > Vinzèla. (Voir TGF1:396 pour l'ordre sonorisation-syncope).
Syncopes [consonne-voyelle-dūnŭm]
gaul Eburodūnŭm "forteresse de l'if (ou d'un personnage appelé Eburo, l'if ?)" (LNL;12, 14) :
- > Embrun
Voir aussi résistance du -a ci-dessus.
Le a
Exemples ( GIPPM-1:233) :
lapsănă(m) > lassena
lampădă(m) > lampesa
alors que limpida > linda
[mais influence du masculin limpidus
?]
orgănă (plur. neutre) > orguena.
(SAHC:7) (trad.angl.) "De toute évidence, la voyelle interne post-tonique dérivée de -Ă- est perdue dans certains exemples et est conservée dans d'autres, sans qu'on puisse parler de loi et d'exceptions. Il est plus approprié de parler d'une tendance, sujette à variation au sein même du catalan, ou dans la diffusion lexicale. Il est intéressant de noter que la syncope de -Ă- est régulière en français ; elle est plus largement attestée en occitan qu'en catalan (par exemple, occitan canbe, carbe < CANNABE ; catalan cànem 'chanvre'), et elle est absente de l'espagnol. Il est naturel que /a/, la voyelle la plus sonore, devrait avoir tendance à être conservée alors que des voyelles moins sonores sont perdues."
(remarque : en occitan, on a aussi cannapem > canebe, en espagnol : cannabe > cañamo "chanvre")
Le a
(IPHAF:320) : "voyelles intertoniques" : résistance du a :
mirabilia > meravilha ;
calamellu > calamèu ;
monasteriu > monastier..<
Verbes :
sēpărārĕ / sēpărăt > sebrar / sebra, français : "sevrer" / "sèvre" : le ă a complètement disparu.
ĭntāmĭnăt / intāmĭnārĕ >
De nombreux linguistes (ex. : PH:37) ont estimé que -a a accéléré la
syncope de la
(À faire : une sorte de nivellement à dû se réaliser au cours du temps, avec un choix sur la forme accusative, ou beaucoup plus rarement nominative... ex : maire/major).
-aire / -ador
Pour les infinitifs latins à quatre syllabes ou plus, les aboutissements présentent souvent deux variantes (qui dépendent des régions) : la variante non syncopée et la variante syncopée (adjūtārĕ > oc ajudar / aidar). La variante non syncopée semble plus typiquement occitane (type ajudar) ; la variante non syncopée (type aidar) est souvent plus réduite géographiquement et peut témoigner, dans certains cas, d'une francisation parfois très ancienne (à étudier).
Cette évolution décrite ci-dessus semble vraie quelle que soit la longueur de la voyelle prétonique : longue (type adjūtārĕ ci-dessous), ou brève (type *trĕmŭlārĕ ci-dessous). Cela s'explique par les interactions (analogies) des différentes formes conjuguées et infinitives entre elles.
Dans l'infinitif latin, un nombre de syllabes supérieur ou égal à
quatre peut entraîner une syncope de la prétonique, comme en français :
adj(ū)tārĕ > aidar "aider". Mais l'effet analogique des formes
- variante syncopée : type aidar
(-djd- > -id-). C'est la forme obtenue par influence des
formes
adjūtārĕ > oc aidar "aider", adjūtāmus > oc aidam "nous aidons" => oc aida "il aide"
- variante non syncopée : type ajudar. C'est la forme
obtenue par influence des formes
adjūtăt > oc ajuda "il aide" => oc ajudar "aider", ajudam "nous aidons"
Voir les interactions :
- entre ē tonique et ē prétonique ;
- entre ī tonique et ī prétonique ;
- entre ū tonique et ū prétonique.
Pour les infinitifs à quatre syllabes ou plus, avec une voyelle prétonique brève (ŭ dans trĕmŭlārĕ), à nouveau, on obtient souvent deux variantes régionales. Il est remarquable que dans ce type, aucune forme latine ne porte l'accent sur la prétonique brève de l'infinitif. Mais cette voyelle brève (soit ĭ, soit ŭ, voir aphonies) est "sauvée" en occitan, dans les formes non syncopées par le basculement d'accent (mastĭcăt > mastega, d'où mastegar).
Voir le type mastega ci-dessous : on obtient souvent deux variantes (non syncopée et syncopée).
Par exemple :
- variante syncopée : type tremblar. C'est la forme qui respecte l'accent tonique : *trĕmŭlārĕ> tremblar "trembler" ; *trĕmŭlăt > trèmbla "il tremble".
- variante non syncopée : type tremolar. C'est la forme qui respecte les syllabes, aux dépens de l'accent tonique : *trĕmŭlăt > (évolution avec basculement d'accent) tremola "il tremble", influence sur l'infinitif => tremolar "trembler".
(GIPPM-1.227-271)
Certains des phénomènes traités ici sont mal connus, et leur étude est délicate. Quelques articles récents en traitent, mais ils proposent des théories parfois contradictoires (SADP, SAHC pour le catalan, SSÉPO).
En occitan comme en français, il n'existe aujourd'hui plus de
En catalan, il existe encore quelques centaines de
L'évolution en gallo-roman est peut-être due à l'influence des francs.
L'occitan et le français sont donc semblables sur l'accent des mots, en
dehors du basculement d'accent
pour l'occitan décrit ci-dessous.
Le français est devenu récemment
oxytonique :
Récemment, le français est devenu une langue
(GAP:41, PHR:13)
(Pour le moment, je ne sais pas trop où placer cette partie. Je la place ici provisoirement.)
En gallo-roman, de nouveaux infinitifs
Aussi : *sŭbmŏnērĕ
> *sŭbmŏnĕrĕ (> somọndre "semondre
(inviter)").
Remarque : le type *plăcĕre est remis en cause, voir l'étymologie de oc plaire.
Autre exemple :
mŭlgērĕ "traire" a dû être aligné sur
les
La disparition des
L'idée majeure est que certains
syncope en français : ăsĭnŭ(m) > asne > âne (disparition de sĭ) ;
apocope en occitan : ăsĭnŭ(m) > asen > ase (disparition de nŭ) ;
syncope en français : crēscĕrĕ > croître (disparition du ĕ central, voir évolution de ske) ;
apopope en occitan : crēscĕrĕ > crèisser
(disparition du ĕ final).
Ce phénomène affecte l'occitan, mais aussi le
Pour certains proparoxytons, on constate que l'accent
tonique a basculé de l'
Par exemple pour le type pibola "peuplier" :
ăsĭnă(m) > asena "ânesse", alors que ăsĭnŭ(m) > ase "âne" ;
pĭpŭlă(m) > pibola "peuplier", alors que pĭpŭlŭm > pibol "peuplier" ;
tĕpĭdă(m) > AO tebéza "tiède (fém)", alors que tĕpĭdŭm > tébe "tiède (masc)" ;
lacrĭmă(m) > lagrema "larme".
Pour le type mastega "il mâche", il s'agit sans doute d'un processus identique :
mastĭcăt > mastega "(il) mâche" ;
*trĕmŭlăt > tremola "il tremble".
Jules Ronjat traite le problème, mais il ne considère pas d'unité dans ces formes. Par exemple pour le type tĕpĭdăm, il s'agirait de "mots de deuxième couche", c'est-à-dire entrés tardivement dans la langue populaire de Gaule (GIPPM-1:252). Je ne pense pas qu'il s'agisse de "mots de deuxième couche", mais plutôt de mots ayant suivi une évolution typiquement occitane.
Voici mon explication (à continuer) :
(1) L'apocope ne peut pas se réaliser
car le féminin ne peut pas perdre le
(2) La syncope ne peut pas se réaliser en raison de contacts consonantiques incongrus dans les paramètres linguistiques de l'époque. En français, où la syncope est généralisée, la syncope s'est produite.
En raison de ces deux contraintes, et en raison de la disparition
des
Mon explication souffre certains
contre-exemples :
- ci-dessus *pīpŭlăm > pibola aurait pu aboutir à pibla (variante d'ailleurs attestée en pr.ma. et lim. Le contact b-l n'est pas forcément incongru (muta cum liquida), et pourtant la syncope n'a pas eu lieu dans pibola "peuplier" ; cette particularité font dire à certains que le mot a subi une influence savante, mais ce n'est pas mon opinion (voir ci-dessous nívol, pibola) ;
- certains masculins ont subi le même type
d'évolution : cannapem
> canebe
"chanvre" (voir proposition d'explication GIPPM-1:236), persĭcŭm > persegue
"pêche (fruit)".
Remarque : traiter les dérivés (asenon "ânon", gramenet
"petit chiendent", grameniera...)
Gĕnăvă > fr.pr. Genèva > Genève (a.fr. Genvre)
fabrĭcă(m)
>
Le même basculement d'accent existe en franco-provençal et en dialecte
bourguignon. Cela a été largement
ignoré des linguistes, au point de prendre "Genève" pour une
forme française, alors qu'elle est franco-provençale. La forme française
est a.fr. Genvre,
Genvres (voir ci-dessous Gĕnăvă).
Cette méprise a conduit DFL, pourtant excellente référence, à donner la
forme latine erronée Gĕnāvă,
alors qu'il s'agit de Gĕnăvă
: on a affaire à un
(DSPO:4, LGM132).
Par exemple pour le type pibola "peuplier" :
ăsĭnă(m) > asena "ânesse", alors que ăsĭnŭ(m) > ase "âne" ;
pătĭnăm > (l) (g) padena "poêle" ;
pendŭlă(m) "pendante" > pendola "râtelier suspendu... ; escarpolette" (probablement existait-il aussi un verbe latin *pendŭlārĕ ci-dessous) ;
pĕrtĭcă(m) > AO pertẹga "perche" ;
pĕtrĭcă(m)
> AO
peir
pĭpŭlă(m) > pibola "peuplier", alors que pĭpŭlŭm > pibol "peuplier" ;
tĕpĭdă(m) > AO tebéza "tiède (fém)", alors que tĕpĭdŭm > tébe "tiède (masc)" ;
lacrĭmă(m) > lagrema "larme" ;
fabrĭcă(m)
> fabrega
"forge" (voir aussi n.d.l.
(ces derniers cas sont plus complexes car il y a une muta cum liquida, mais le fr a l'accent sur la première syllabe : "larme", "forge").
Pour les formes conjuguées, le
basculement d'accent de l'
aestĭmăt > estima, " il aime" (p.p. : il esme)
bŭllĭcăt > bolega, "(il) bouge"
*excŏrtĭcăt > escortega "(il) écorche" (aussi AO (il) écorce")
*gĕmĭcŭlăt > *gemegola
> (
intāmĭnăt > entamena, "(il) entame"
mastĭcăt > mastega, "(il) mâche"
*pendŭlāt > pendola "(il) pendille ; (il) suspend"
*trĕmŭlăt > tremola, "(il) tremble"
*rōdĭcăt > rosega, rosiga, "(il) ronge" (a.fr. rugier) (alors que "ronger" < rongier < *rōdĭcārĕ x rūmĭgārĕ)
rūmĭgăt > romega, romiga, romia "(il) rumine" (a.fr. rungier)
sēmĭnăt > semena, samena "il sème"
strangŭlăt > (pr.ma., g, auv,...) estrangola "il étrangle"
Ces types ont influencé les infinitifs, d'où bolegar "bouger", mastegar "mâcher", tremolar "trembler", rosigar "ronger"..., qui comportent aussi une syllabe de plus qu'en français.
Par contre, certains verbes occitans ne présentent que la variante syncopée :
*rŭmĭcĭăt > ronsa "(il) jeter, (il) lance" alors qu'on a rŭmĭcĕm > romese ci-dessous.
Certains mots masculins, bien plus rares que les féminins, présentent aussi un basculement d'accent :
*cannăpĕm > canebe "chanvre", à côté de cambe, carbe... (pour le premier e dans canebe, voir ).
Ce type de basculement est noté en particulier en dauphinois (dialecte de la Drôme) (FEW 6/1:654b, CNRTL "mélèze") :
rŭmĭcĕm > romese "ronce ; ronce bleue" ;
*mĕlĭcĕm > melese "mélèze".
La situation est variable selon les régions du domaine d'oc, ce qui accentue la fragmentation dialectale et rend complexe une généralisation, voire l'élaboration d'une norme de l'occitan. Par exemple :
Pour certains mots, l'évolution mène à des variantes non syncopées ou syncopées selon les régions : ăsĭnŭ(m) > type ase (pr, l, béar) ; type aine (lim, d, g).
Pour certains verbes, les interactions
au sein d'un paradigme de conjugaison (ci-dessus) mènent à des
variantes non syncopées ou syncopées selon les régions : ajudar/aidar,
tremolar/tremblar.
Il s'agit de l'évolution des formes occitanes non syncopées, que j'appelle apocope de type occitan. Elle caractérise nettement l'occitan par rapport au français (ci-dessus) ; elle concerne également le catalan (jŭvĕnĕm > jove), et elle a une évolution plus poussée par rapport à l'espagnol (jŭvĕnĕm > esp joven) et aux langues rhéto-romanes (jŭvĕnĕm > fri zovin, ğovin, rom giuven).
Pour l'occitan, on peut prouver facilement qu'il existe une
ăsĭnŭ(m) > ase "âne"
ăsĭnŭ(m) > ase "âne" ;
jŭvĕnĕ(m) > jove "jeune" ;
*nībŭlŭ(m) > nívol /nivo/ "nuage" ;
crēscĕrĕ > crèisser /krèysé/ "croître" ;
fŏrfĭcēs
> fòrfes "forces" (ciseaux à tondre)...
Jules Ronjat n'utilise jamais le mot "
Remarque
: dans la forme AO de type CRS m
Cette apocope de type occitan s'est en fait déroulée en deux étapes, dont la première est l'apocope "normale" (ci-dessus B. Chute de la voyelle finale).
Ce type d'évolution a été étudié par certains linguistes, notamment Jules Ronjat (pour l'occitan : GIPPM-1:227-271) et bien plus tard Max Wheeler (pour le catalan : SAHC pour le catalan).
Selon Jules Ronjat, trois situations peuvent empêcher la syncope :
- (GIPPM-1:231) (r.g.f.d.a.) "La
- Puis p. 232 : "Outre les causes phonétiques qui viennent d'être résumées [...], le maintien de la pénultième peut être dû à l'analogie ; comme on le verra par la suite, il est souvent fort difficile de faire le départ entre ces deux ordres de faits [...]". (ex : p. 251 : pessègue (< persicum) refait sur pesseguier (< persicārium).
- Enfin (p. 232) : "D'autre part, la
pénultième est maintenue dans des mots de
(1) L'auteur continue sa phrase en
mentionnant de façon peu claire des paroxytons en
"et de même dans les paroxytons
Par exemple pour les proparoxytons en
L'étape */azénó/ >
*/azén/ relève donc du
même processus que B. Chute de la
voyelle finale ci-dessus, puisque ăsĭnŭ(m)
évolue de cette façon :
(1) ăsĭnŭ(m) > asen
Plusieurs langues sont restées à ce stade, notamment les langues rhéto-romanes : ci-dessous.
Scénario :
ăsĭnŭ(m) /asinʋ/ > */asénʋ/ > */azénʋ/ > */azénó/ > asen /azén/
Variante possible : */azénó/
>
*/az
(cette variante est donnée pour le catalan dans SAHC).
Autre scénario possible : voir juste ci-dessous.
Une étape plus tardive se rajoute : l'apocope de -n :
(2) asen > ase (XIe siècle)
Quelques cas existent en français :
Par exemple pour angelum
> "ange", je cite CNRTL
"ange" :
(j.d.l.a.)
"Angele suppose un latin
Il s'agit ici de comprendre l'évolution de la voyelle
L'étape (1) ci-dessus suppose qu'il n'y a pas eu de syncope dans les proparoxytons.
Pour cette étape (1), on
pourrait envisager un autre scénario : syncope puis épenthèse de /é/
dans */azéno/.
Dans ce cas, on attribue à n
une valeur de syllabe :
*/azénó/ > (syncope) */aznó/ >
(apocope normale) */az
n est une
Ce scénario, quoique peu probable, doit quand même être étudié. Il m'a été inspiré à la lecture de SSÉPO. Patrick Sauzet et Guylaine Brun-Trigaud proposent un scénario analogue pour une évolution des muta cum liquida au moment des syncopes (SSÉPO:10-11) :
nĭgrŭm > /nég
([é] final est épenthique
dans ce scénario ; il se place derrière r en oc.gén. ; devant r en g, où le
Voir aussi GIPPM-2:232 : "cap(e)re > *cabre >
*cab
Concernant les
En conclusion, je ne pense pas que ce scénario se réalisât pour les proparoxytons (type */azéno/). Cela pour deux raisons :
- En admettant que ce processus fonctionnât pour nĭgrŭm, l'oc.gén. montre que le e épenthique se place derrière r (/négr̟/> negre) ; il serait donc curieux qu'il se place devant n dans */azn̟/ et dans de nombreux autres cas ;
- L'étude des voyelles post-toniques ci-dessous, notamment la voie "e"
(ase) et la voie "o" (nívol) permettent d'envisager
un scénario cohérent de conservation de ces voyelles, ci-dessous.
Pour les mots ayant subi l'apocope de type occitan, pour l'occitan
comme pour le catalan, on observe que la voyelle
Exemples pour e : ăsĭnŭm > ase "âne", Rhŏdănŭm > Ròse "Rhône", crēscĕrĕ > crèisser /krèysé/ "croître" ; et (avec basculement d'accent) : lapsănăm > lassena "moutarde des champs", ăsĭnăm > asena "ânesse"...
Exemples pour o : nūbĭlŭ(m)
> *nībŭlŭ(m) > nívol "nuage", *cōtŭlŭ(m) > còdol "caillou"
; ces deux derniers mots sont obtenus par
Position générale des linguistes
Les linguistes n'ont :
- les mots avec e montrent qu'il y a eu
affaiblissement de la voyelle post-tonique latine, c'est-à-dire
qu'on obtient e (souvent considéré comme un schwa [
- les mots avec o montrent une évolution de type savant, c'est-à-dire que la syncope est évitée en raison du caractère savant du mot, et le o est ainsi conservé (avec ŭ > o).
Jules Ronjat (GIPPM-1:231) "Timbre des posttoniques maintenues. — [...] À part les mots en -o ~ -ou ~ -oul, -oulo ~ -a ~ -e, -i < -ulu, -ylu examinés au § 140 [...], toute pénultième latine (devenue, sauf les cas très rares signalés § 409, tonique ou finale rom.) passe uniformément à e, exemples c- ∼ chance, plagne ∼ -nge < cancere, plangere, prov. pessègue, aq. persèc ∼ pressèc ∼ pessèc, auv. persèjo < persicu, -a, prov. conse < cōnsule, lasseno ∼ -a ∼ -e < lapsana, Rose, orgue < Rhodanu, organu, prov. canebe, luch. cànep < cannape. De même cese, segne < cicer, senior."
Voyelles e, i, o, u :
Pour le catalan, langue très proche de
l'occitan, Max Wheeler suppose que les voyelles latines post-toniques e,
i, o, u ont évolué en [
(1) L'expression vowel reduction signifie généralement "apophonie", mais ce mot est lui-même ambigu (voir apophonie). L'auteur estime qu'il s'agit d'une évolution vers [ə] (mais justement ci-dessous j'estime qu'en occitan se sont réalisées des néo-apophonies, menant non à [ə], mais à [i] ou [u]). Concernant les low vowels, voir ci-dessous voyelle a (les low vowels sont les différentes formes de a).
Voyelle a :
Antoine Thomas propose une règle d'affaiblissement a > e en occitan (EPF:213-214, à propos de l'étymologie de aise) :
"On nous permettra donc de mettre en pleine lumière une particularité intéressante de la phonétique non encore étudiée. On peut poser la règle suivante :
A posttonique dans les proparoxytons s'est affaibli en e dès la période primitive ; et les traitements qu'il peut subir ultérieurement sont les mêmes que ceux de l'e dans les mêmes conditions."
Remarque : pour a prétonique
interne, il reste a : ornamentu(m) > ornament
"ornement", armatura(m) > armadura "armure" (ancien français
armeüre : a était affaibli en e).
Nouveau raisonnement
Raisonnement prédictif : Quelles sont les voyelles post-toniques d'origine latine qu'on peut trouver en occitan ? Si on considère la voyelle post-tonique d'un proparoxyton latin, celle-ci ne peut être que brève : ă ĕ ĭ ŏ ŭ (règle 3 de l'accent). Comme elle est atone, elle obéit à la fermeture des atones, donc ĕ et ŏ évolueront en é et ó, et se confondront avec les aboutissements de ĭ et ŭ. Donc au final, si la post-tonique demeure, elle ne pourra être que [a], [é] ou [ó].
Confrontation avec les faits : Dans les mots provenant d'une apocope de type occitan, on ne trouve que deux voyelles post-toniques occitanes : [é] et [ó] ; le [a] n'est jamais représenté.
- Parfois elle est différente de la voyelle actuelle :
Rhŏdănŭm
> Ro
- Parfois c'est la même que dans la voyelle actuelle :
*nībŭlŭ(m) > *nivolo > nívol : cela est un argument en faveur de l'absence de syncope.
Max Wheeler signale que les voyelles
post-toniques sont toutes passées à [
La proposition ci-dessous est complètement personnelle.
Dans le latin parlé de Gaule, il me semble qu'on peut étendre le système des néo-apophonies dans les proparoxytons. Ces néo-apophonies étaient rarement écrites, mais existaient essentiellement dans le langage oral.
Voir mots apophoniques "cachés" du latin vulgaire.
Par rapport au français, l'occitan se différencie nettement pour les
mots étudiés ci-dessus (ase /
âne, Ròse / Rhône, crèisser
/ croître...).
Au niveau du
|
latin
|
apocopes
|
français et occitan
|
|
ăsĭnŭs |
> |
CSS t.a.oc. asens |
| ↓syncope fr. |
|
|
|
asnes |
> |
CSS t.a.fr. asnes |
|
|
|
|
|
ăsĭnŭ(m) |
> |
CRS
t.a.oc. asen > oc. ase |
| ↓syncope fr. |
|
|
|
asne |
> |
CRS
t.a.fr. asne > fr. âne |
|
|
|
|
| ăsĭnī | > |
CSP t.a.oc. asen |
| ↓syncope fr. |
|
|
|
asne |
> |
CSP t.a.fr. asne |
|
|
|
|
|
ăsĭnōs |
> |
CRP
t.a.oc. asens > oc. ases |
| ↓syncope fr. |
|
|
|
asnes |
> |
CRP
t.a.fr. asnes > fr. ânes |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution
comparée du
Voir les explications dans les paragraphes précédents.
On voit que la syncope systématique du français s'est bien réalisée, mais que la syncope ne s'est pas réalisée en occitan.
Catalan
Le catalan suit la même évolution que l'occitan : (ăsĭnŭm
> cat ase, jŭvĕnĕm > cat jove,
crēscĕrĕ
> cat créixer),
mais il conserve encore certains
Langues rhéto-romanes
Les
L'espagnol a joven, ce qui
semble en contradiction avec l'absence d'apocope signalée ci-dessus
en espagnol. Mais l'italien a bien giovane "jeune", asino
"âne", uomo
"homme" (< n. hŏmō,
correspondant à oc. òm
et fr. "on"). L'espagnol
apparaît plus composite sur ce point (avec asno,
hombre, fresno aboutissements de
Ci-dessous, je commence une étude systématique des proparoxytons latins et de leur devenir en occitan.
Pour l'occitan, l'évolution des proparoxytons latins est très variable
selon les mots. Pour organiser leur étude, Jules Ronjat se fonde sur la
structure vocalique (GIPPM-1:230 et suivantes). Mais je ne suivrai pas
cette voie car elle est confuse et elle me semble peu convaincante. Hans
Georg Herford (LPA) se fonde, lui, sur la structure
consonantique. J'utilise ci-dessous les consonnes dans un but de
praticité dans ma phase de recherche, et je pense que la trame restera
la même une fois la recherche avancée car la succession des consonnes
semble la plus déterminante pour l'évolution des proparoxytons.
(LPA:12)
Jācōbŭm > (changement de quantité vocalique et d'accent?) > *Jācŏbŭm > Jacme > Jaume
(LPA:12) Voir ci-dessous N-P (cannăpĕm).
(LPA:25...)
J'étudie ici les
Influence du français
Pour les francismes très anciens, voir par exemple galbinum
> jaune, même l'italien giallo
"jaune".
Manducare > manjar, même
l'italien mangiare.
Quelques
|
|
|
| français
: (d'après |
|
| > (début
IIIe s. : diphtongaison
romane
spontanée) /miè̯dikʋ/ |
|
| > (IIIe
siècle : ʋ final de proparoxyton > |
|
| > (vers
l'an 400 : sonorisation
de
k) /miè̯dég |
|
| > (Ve
s. : spirantisation de g
secondaire IPHAF:50) /miè̯dé |
|
| > /miè̯dé |
|
| > (VIe
s. : |
|
| > /miè̯dj |
→ a.fr. miege |
| autre possibilité : (d'après |
|
| occitan
: (propositions personnelles) |
|
|
voie
1
: masculin
|
|
| > (mutation ĭ > é) /mèdékʋ/ | |
| > (vers
l'an 400 : sonorisation
de
k) /mèdégʋ/ |
|
| > (Ve s. : mutation u final > ó) /mèdégó/ | |
| > (VIe
s. : |
|
| > (XIe
s... : influence du français) /mèdjé/ |
→ mètge |
|
voie
2
: féminin mĕdĭcă(m)
/mèdika/
|
|
| > (mutation ĭ > é) /mèdéka/ | |
| > (vers l'an 400 : sonorisation de k) /mèdéga/ | |
| > (VIe s. : |
→ AO mètga |
cīmex, cīmĭcĕm "punaise" > cimia, sumia, cinça, sinza, Toulouse címec, Aude címet...
De nombreux mots latins en -nĭcŭm,
-nĭcăm, nĭcīs, -năcăm... ont donné une descendance en occitan
actuel, avec deux aboutissements principaux selon la région : type
-rgue
(mŏnăchŭm > morgue), type
-nge
(mŏnăchŭm > monge).
Voir GIPPM-1:277-282.
(GIPPM-1:277)
|
latin
|
|
occitan
|
|
français
|
|
|
|
|
|
|
| cănŏnĭcŭ(m) (1) | canonge (1) AO canọnegue, AO canọrgue |
chanoine |
||
|
|
|
|
|
|
| dĭēs
dŏmĭnĭcŭ(m)
> *diominicu |
> |
rouerg dimèrgue, dimenge niç dimengue, dimenegue |
dimanche |
|
|
|
|
|
|
|
| dŏmĭnĭcŭ(m) |
> |
Domèrgue Domenge |
(Dominique) |
|
|
|
|
|
|
|
| grānĭcă(m) |
granja Var granga AO : 04 granega (2) |
grange |
||
|
|
|
|
|
|
| Līmĭnĭcŭ(m) |
> |
Limèrgue |
hydr. L'Imergue |
|
|
|
|
|
|
|
| mănĭcă(m) |
> |
pr.ma., l marga, mancha, a manega |
manche f. | |
|
|
|
|
|
|
| > | messòrga
/ messorga, messònja / messonja, messònga, niç mensonega |
mensonge |
||
|
|
|
|
|
|
| mŏnăchă(m)
(1) (> mŏnĭcă) |
> |
morga (1), monja, niç monega, g moneca |
moniale |
|
|
|
|
|
|
|
| mŏnăchŭ(m)
(1) (> mŏnĭcŭ) |
> |
morgue (1), monge niç monegue |
moine |
|
|
|
|
|
|
|
| Rŭthēnĭcŭ(m) |
Roèrgue |
Rouergue |
||
|
|
|
|
|
|
| pr.rh. vielhonge |
(vieillesse) |
|||
|
|
|
|
|
|
Tableau : Évolution de -nĭcŭ, -nĭcă, (-năcă).
(1) Pour l'évolution ŏ >
(2) Pour grānĭcăm > granega : attestation AO : 04 selon GIPPM-1.:278.
Les très nombreux noms de lieu en -argues,
-èrgues,
-òrgues proviennent de
Par exemple : Marcellĭānĭcīs >
Massilhargues "Massillargues". On pourrait traduire Marcellĭānĭcīs
par "dans les propriétés de la famille Marcellŭs".
Il s'agit en effet souvent de noms de lieux fondés sur un gentilice,
avec une
Les étapes de l'évolution furent : -ānĭcīs > -ánegues > -angues > ("par différenciation") -argues (NLL:72, 73).
Évolution
du locatif pluriel en -īs
La terminaison occitane en -es,
largement attestée en AO, s'explique ainsi : l'évolution du
Puis à une époque difficile à préciser, on a dû avoir -nguis
> -ngues : la terminaison
|
latin
|
|
occitan
|
|
français
|
| Alsŏnĭcīs |
> |
Alsonegues > (Als) Ònegues > Leis Òrgues |
n.d.l. St-Étienne-les- Orgues |
|
|
|
|
|
|
|
| Marcellĭānĭcīs |
> |
Massilhargues, Marcelanges |
n.d.l. Marsillargues (34), Massillargues (11, 30, 48, 84 : Avignon) n.d.l. Marcellange (Allier, Puy-de-Dôme) |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau : Évolution de -nĭcīs.
|
|
|
| > |
|
| sarga "serge" |
Il y a basculement d'accent (ci-dessus).
fabrĭcăm > oc fabrega "forge"
fabrĭcăs
>
à continuer
*rĕsĕcŭm > AO rezegue "risque" (FEW 10:293a,b, CNRTL "risque"). Il y a basculement d'accent (ci-dessus).
Cŏrsĭcăm > AO Corsega / Còrsa (En Corsega o en Sardeina Flam in FlamM:125, vers 4176)
Pour Corsega, il y a basculement d'accent (ci-dessus).
Voir aussi fĭcătŭm > *ficitu > (métathèse) *fiticu > oc fetge [fédjé] "foie". Voir fĭcătŭm ("Abrègement de certaines voyelles longues ?")
Certains mots latins en -ātĭcŭm
ont évolué en oc
Voir dialectes italiens (vénitien, émilien...) : salvadegh, salvadega / salvadga (it.wiktionary.org).
|
.......
|
|
| > (Ier
siècle) /sal |
|
| > (IIIe
siècle) /salvatékʋ/ |
|
| > (vers l'an 400 : sonorisations)
/salvadégʋ/ |
|
/si:lwa:ticʋ/
> salvadge̟:
manticam > manga / marga / mancha
Type nătĭcă(m) :
Ci-dessous la carte d'un article de Max Pfister (BAG:341) qui défend la théorie d'une influence
française (langue d'oïl) de
(PBZAG-cr:414) "À l'instar de Ronjat et de Mlle Ringenson, je crois que -atgue a pu se palataliser en -atge (Graphie, p. 189-190). M. Pfister trouve une telle évolution douteuse au point de vue phonétique (p. 342)"
"Ainsi que Meyer-Lübke, M. Pfister voit en -atge le suffixe français et il essaie d'en suivre la propagation en territoire occitan (p. 339-342)".
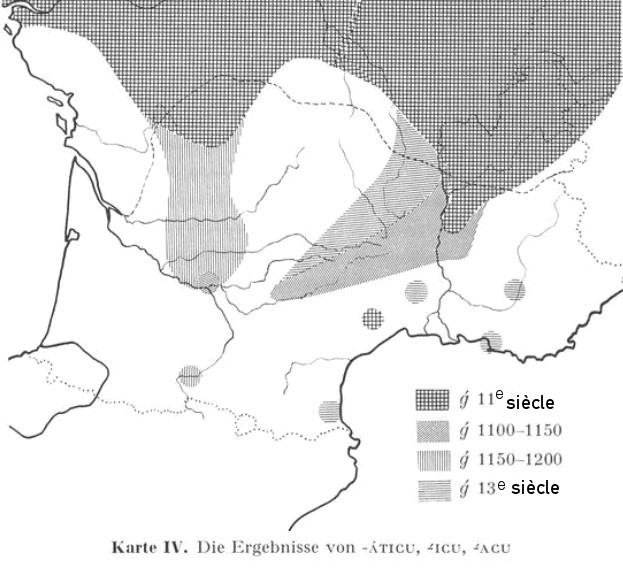
Aboutissements de -ātĭcŭ,
-ĭcŭ, -ăcŭ (BAG:341).
Le nom de fleuve acc Atacĕ(m) "Aude" (nom Atax) a été étudié par Antoine Thomas (LNDFA). L'auteur démontre qu'il y a eu une métathèse entre les deux consonnes "certainement postérieure à la sonorisation et à I'assibilation du с". Conformément à cette idée, dans le scénario ci-dessous, je propose la métathèse au stade */adadzé/ (> */adzadé/).
A. Thomas donne les jalons :
année 737 super Adice fluvio,
année 914 : in fluvium Ataze,
année 925 : super fluvium Azate,
année 978 : In flumine Azate,
année1053-1060 : in flumine Azete,
année 1069 : Alde,
année 1089 : super fluvium Azde.
Scénario pour Atacĕm > Aude /awdé/ "Aude" (conformément à LNDFA) :
|
acc
Atacĕ(m)
"Aude" (nom Atax)
|
|
| (IIIe siècle : palatalisation
de -c-)
*/ata |
|
| (vers l'an 400 : sonorisations)
*/ada |
|
| (fin VIe, VIIe siècle : dépalatalisation) */adadzé/ | |
|
Variante (1)
|
|
| → Adice
(année 737) (1) |
|
| (métathèse
d-dz > dz-d) */adzadé/ |
→ Azate (année 925, graphie conservatrice pour t) |
| (syncope)
*/adzdé/ |
→ Azde (année 1089, graphie z conservatrice) |
| (vocalisation
dz > |
→ Alde
(année 1069, sans doute prononcé a |
(1) Dans Adice, il est possible que la forme apophonique avec i apparût plus tôt, et qu'elle se continuât en e (voir Azete en 1053-1060), mais qu'elle fût rarement écrite pour conserver le a latin à l'écrit.
Jules Ronjat (GIPPM-1:252-254) range plusieurs mots de ce
groupe dans ce qu'il nomme "mots de
Je pense que sa conception est complètement à revoir. (à développer). Je pense que le traitement des féminins avec basculement d'accent (type tĕpĭdăm > AO tebeza "tiède") est typiquement populaire, et non savant.
(LPA:22)
NC-D
rancĭdŭm > AO rance "rance", rancĭdăm > AO ransa (?).
(LPA:22)
ND-D
candĭdŭm > AO cande "blanc", candĭdăm > candeza "blanche" (probablement candeza).
Pour candeza, il y a basculement d'accent (ci-dessus).
Pour frīgĭdŭs "froid", en LPC déjà, deux variantes existaient : *frĭgdŭs et *frīdŭs.
La forme classique frīgĭdŭs ne devait
plus être employée qu'à l'écrit, ou bien dans un registre soutenu. Les
deux variantes parlées sont attestées à l'écrit dans des contextes
particuliers (voir ci-dessous : attestations antiques).
Les dérivés actuels dans les langues romanes forment ainsi deux groupes issus de ces deux variantes latines :
- *frĭgdŭs
> oc freg
/frét
- *frīdŭs > esp, port frio, a.esp. frido.
- Première voie : syncope précoce avec ī > ĭ (> *frĭgdŭm > oc freg, fr "froid"...)
- Dans Prob:54, on trouve :
"frigida non fricda" "le mot correct est frigida ["froide"] et non fricda".
Les linguistes signalent que fricda devait être prononcé /frigda/ (par exemple GIPPM-2:104) ; J. Powell préfère même voir dans le manuscrit frigida ñ friGda, avec une incertitude sur G (NTAP:696).
Attestations antiques du même type :
frigdarium "glacière, chambre froide" (Lucilius:317, Vitruve:5,11)
frigdor "froid" (Pelagonius:141, CGL)
Cette voie est à l'origine de oc
freg /frét
Jules Ronjat (GIPPM-2:104) étudie soigneusement le double
problème de la syncope et de l'évolution ī
> ĭ. La syncope frīgĭdŭ > frīgdŭ lui paraît trop
précoce pour être phonétique, et l'auteur y voit une analogie sur călĭdŭs
> căldŭs "chaud". F. de La Chaussée adopte la même position
(IPHAF:46). On aboutit ainsi à deux
Concernant le groupe consonantique
(1) (prononcé /frét
| frīgĭdŭm */friː |
|
| > (avant Ier siècle après J.-C. ? : syncope précoce, avec renforcement des spirantes au contact l'une de l'autre) */friːgdʋ/ | |
| > (abrègement ī
> ĭ) (1) */frigdʋ/ |
|
| > (fin
IIe : i > é)
*/fré |
|
| > (fin IIIe - Ve siècle : évolution de type ct > yd, -ʋ > -o) */fréydo/ | |
| > (VIIe,
VIIIe s. apocope
avec -d > -t)
*/fréyt/ |
→ (a.fr.) freiz
(freit) → (oc "zone dreit") freit |
|
En
français :
|
|
| > (éy > wa : évolultion de type tēlă >
"toile", amuïssement de -t)
/frwa/ |
→ froid (graphie -d calquée sur le féminin) |
| > /frét |
→ freg
/frét |
(1) L'abrègement ī > ĭ se serait réalisé "par la tendance vulgaire à ouvrir une voyelle entravée", GIPPM-2:104 (remarque à étudier) ; ou bien par la règle générale "absence d'une voyelle longue dans une syllabe fermée", ou bien par analogie sur l'opposé călĭdŭs "froid", ou sur rĭgĭdŭs "raide".
- Seconde voie : amuïssement de g entre les deux i (> *frīdŭm > esp, port frio)
Le g au contact de i
suit l'évolution générale de g au contact de i
pour donner /
Dans Pomp, on trouve "da fridam pusillum" "donne un peu d'eau froide" (CIL IV, 1291).
Cette variante *frīdus
(< *frīĭdŭs) a mené à esp frío
"froid" (GIPPM-2:104), port
frio : voir
l'
(LPA:23)
Pour rĭgĭdŭm "raide", les descendants occitans montrent que l'évolution a suivi deux voies :
- type rege :
pour les variantes AO rẹge, a, g retge (rege), il y a eu apocope de type occitan (ci-dessus) :
rĭgĭdŭm > AO rẹge "raide", rĭgĭdăm > AO regeza (pour regeza : basculement d'accent) ;
- type rede :
pour les variantes AO rede,
pr rede,
l redde,
d reide,
auv reid,
g rete,
rette :
- s'il y a eu amuïssement de g au contact de i
(avant i > é) > *rĭĭdŭm :
ce scénario ne semble pas pouvoir (?)
une syncope ancienne rĭgĭdŭm > *rĭgdŭm, et (?)
(à continuer)
(LPA:20...)
Dans les mots connus, il y a presque systématiquement apocope de type occitan au masculin, et basculement d'accent au féminin (ci-dessus).
cŭpĭdŭm > AO cọbe "cupide", cŭpĭdăm > cobeza
(voir aussi à D-T ci-dessous cŭpĭdĭtās,
tĕpĭdŭm
> tèbe "tiède", tĕpĭdăm
> AO tebeza
(sans doute avec l'accent tonique sur la
răpĭdŭm > AO rabe, răpĭdăm > rabeza "rapide" ; a.fr. rade "rapide, impétueux"
săpĭdŭm
> AO sabe, sade
"savoureux", săpĭdăm
> AO sabeza
(sans doute avec l'accent tonique sur la
MP-D
lampada > AO lampẹza, lampa.
SP-D
(AO)
jaspis, jaspe "jaspe" : probablement emprunts au latin jaspis
(du grec ἴασπις íaspis), plutôt que héritage de jaspĭdĕm
; pour le français : CNRTL
"jaspe".
(LPA:22...)
(*fătĭdŭm > fade ?, mais il y a fătŭŭs "fade ; insensé)
foetĭdŭm > AO fet
"fétide"
nĭtĭdŭm
> AO nẹde, nẹt
"net, propre, pur"
bŭxĭdăm (IVe siècle, FEW 9:655a) > (AP) boiss
(GIPPM-1:247-250)
ἀμυγδάλη (amygdálê) > ămĭddŭlă > amela, amenla
Pour tăbŭlăm, voir bl intervocalique.
nūbĭlŭ(m) > *nībŭlŭm
> nívol /nieu "nuage"
(b =
Sans syncope : *nībŭlŭm > nívol /nivò/ "nuage"
Avec syncope (ou amuïssement de v devant u ?) : *nībŭlŭm > *niv'lu ou *niulu > (si nivlu : vocalisation de v) AO niul > (vocalisation de -l et fusion à u) niu (> nieu) "nuage"
La voie la plus fréquente est la palatalisation de cl intervocalique :
Pour la quantité vocalique du i latin, le suffixe oc
apĭcŭlă > abelha (abilha) "abeille" ;
aurĭcŭlăm > aurelha (aurilha) "oreille" ;
lentĭcŭlăm > lentilha "lentille" ;
sōlĭcŭlŭm > solelh, soleu "soleil" ;
spĕcŭlŭm > AO espelh, espielh "miroir".
Parfois, avec une absence de syncope par influence savante (?), il existe un basculement d'accent pour des formes féminines (basculement d'accent ci-dessus) :
fĕrĭcŭlăm > ferigola "thym", peut-être par un intermédiaire fĕrīcŭlăm pour expliquer le i de ferigola, voir le schéma -ī-ŭlă à "Voyelles", ou bien influence savante
*pĭcŭlăm > pegola "poix"
On peut possiblement reconnaître un suffixe occitan -(i)gola < -ĭcŭlăm :
voir berigola, espargola.
Pour -gŭl-, voir gŭ en post-tonique interne (rēgŭlă, tēgŭlŭm, cŏāgŭlăt...).
Bŭrdĭgălăm "Bordeaux"
Bŭrdĭgălăm > Bŭrdĕgălĕ > Bordèu (EPF:216).
En domaine d'oïl, les aboutissements de pĭlŭlăm
"boulette" témoignent d'une syncope : a.fr.
pile, wal.Liè.
pile. Ces aboutissements pile font interroger sur la
quantité vocalique latine de ĭ dans pĭlŭlă : n'y
aurait-il pas eu une variante galloromane pīlŭlă, avec i
long ? Cette transformation pĭlŭlă > *pīlŭlă pourrait
s'aligner sur un schéma
Selon FEW 8:509a, l'AO pilola, pilora, pinhola, provient probablement d'emprunts oraux à l'italien pillola "pilule" depuis Salerne jusqu'à Montpellier. Aussi : AO pidọla, et avec diminutif : pilolẹta, pilorẹta. On peut se demander si certaines de ces variantes ne sont pas typiquement occitanes, héritées de *pīlŭlă (ci-dessus), avec basculement d'accent.
Dans la péninsule ibérique, pĭlŭlăm a donné esp, port pella "grumeau", gal pènla "bollo de manteca" (FEW 8:509a).
Pour pōpŭlŭs > pīpŭlŭs, voir la discussion de von Wartburg (FEW 9:182b) : on ignore l'origine de ī. Peut-être peut-on rattacher *pīpŭlŭm à un schéma voir -ī-ŭlă à "Voyelles".
À continuer.
Une syncope suivie d'un amuïssement de /s/ s'est réalisée pendant la
période latine pisŭlă > pīlă
"mortier ; auge à foulon" (DFL "pīla").
Cependant dans ce cas, il n'y a pas eu évolution sl > scl (pourquoi ?).
Pour i(n)sŭlăm > *īsŭlăm "île" : selon moi, le scénario pour l'occitan est la double évolution :
|
|
|
| Voie 1 : d'abord sonorisation | |
|
> (amuïssement de z) */ila/
|
→ oc ila |
| Voie 2 : d'abord syncope |
|
|
> (syncope)
*/isla/
|
|
| → oc iscla |
|
Voir évolution de t'l intervocalique :
- soit t'l
s'assimile à cl > /
- soit t'l
évolue en nl, ll, ul.
vĕtŭlŭm > *vetlus > veclus > vièlh
*hĭnnītŭlāre > endilhar "hennir"
Voici un témoignage attestant de l'évolution t
Dans Prob, on trouve :
"vetulus non veclus" "le mot correct est vetulus ["d'un certain âge"] et non veclus"
spathula > espala, espalla, espanla, espaula.
Pour la variante espanla : il
est possible qu'il y ait eu une première étape de sonorisation de t : *espatula
> *espadula > *espadla. On se trouve dans le même cas que
ămĭddŭlă
> *amedla > amenla.
lacrima(m) > lagrema
"larme"
Voir groupe consonantique n'm.
ănĭmăm > arma "âme"
Les proparoxytons en t-m ayant une descendance romane sont mărĭtĭmŭs et lēgĭtĭmŭs.
Voir le groupe primaire tm.
L'évolution du contact t-m n'est pas très claire (GIPPM-2:156 : "traitement obscur de t'n, d'n, t'm"). La plupart des aboutissements ci-dessous sont donnés dans FEW 6/1:335a. Je distingue trois types d'aboutissement ci-dessous.
1. t'm > nasale-nasale : mărĭtĭmăm > g la Maremna "la Maremne" (40, vicomté sous l'Ancien Régime, parfois "le Maremne").
Je pense qu'on doit rapprocher ces évolutions de t'm de la loi phonétique latine "occlusive + nasale > nasale + nasale". Il est probable que cette loi très ancienne s'appliquât aussi en latin tardif.
Pour g la Maremna, J. Ronjat (GIPPM-2:257) donne l'évolution suivante : marit(i)ma > (assimilation) *maremma > (différenciation) Maremna.
mărĭtĭmă(m) a donné : g la Maremna (40), a.fr. mareme "côte", m.fr. (1554) marennes f.pl. "terrain situé au bord de la mer", Marennes (17), it maremma "littoral marécageux", la Maremma (côte toscane marécageuse).
2. t'm > sm (type ibérique) :
mărĭtĭmăm > cat maresma, a.esp., port marisma "plantes poussant dans l'eau de mer".
lēgĭtĭmŭm > AO legisme "(enfant) légitime", OM lèime "franc, pur" (GIPPM-1:349, GIPPM-2:257-258). Pour lèime, je propose une autre solution juste ci-dessous.
Pour legisme : (GIPPM-2:257) "legisme donne l'impression
d'un mot savant (cf. vpr. arismetica <
- normalement ĭ > é, mais GIPPM-2:257 propose pour lēgĭtĭmŭm > legisme : "-i- par l'action de [-dj-] jointe à la métaphonie" : le i de legisme pourrait en effet ici s'expliquer par e > i après palatale (bien qu'ici il s'agisse d'une position tonique et non prétonique) ; g intervocalique a pu donner yod renforcé > [dj] (GIPPM-2:257 donne aussi une analogie possible sur lejal < lēgāle) ; t'm > sm est de type ibérique (mărĭtĭmăm > marisma).
3. Cas lēgĭtĭmŭm > OM lèime "franc, pur" :
Pour expliquer i de lèime (normalement ĭ > é), j'invoquerais volontiers une évolution t intervocalique > ∅, menant à ĭĭ > ī.
Ainsi on obtient *lēgīmŭs, qui se rapproche beaucoup de rēgīna(m) > rèina "reine".
lēgĭtĭmŭm
> *lēīmŭ(m)
> (basculement d'accent éi > éi) *léime
> (éi > èi) lèime.
maxĭmŭm > oc
Maime (nom de saint, nom d'homme) ;
prŏxĭmŭm > AO pr
(GIPPM-1:243-247, GIPPM-2:286)
Il existe plusieurs schémas d'évolution (diversité
des évolutions ci-dessus). Je propose les schémas d'ensemble
suivants :
voie 1 : apocope de type occitan (ci-dessus)
ăsĭnŭm
> (apocope 1e phase) asen
> (apocope 2e phase) ase
Remarque : pour plantāgĭnĕm > plantai (G-N),
plătănŭm > blai, le
voie 2 :
syncope et vocalisation de la première consonne
ăsĭnŭm
> (syncope) *asne
> (vocalisation
de s) g aine
voie 3 : syncope et évolution n > r, en général si cela permet d'obtenir une muta cum liquida :
cŏphĭnŭm > (syncope) *còfnu > (évolution n > r) còfre "coffre"
dĭācŏnŭm > diacre (variante de diague, diaque) ;
feminam > femna > *femra > variante frema
"femme"
pampĭnŭm > pampre ;
Lĭngŏnĭs > *Lengres >
"Langres" (
(et le type espagnol sanguĭnĕm > sangre, très développé dans m-n : ci-dessous.
voie 4 : Pour certains mots en -a : basculement d'accent (ci-dessus).
lapsănăm > *lapsĭnăm > (syncope) lassena "moutarde sauvage"
Aussi :
feminam > variante AO femena ;
Stĕphănăm > Estevena ;
tautĕnăm > tautena "calamar" ;
variantes de type alumenar pour les verbes de type alumar/alumenar
;
...
Dans ces mots, il y a probablement eu une apophonie
de la post-tonique : ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ
> ĭ (puis ĭ > é).
(On n'a pas
Autre solution : il s'agit de é épenthique après une ancienne syncope (voir type niger).
voie 5 : Amuïssement du n (gascon) :
Cette voie est celle du gascon, qu'on retrouve dans la péninsule
ibérique en gallicien et en portugais, voir amuïssement du n
intervocalique en gascon. Par exemple ci-dessous
: sēmĭnārĕ > gasc
semoar, samoar, béar
semiar, samiar, somiar.
LB-N :
galbĭnŭm > jaune
ăcĭnŭm > age "grain de raisin", a.fr. aine, asne
dĭācŏnŭm > diague, diaque, diacre
"diacre"
Rhŏdănŭm > Ròse
bodina (> boina "borne" voir botina ci-dessous)
Substitution de suffixe
Les formes en
Le nominatif s'est probablement aligné sur l'accusatif
Jules Ronjat préfère faire une
distinction entre l'origine de
Il me semble clair que cette substitution provient de l'action analogique
de mots comme flūmĕn
"fleuve", lūmĕn
"lumière", lĕgūmĕn
"légume", qui ont un accusatif en
-ūdĭnĕm
> -um
Conformément à ce qui est dit ci-dessus,
> (mutation vocalique) */
> (voie 1
ci-dessus, antériorisation
du u, nasalisation,
dénasalisation) */
> (apocope supplémentaire
possible, ou bien : solution de Ronjat
ci-dessus) */
Cette
terminaison s'est developpée en suffixe occitan (
Pour AO
amarum "amertume", il semble
curieux que le mot soit construit sur amar
+ -um, alors qu'il existe le français "amertume" < ămārĭtūdĭnĕm. On peut
toujours imaginer un amuïssement
de t interne atone,
suivi d'une simplification
ĭncūdĭnĕm > AO enclume, encluge "enclume"
- Les formes galloromanes contiennent l : il y a eu action de inclūdĕrĕ (FEW 4:633a).
- Pour la terminaison -uge,
(FEW 4:633a) propose *inclugine.
Je pense qu'il y a eu action analogique
de ĭmāgĭnĕm
(> image) pour aboutir à *inclugine dans une partie du
domaine d'oc.
-ĭtūdĭnĕm > -tum, -dumne...
consuētūdĭnĕm > AO costum, cosdumne "coutume", AO costuma, cosduma, costumna, cosdumna "coutume".
Les formes en -d-
témoignent d'une syncope réalisée après la
sonorisation
de
ND-N :
Lŭndĭnŭm
> Londre "Londres", voir aussi "Londre" < ŏnŏrĕm
? : N-R
ci-dessous.
RD-N :
ŏrdĭnĕm > orden, òrdre.
cŏphĭnŭ(m) > còfre "coffre"
ŏrphănŭ(m) > AO orfe "orphelin"
răphănŭ(m) > AO rave(n) "raifort cultivé" ; a.fr. rafne, ravene, reve (voir "ravenelle") (răphănŭs : f > v).
Stĕphănŭ(m)
> Estève "Étienne" ; Stĕphănă(m) > Estevena
(Stĕphănŭs
: f > v).
Pour Stĕphănăm > Estevena
: voie 4 ci-dessus (basculement d'accent
ci-dessus).
En domaine d'oc, plantāgĭnĕm "plantain" suit la voie 1 ci-dessus (apocope de type occitan) ; en domaine d'oïl il y a syncope : plantāgĭnĕm > *[plantayné] > *[plantayn] > (évolution semblable à plēnŭm) [plãtè̃].
plantāgĭnĕm > plantage / pr.ma. plantai (voir les évolutions dialectales de ge, gi).
ĭmāgĭnĕm > AO emagena, emage "image", AO maina, a.frpr. esmaina (FEW 4:464b)
virgĭnĕm > vierge "virjne" 1119
(gu est systématiquement dans le groupe ngu).
inguen : ĭnguĭnĕm > engue "aine"
Lĭngŏnĕm > Langres
Voir évolution de mn secondaire.
Les mots latins concernés sont assez nombreux.
L'apocope peut s'exercer (voie 1
ci-dessus- : hŏmĭnĕm > òmen >
òme (il faudrait étudier la disparition ou non de la voyelle
finale
Ou bien la syncope : (voie 2 ci-dessus) fēmĭnăm > femna, éventuellement
avec vocalisation : lāmĭnăm >
launa "lame".
Ou bien la syncope avec rhotacisme n > r : (voie 3 ci-dessus) fēmĭnăm > *femra, puis > frema "femme".
Ou bien le basculement d'accent : (voie 4 ci-dessus) fēmĭnăm > AO femena, et tous les verbes (type ĭntāmĭnārĕ ci-dessous : ĭntāmĭnăt > entamena "il entame").
Remarque : en latin ancien, une syncope s'était déjà
produite dans *fēmĭnellă > fēmella "femelle" (elle ne laisse
même pas de trace sous forme de gémination de m : à étudier).
dŏmĭnŭm
(syncope précoce ci-dessus)
exāmĭnĕm
> eissame, eissam "essaim"
fēmĭnăm > fema / fena / frema "femme", variante AO femena (voie 4 ci-dessus : basculement d'accent).
flūmĭnĕm
> flume, AO flum,
(a.fr.) flun
"fleuve"
grāmĭnĕm
> grame "chiendent"
hŏmĭnĕm > òm, òme "homme"
lāmĭnăm
> launa / lama "lame, plaque"
lĕgūmĭnĕm
> leume, lieume "légume", voir lĕgūmĭnĕm (à g
intervocalique)
lĕvāmĭnĕm > levame "levain"
lĭgāmĭnĕm
> liame, a.fr.
leien "lien"
lūmĭnĕm > lume "lumière"
nōmĭnĕm > AO n
stāmĭnĕm > AO estam "étain ; chaîne de tisserand", estame "tricot bien fait" (FEW 12:229b), a.fr. estain, estrain "chaîne d'un tissu, etc."
tĕgmĭnĕm > tèume "portion de tillac formant une sorte de cabane à l'avant d'un bateau non ponté" (TDF), voir gm.
Évolution avec n
> r :
(voir n > r après consonne)
*fēmĭnă(m) > femna > *femra > (pr.ma.) frema : il semble y avoir eu métathèse de type comprar > crompar.
L'évolution n > r est très
développée dans le type espagnol :
hombre, hembra, legumbre, lumbre
(alumbrar), siembra (< seminam), hambre (< *fāmĭnĕm), nombre
(< nōmĭnĕm), estambre...
Pour les
verbes : le type avec basculement d'accent est de règle dans la
majorité du domaine occitan (voie 4 ci-dessus).
Mais une alternance de type masticar
/ maschar (ci-dessus) existe.
*ăllūmĭnārĕ > AO alumenar / alumar ;
examĭnārĕ > AO aysamenar,
essamenar ;
ĭntāmĭnārĕ > OM entamenar, auv entamnar, d entanar ;
sēmĭnārĕ > OM semenar, samenar "semer" / auv, pér semnar, lim sennar, sannar / (voie 5) béar semiar, samiar, somiar / gasc semoar, samoar.
Le type portugais semear (< sēmĭnārĕ) suit aussi la voie 5, avec semeio (< sēmĭnō) : basculement d'accent et yod épenthique. En béar, semiar, samiar, somiar montrent ea > ia, somiar provient des labialisations ; sans doute gasc semoar aussi.
Aussi port. allumiar (< *ăllūmĭnārĕ), anc. port. alumẽar, gallicien alumear.
RM-N
:
terminum > tèrme
MP-N :
pampinum > pampe
tympanum > timbre
RP-N :
carpinum > caupre, carpe ; fr. charne, charpe, charme
.
ăsĭnŭm > ase / ai / aine (schémas ci-dessus)
ăsĭnăm > asena (basculement d'accent ci-dessus)
KS-N : fraxinum > frais, fraisse "frêne"
LS-N (calsinum > causse)
SS-N : cassanum > casse ; chêne
PS-N :
lapsănăm > lassena (voie 4 ci-dessus)
botinăm (ou bodinăm) > boina "borne, bosne"
*catănum > cade
pătĭnăm > (l) (g) padena "poêle"
plătănŭm > blai, rouerg blasi,
Vel
bladre. Voit discussion
sur le devenir du -t-.
Protinus > prodol (< protelum) ; prosne
Retină > (regna?) "Rêne, resne"
*tautĕnŭm > AO taute ;
*tautĕnăm > tautena "calamar" (teuthís τευθίς "calamar") (basculement d'accent ci-dessus).
pătĭnăm > padena "poêle" (basculement
d'accent ci-dessus)
CT-N :
pectĭnem > penche.
Voir jŭvĕnem > joine / jove.
Dans joine, il y a
vocalisation v > i.
Voir ci-dessus KS-N.
(LPA:9...)
(LPA:10)
NC-P :
(LPA:10)
principem > princep / prince
SC-P
(LPA:9-10)
FEW 3:231b-232a : (trad.all.) "Le nord de la France et les Grisons
ont pour base une forme raccourcie
FEW 3:232a : (trad.all.) "Le sud de la France a fait disparaître le e-, comme l'Italie et la Sardaigne ; voir
(AO) avesque, evesque, vesque : ce sont des formes empruntées au français (voir p intervocalique). (LPA:9-10)
(AO) bisbe, bispe, bibe : ces formes montrent bien une évolution régulière de p latin, cependant le i semble être le fruit d'une influence savante (LPA:10) : voir ĭ > é.
H.G. Herford indique que seul ebesque
TDF
répond à une évolution régulière de episcopum
(LPA:10). Cependant il s'agit d'une variante lang, et le v
est souvent prononcé b en lang. C'est donc sans doute
aussi un
(LPA:11)
cŏlăp(h)ŭm > colbe, còp
(LPA:11...)
*cannăpĕm > canebe, cambe, carbe, canube... "chanvre" (voir à Apophonies la forme kánnapis).
sĭnăpĕm > sẹnebe, sẹrbe
"sénevé"
(GIPPM-1:239)
Les groupes b-r, dz-r, z-r, montrent l'absence de syncope en occitan (apocope de type occitan ci-dessus) : cĭcĕrĕm > AO cẹze, cẹzer "pois chiche", a.fr. ceire (il y a eu syncope).
lat.tard. albărŭ(m) > *albĭrŭ(m) > pr aubera [ówbéro/a] "peuplier blanc" (FEW 24:296b-297a). Il y a basculement d'accent sur la voyelle post-tonique dans un mot féminin, voir ci-dessus basculement d'accent.
cĭcĕrĕm > AO cẹze, cẹzer "pois chiche", OM cese [sézé], a.fr. ceire.
dĭcĕrĕ > dire "dire"
cŏgnōscĕre > conóisser, conèisser "connaître" (voir verbes en -scĕrĕ)
Lĭgĕrĕm > la Lèira "La Loire"
mŭlgĕrĕ > AO
m
plangĕrĕ > plànher "plaindre", voir "ge en position forte", type plangĕrĕ > plànher.
Voir notamment les épenthèses de type n + r : cĭnĕrĕm > cenDre.
cĭnĕrĕ(m) > cendre "cendre"
gĕnĕrĕ(m) > gèndre "gendre"
ŏnŏrăt > onra, ondra, onora "honore",
Saint-Martin-de-Londres (34) < ŏnŏrĕm ?
etc.
Voir aussi ci-dessus Lŭndĭnŭm
> Londre.
Plusieurs toponymes montrent une absence de syncope avec basculement
d'accent.
Probablement Dusara, Dusera
> oc Donzèra "Donzère" (26) (Dusera,
année 817 ; Dozera, année 849
; Dusara, année 858) ("suffixe
pré-gaulois
Īsărăm > Isera / Isèra "Isère" (PHF-f2:147)
Scénario :
/iːsara/ (peut-être déjà /iːzara/ avec /z/)
> (pseudo-apophonie) /iːsira/, /iːzira/
> (i > é)
> (basculement
d'accent des proparoxytons féminins, s
> z) /izèra/
Ĭsărăm > fr "Oise"
(on peut supposer un i
bref comme PHF-f2:147, mais ī
est aussi possible, suivi d'un changement ī
> ē)
> Esera (VIe
siècle) > "Oise" (TGF1:39)
Voici mon scénario :
Ĭsărăm * /isara/
> (ĭ > é, affaiblissement
de a post-tonique) */éːs
> (s
> z, -a > -e, début type
"toile", pas encore de syncope sinon >
> (dialectal r > z,
comme chaire > chaise) */éi̯z
> (syncope, ou apocope au stade
*/éi̯zərə/ ci-dessus) */éi̯z
> (suite type
"toile") /waz
Lesŭră > (métathèse ?) Losera / Losèra "Lozère" (chaîne de montagne des Cévennes, puis département) (PHF-f2:147).
(TDF : "Lausero", F. Mistral rattache le mot à lausa, lausera "roche qui se délite en pierres plates", par erreur ou par étymologie populaire).
*Vĭsărăm, Vĭsĕrăm
(Visera est attesté en l'an
889) > Vesèra "Vézère"
(rivière de 19 et de 24) (PHF-f2:147).
LV-R :
sŏlvĕrĕ
> AO
s
Voir composés en
Voir Nemausŭs (emprunts au gaulois). C'est l'étymon de Nimes "Nîmes".
(LPA:13)
(LPA:13)
cubitum
debitum > deute, deude
dubitum > doute
gabata > gauta
male habitum > malaut
BB-T
sabbatum > sabte (dissabte)
RB-T
cucurbitam > cogorda
(LPA:17)
placitum > plait, plach... "querelle ; procès..."
vocitum > vuege "vide"
(métathèse
T-C) Atacĕm > *Adaze
> *Azade > Azde > Aude (LNDFA), voir 3es
palatalisations, voir sonorisation
de t.
plăcĭtŭm > "plaid" (> plaider, plaidoyer)
explĭcĭtŭm > "exploit"
făcĭtĭs
> "(vous) faites", dīcĭtĭs >
"(vous) dites"
fīcātŭm > fĭcătŭm
> ficitu > (métathèse) fiticu
> fetge "foie", voir fĭcătŭm ("Abrègement de
certaines voyelles longues ?").
En préalable, il faut remarquer que l'AO comme l'AF ont des terminaisons identiques pour "vide" < *vŏcĭtŭm et pour "froid" < frīgĭdŭm :
- AO vueg (1) / *boit, fém vueja / boida (2) ; AF vuit, fém vuide ;
- AO freg (1) / freit, fém freja / freida (2) ; AF freit, fém freide.
(1) Le
(2) Les variantes fém *boit, boida "vide" sont gasc, bien attestées dans la langue contemporaine, voir carte ALF:1384 "vide". Concernant les variantes masc pour "froid", l'AO n'a que freg et freit, frei. La large répartition actuelle de fret [frét], hret [hrét] en gasc actuel est probablement issue d'une monophtongaison assez tardive de freit, hreit. Le type freit est conservé en Gironde, mais aussi dans le Puy-de-Dôme et dans les Alpes (carte ALF:612 "froid" ; il est dommage que le féminin n'y soit pas représenté ; il n'est question que du seul substantif "froid").
Ainsi cette constatation doit pouvoir aider à proposer un scénario pour l'évolution obscure de *vŏcĭtŭm, qui est sans doute similaire à l'évolution de frīgĭdŭm (ci-dessus).
Pour fr "vide" ; a.fr. vuit,
fém
vuide ; AO vueg, v
Cependant l'évolution détaillée
Pour a.fr. vuit "vide", les scénarios sont de deux types :
- attraction précoce par -ct- comme dans factus (ce scénario me semble improbable) ;
- évolution précoce -citus >
-gitus (influence de digitus
?) (ce scénario me semble très bien convenir).
La diphtongaison de ò :
Il y a diphtongaison ŏ > ʋò non seulement en français (a.fr. vuit "vide"), en occitan (AO vueg > vueje), en catalan (buit). Dans tous ces cas, on a affaire très certainement à la diphtongaison romane conditionnée par y.
Pour l'italien, vuoto
est trompeur : la diphtongaison originelle est vòito
(FR:292,
LDIL:70). La diphtongue dans vòito
s'est réduite : > voto, et
vuoto est une hypercorrection
qui ne s'est pas diffusée avant le XVIIe siècle (
*vŏcĭtŭ(m)
> */voyito/ > voito > voto > vuoto (LDIL:70)
L'italien accepte difficilement les
diphtongues
Voir aussi plăcĭtŭm > piaito > piato "plaid" (FR:292).
- Pour le français :
Pour le français, G. Straka (DLR:257), suivi par F. de La Chaussée (IPHAF:112), donnent une
(scénario peu probable selon moi) |
|
| > (début
IIIe siècle : |
|
| > (évolution
kt > yt)
*/vò |
|
| > (diphtongaison
romane
conditionnée par y)
*/vʋòytʋ/ |
|
| > */vuit/ |
→ a.fr. vuit Renart |
Cependant, le scénario
ci-dessus n'explique pas d
dans le fém voide
(Roland), masc
vide (Renart). Le modèle analogique pour */vòktʋ/, à
savoir factum, a abouti à
"fait, faite", donc */vòktʋ/ aurait dû aboutir à masc vuit,
fém
D'un autre côté, Fouché donne une première étape précoce vŏcĭtŭ(m) > */vogitʋ/ (PHF-f3.:609).
(scénario très probable selon moi) |
|
| > (réfection ?) /vógitʋ/ |
|
| > (1e moitié du IIIe siècle : spirantisation de g devant i puis > yy) */vòyyitʋ/ | |
| > (vers
l'an 400 : sonorisation
de
t)
*/vòyyidʋ/ |
|
| > (vers la
même époque : diphtongaison
conditionnée
par y)
*/vʋòyyidʋ/ |
|
| > (syncope,
protégeant d de
l'amuïssement) */vʋòydʋ/ |
|
| > (réduction
de la triphtongue ʋòi
>
ʋi, mutation
-ʋ
> -ó) > * /vʋèidʋ/
> */vʋidó/ |
|
| > (VIIIe
siècle : apocope,
antériorisation
du
ʋ) */vuid/ |
|
| > (durcissement
de
la consonne devenue finale) */vuit/
|
|
| > (vers
l'an 1200 : bascule
des diphtongues) */vüit/ |
→ a.fr. vuit Renart |
| > (analogie sur le féminin ci-dessous) */vüid |
|
| > (réduction de la diphtongue) /vid |
→ masc vide |
| vŏcĭtă(m) |
|
| > (VIIIe siècle : pas d'apocope au
féminin) */vuid |
→ fém vide |
- Pour l'occitan :
Pour expliquer AO vueg, v
| > |
|
(LPA:15)
*adsĕdĭtăt > (s')assèta
"(il s')assoit" (voir verbes en
Le verbe
Pour le français, les exemples suivants ("assied", "assiette", "empiéter", "piéton") montrent que la syncope est postérieure à la diphtongaison romane spontanée.
> (diphtongaison,
possible par l'absence d'entrave) *assiedita (possiblement [assiè̯
> (syncope) *assiedta > *assietta
> (vers l'an 400 : la sonorisation est empêchée par l'entrave de tt) *assietta
> "assiette" (CNRTL "assiette")
pĕdĕs, -ĭtĭs "piéton" →
*pĕdĭtārĕ > fr
"piéter" (CNRTL
"piéter") (voir "piéton", "empiéter") (voir verbes en
pēdĭtŭm > oc pet "pet, vent", fr "pet"
cŭpĭdĭtās → *cŭpĭdĭĕtāt > AO cobeja, cobeita et fr "convoite" < a.fr. coveitie (CNRTL: "convoiter") (voir aussi à P-D ci-dessus : cŭpĭdŭm)
(LPA:17)
Agăthăm > Agde ; Ata dans Sancha Ata retranscrit en "Saint-Chaptes" (30)
Voir aussi ci-dessus frīgĭdŭm.
cōgĭtăt > AO cuidar, cujar, cudar, cutar "croire, penser" : voir évolution de frīgĭdŭm avec les deux variantes freida et freja "froide".
Pour vīgĭntī "vingt", trīgĭntā "trente", quădrāgĭntā "quarante"..., voir g
Dans le schéma L-T, il existe Arĕlātĕm "Arles" (sans doute prononcé Arĕlātĕ), et également lat. hālĭtŭs "souffle, exhalaison ; haleine" semble avoir un descendant actuel : béar alet, alit "haleine, souffle" (TDF) : ce dernier doit être étudié (emprunt au latin ? ou héritage ? En tout cas esp. hálito, it. alito sont des emprunts au latin).
Le latin sŏlĭtŭs "habituel", sŏlĭtŭm "chose habituelle" (voir fr "insolite" emprunté au latin) ne semble pas avoir de descendant populaire en occitan, contrairement à sŏlērĕ "avoir coutume" > oc soler.
Le latin călăthŭs "panier, corbeille" a des
descendants en
Arĕlātĕm "Arles"
(EPF:123 et suiv., ETP:58-61)
Quel étymon ?
En provençal, le nom de la ville est Arle [arlé] (le
D'abord, il faut remarquer que les étymons latins ci-dessous ne
présentent pas la voyelle apophonique, sinon aurait
Selon F. Gaffiot (DGF:157),
Ausone (292) emploie
Normalement, c'est l'acc.
Arĕlātĕ(m) qui a donné pr
Arle "Arles" ; cependant Arĕlātĕ(m) aurait dû
donner
Certes, la filiation nom. Arĕlăs > pr Arle est tentante, mais Antoine Thomas (EPF:124) la réfute :
"1° Il n'existe pas un seul exemple de formation d'après le nominatif dans les noms de lieu ;
2° La correspondance phonétique entre
Arelas et Arles
n'est qu'apparente. Ce dernier point demande à être développé. Si Arelas était le point de départ de
la forme vulgaire, le nom provençal ne pourrait être que Arlas.
Or, en ancien provençal, comme en provençal moderne, on dit Arle
et non Arlas. Dès le XIIe
siècle, on lit dans une chanson de
Charles Rostaing donne un troisième argument (ETP:59) :
"Aux objections d'A. Thomas, on peut ajouter qu'Arelas est une forme savante créée par des poètes."
En effet Ch. Rostaing déduit des occurrences
latines que la forme
Problème de l'accent tonique
Dans pr Arle, l'accent tonique sur le a initial peut s'expliquer de deux manières :
- Selon Antoine Thomas (EPF:125), le nom. Arĕlăs > (syncope au contact de r, fin IIe siècle) Arlăs a influencé l'accentuation sur l'acc. Ar(ĕ)lātĕ(m) > Arlătĕm (voir le cas semblable : prĕsby̆tĕrŭm > *prĕsbĭtrŭ > "prêtre", PHF-f2:467).
- On connaît de nombreux noms de villes en France qui ont
conservé un accent particulier gaulois (voir Remarques
sur les emprunts au gaulois) ; certes peut-être pas de
quadrisyllabes avec l'accent sur l'initiale, comme un
Problème de la disparition de t
Après la syncope *Arelate > *Arlate, le second a a évolué en e : *Arlete, peut-être en passant par *Arlite : voir a en pénultième de proparoxyton. Comment expliquer l'évolution *Arlete > Arle ? Concernant arlatenc "arlésien", il est probable que ce soit une adapation savante de AO arlenc.
1. Pour expliquer la disparition de t, Antoine Thomas (EPF:124) propose le scénario *Arlede > (métathèse) *Ardele > *Ardle > *Arlle > Arle.
Cependant selon Albert Dauzat (NLOÉ:57, note 3), la métathèse dont il est question n'est pas possible : "La phonétique ne permet pas d’admettre la métathèse proposée par M. A. Thomas (Essais, 124)." A. Dauzat ne développe pas cet argument : pourquoi cette métathèse serait-elle impossible ? Je pense que cette métathèse *Arlede > *Ardele n'est pas à écarter.
Je développe le scénario d'Antoine Thomas :
Arĕlātĕ(m)
> (syncope ancienne) *Arlātĕ
> (influence du nominatif : déplacement d'accent sur la 1e syllabe) *Arlātĕ
> (t > d, affaiblissement a > e) *Arlede
> (métathèse)
*Ardele
(On peut aussi placer la métathèse avant t > d : *Artale > *Artle > Arle)
> *Ardle > *Arlle > Arle.
2. H.G. Herford (LPA:20) estime que l'
3. Il existe une troisième solution pour expliquer la disparition de t, qui est sans doute plus convaincante : il est tout à fait envisageable que *Arlede évoluât en *Arlee > Arle (voir le cas particulier où t intervocalique > ∅ au sud). C'est d'ailleurs le scénario proposé par Charles Rostaing :
(ETP:60-61) "Arlate a donné d'abord *Arlede
: l'exemple de Mimate > Mende nous prouve que la chute de a
post-tonique a été postérieure à la sonorisation des sourdes
intervocaliques ; le
(LPA:18 : pour l'autre, -m-t- > -nd-)
La quasi-totalité des mots occitans ci-dessous montrent un aboutissement en -nd-. Cela montre qu'une syncope s'est réalisée après les sonorisations.
Pour cŏmĭtĕm "comte" :
influence savante ? syncope précoce ?
ămĭtăm > AO amda
"tante" (a.fr. ante, ang.nor. aunte)
*Arenemĕtŭm > Arnempde > Arlempde (43)
*Cassematem > Chassemde, Chassempde > Chassende (43, "terroir de la commune d'Ours-Mons", NEPF:49)
cŏmĭtĕm > AO cọmte
"comte", nom cŏmĕs
> AO
CR
coms.
dŏmĭtŭm > AO domde "dompté"
*fĕmĭtăm > AO fẹnta,
fẹnda, fẹmta, fẹmda, fienda "fiente"
Mĭmătĕm > Mende "Mende" (48)
RM-T
*tĕrmĭtĕm > tèrtre "tertre, colline"
(LPA:18)
anatem > anet "canard"
gĕnĭtŭm > gent, gen ; gĕnĭtăm > genta.
*vanito ? > van "vanterie"
GN-T
cognitum > coinde, cuende, conhde, cointe, conge "joli, gracieux, aimable"
RN-T
*Cornate > Cornde, Corde, Conde (hameau de la commune de Bains (43).
(LPA:13)
MP-T
compŭtŭm > AO cọmte,
cọmde, cọnde "compte"
SP-T
hŏspĭtĕm > oste, osde
(LPA:16)
pŏsĭtŭm > post
prepŏsĭtŭm > prebost, prebosde
(LPA:19)
spīrĭtŭm > AO espirt
: c'est la forme héritée, esperit
semble emprunté mais je me demande s'il n'y a pas eu métathèse espirt
> esprit (> esperit ?) ; en tout cas il est évident que
ce mot a une dimension savante chrétienne.
(LPA:15)
Brīvātĕm > Briude "Brioude" (43) : en latin classique, on a Brīvās, Brīvātĕm mais :
- soit son origine gauloise explique
l'accent sur la première syllabe (
- soit l'accusatif a évolué sur le modèle du nominatif, comme il a été proposé pour Arle (ci-dessus), donc l'accent se serait porté sur la première syllabe : *Brīvătĕm.
Il faut remarquer que la syncope s'est réalisée après la sonorisation (Brīvātĕm > Brivade > Brivde >
Briude), contrairement à ciutat
(< cīvītātĕm). Par contre,
en espagnol, cīvītātĕm
> ciudad comme pour Bīvātĕm
> Briude.
(GOG:63) "Genava,
la forme la plus ancienne à laquelle nous puissions remonter, était un
Remarque : l'accent du mot allemand est un argument critiquable car l'allemand accentue tous les mots sur la première syllabe ; mais a.fr. Genve(s) (ci-dessous) est un meilleur argument.
(LNB:36) "César nous a transmis dans le De
Bello Gallico le nom latinisé de l’une des trois capitales des
Allobroges, Genève (les deux autres étant Vienne et Cularo / Grenoble).
Les manuscrits de César proposent deux formes GENAVA et GENUA. Qu’ont
fait les linguistes français ? Ils ont appliqué les lois évolutives du
français de Paris, en partant du mot latin GENAVA et en ont obtenu très
facilement Genève. C’est enfantin : il suffit d’accentuer GENĀVA sur la
deuxième syllabe en lui donnant un a
long et appliquer les lois les plus simples de la phonétique
évolutive de la langue d’oïl pour l’explication d’un mot qui n’est pas
en domaine d’oïl, mais en domaine francoprovençal. L’explication était
si simple qu’elle a convaincu les latinistes eux-mêmes, si bien qu’un
excellent dictionnaire latin-français (le Gaffiot) accentue GENĀVA sur
la pénultième en lui donnant un a long. [...] Appliquons à un mot
francoprovençal la phonétique francoprovençale et tout ira mieux." (Le
texte comporte par la suite une erreur puisqu'il donne la forme
phonétique latine de référence : ['genaːwa] avec accent sur ge
et avec a long, alors que
l'auteur veut donner un a
bref).
Il me semble qu'on peut raisonnablement penser que :
- Gĕnăvă était un toponyme étranger au latin (a bref en pénultième) ;
- Lorsqu'il a été emprunté par le latin,
sans doute à une époque très ancienne (latin archaïque ?), par apophonie
(ă
> ŭ) il a évolué en [gén
Les auteurs ci-dessus (GOG:63, LNB:36) dégagent trois voies d'évolution :
Voie 1 : (syncope) Gén(e)va > a.fr., vaud Genve(s), Genvre(s), > all Genf.
Voie 2 : (apocope) Géne(va)
> vaud
Genne(s), adjectif Génois.
Voie 3 : (basculement de l'accent) : Géneva > Genéva > Genève.
Voir ci-dessus : Cannapis >
canebe, Jacobus > *Jacomus > patr.sav. Jaquemoz
(Jaquème).
Dans "Genève", pour l'explication du e
en deuxième syllabe, comme dans canebe,
Jaquemoz : il s'agit d'une neutralisation
de la syllabe post-tonique (apophonie) : /a/ (forme Gĕnăvă)
ou /o/ (forme *Gĕnŭvă) > /