(GIPPM-3:408-516)
Cette partie traite de deux thèmes très différents : d'une part la normalisation orthographique des mots composés ; d'autre part la morphologie historique de ces mots. C'était d'abord une partie purement axée sur l'orthographe, puis j'ai intégré des notions de morphologie historique (encore peu développées).
Ce double aspect me semble convenable : il évite de chercher dans le site l'un ou l'autre aspect : tout est réuni ici.
Cette partie traite aussi des mots préfixés (ci-dessous : limites entre composition et préfixation).
La structure de l'exposé ci-dessous présente des redondances volontaires, afin que le lecteur puisse trouver facilement le cas qu'il recherche. (Exemple : "II. Nom et adjectif" contient Aigas Mòrtas ; "VIII. Noms de lieux" contient aussi Aigas Mòrtas).
La limite est floue entre composition
et préfixation (dérivation par
préfixation). Cette partie traite de la composition, mais la préfixation
y est également largement abordée, voir notamment ci-dessous adverbe
(ou préfixe) et autre composant. La définition d'un préfixe est :
(
Cette définition n'est pas suffisante pour discriminer la préfixation de la composition. Aussi les linguistes ajoutent-ils qu'un préfixe est non-autonome (ORSCC:745 et sous-entendu dans PCLO:53), c'est-à-dire qu'il ne peut exister de façon isolée : "re-", "dé-", "hypo-" n'existent pas de façon isolée. (Je précise que les mots familiers comme "super", "ex" pour "ex-mari"..., "re" pour "re-bonjour", bien qu'apparus comme éléments autonomes, conservent bien sûr la nature de préfixes).
Mais là encore, cette propriété de non-autonomie n'est pas suffisante : plusieurs verbes, noms, adjectifs, adverbes ou prépositions sont reconnus pour avoir la valeur de préfixes (ci-dessous) ; on peut dire alors que ces mots "peuvent néanmoins assumer des emplois non autonomes" (POP:68 pour les prépositions). Ainsi des "éléments formants" occitans peuvent être considérés comme des préfixes :
-
-
-
-
-
-
On peut distinguer différents degrés dans la nature du préfixe : dans une étude sur "avant-", "après-", "contre-", "entre-", "sans-", "sur-" et "sous-" (1), D. Amiot conclut que "sans-" présente de nettes caractéristiques de préposition, et s'éloigne de la nature de préfixe. L'auteur conclut (POP:77-78) : "Il paraît donc exister une sorte de continuum entre la classe de la préposition [entrant en composition] et celle du préfixe ; ce qui peut se représenter par le schéma suivant : [schéma ci-dessous]".
(1)↑ Pour le français, l'auteur cite : avant-scène, après-dîner, contre-exemple, entrefilet, sans-abri, surdoué, sous-évaluer... En occitan on peut citer : après-dinnar, còntradire, entredurbir, sensa-biais, subrecargar, sotanòvi...
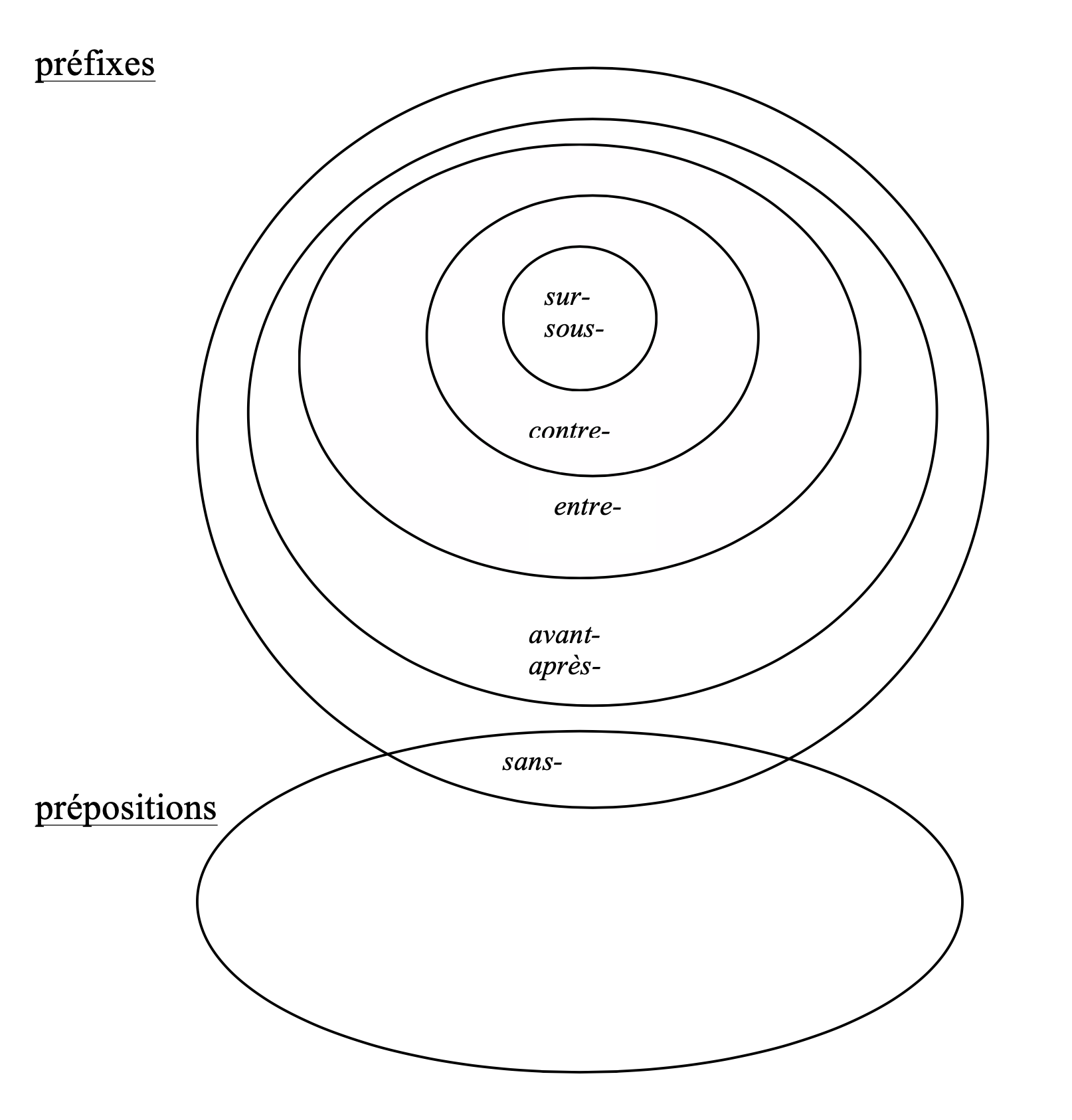
Schéma ci-dessus. Les
éléments d'origine prépositionnelle en français. "Il paraît
donc exister une sorte de continuum entre la classe de la préposition et
celle du préfixe" (d'après Dany Amiot, POP:78). On constate que la plupart des
prépositions sont classées dans les préfixes, mais
La formation de mots composés s'est réalisée à toutes les époques ; on peut la mettre en évidence dès l'indo-européen, et elle se réalise encore de nos jours. Je voudrais introduire ici des notions de composition aux époques anciennes (latin archaïque, latin d'époque classique).
À développer. Voir FCNL.
Pour le moment, je renvoie notamment à La composition déclenche l'apophonie (Apophonies).
Voir aussi ci-dessous le type còlimòrt
(éléments reliés par
Pour qui l'a déjà étudié de façon approfondie, le domaine des mots
composés à l'écrit s'avère d'une complexité redoutable. Il illustre
parfaitement les difficultés auxquelles sont confrontés les normateurs
de la graphie d'une langue, langue qui se moque souvent des schémas
pré-établis pour en créer de nouveaux. Par exemple ailamontdaut "(tout) là-haut"
montre une histoire longue et complexe de composition depuis le latin :
Pour écrire une unité lexicale composée de deux mots ou plus, on
-
laisser les mots séparés ; on a une
(voir aussi ci-dessous dénomination) ;
- unir les mots par un trait d'union
(un jonhènt) ; on obtient un
composé à trait
-
souder les mots : on obtient un univerbé (ou composé
- certains mots composés mêlent les divers
procédés : fr "qu'en
dira-t-on", "aujourd'hui", oc
mau-t'en-vòli "quelqu'un qui
vous veut du mal", oc tòca-l'ase "traquet (oiseau)".
Le document PCLO (53-60) propose une norme écrite pour les
mots composés (source archivée ici
: L'ortografia dels mòts compausats
et del jonhent). Ce document donne les grandes lignes, mais le
lexicographe est vite confronté à ses limites. Il peut alors se tourner
vers le DOGMO, bien que celui-ci contredise parfois le PCLO (Puèglaurenç,
PCLO:54, Puèg
Laurenç, DOGMO:933). J. Ubaud (DOGMO:131) admet d'ailleurs que le problème des
mots composés n'est par définitivement résolu.
Je présente ci-dessous une réorganisation et un approfondissement de la
réflexion sur la norme concernant les mots composés.
La norme classique apparaît complexe. Mais elle obéit à quelques règles générales logiques et elle est le fruit d'une réflexion collégiale.
Le sujet des mots composés est complexe, et je pense qu'on peut admettre une marge de tolérance pour la plupart des situations présentées ci-dessous. Par exemple, on pourrait accepter una tèsta negra ou una tèsta-negra, et même de tèstas negras / de tèstas-negras en regard de la norme una tèstanegra, de tèstanegras, voir ci-dessous composés exocentriques. Cependant l'objet de cette partie est quand même de proposer une norme ; on y verra aussi une étude sans doute utile de tous les cas possibles.
Voir aussi commentaires
sur le trait d'union ci-dessous.
La norme mistralienne apparaît plus simple, avec l'utilisation
majoritaire du trait d'union, et l'absence du
Dans certains cas, la norme mistralienne apparaît plus logique que
celle proposée par le PCLO ; ainsi je propose certains ajustements pour
la norme classique en rejoignant F. Mistral : a-Dieu-siatz (et non adieu-siatz),
s'en anar =
s'enanar, belèu,
bessai.
Voir ci-dessous un regard sur les
mots composés en français.
Même pour le français, langue beaucoup plus unifiée que l'occitan, de
nombreux cas sont en quelque sorte irrésolus. La réforme de
l'orthographe de 1990 n'a que peu clarifié les choses. Cela a entraîné
finalement la coexistence d'au moins deux formes pour de nombreux mots ;
certes cela peut être considéré comme un assouplissement de la norme.
La question des majuscules est
abordée dans cette partie ; voir notamment dénominations
toponymiques, adjectif sant.
(Aussi ci-dessous : types Manjafanga,
Joan-que-saup-tot).
Selon leur ancienneté et selon leur degré de soudure, l'évolution des
- perte de l'accent
tonique dans le premier élément ;
- apophonie
(fermeture des voyelles devenues
- transformation des diphtongues devenues atones ;
- syncopes, haplologies (Clarmont-Montferrand > Clarmont-Ferrand) ;
- etc.
(PCLO:53) "Cada còp qu’es possible, los formants son soudats: pòrtamoneda, antisismic, preseleccion."
Dans les univerbés (mots soudés), on fait
confiance au lecteur pour décrypter la composition. C'est-à-dire qu'à la
lecture, par exemple dans pòrtamoneda "porte-monnaie", il ne
prononcera pas forcément l'univerbé selon les règles générales de la
graphie classique : le a
intérieur sera atone et prononcé [ò], [
(PCLO:57-58)
Par exemple pòrtamoneda
"porte-monnaie" se prononce avec pòrta
prononcé comme pòrta "il
porte" (avec -a [ò], [a], [
(PCLO:57) "D’un biais general la causida de Loís Alibèrt en fach de compausats es de favorir la fusion en un sol mot. La causida alibertina demanda que lo legeire siá capable en règla generala de reconéisser los compausats. Cal saber que pòrtamoneda, passavelós son de compausats per prononciar condrechament l’-a finala del primièr formant (coma una atòna: tipicament [ɔ])."
Dans certains composés, dans certaines
régions, pour
Les consonnes initiales r- et s- sont prononcée "dures", comme si elle restaient bien au début d'un mot.
Par exemple dans tiraregas
"tire-lignes (instrument de dessin)", le second r se prononce
[r] et non [
Par exemple antisismic se prononce avec s dur [s] et non [z].
Pour un problème semblable, voir ci-dessous
le préfixe d'origine latine a-,
pour lequel on redouble r ou s (arrestar,
assaborar, assimilar), le préfixe d'origine grecque
À part quelques rares cas (Entraigas
< Entre Aigas) et les cas d'haplologie
comme pòrtavions, aigardènt...,
la
graphie laisse le contact entre voyelle et voyelle. Cependant à la
prononciation, l'élision
peut se faire ou non, selon les cas.
L'élision atteint la plupart des composés de ce type.
(PCLO:57-58)
Par exemple dans contraofensiva, rèireoncle "grand-oncle", la voyelle finale du premier élément ne se prononce pas. Cette élision ne se note pas à l'écrit.
(PCLO:57, j.m.c.g.) "L’elision se nòta pas e se fa
fisança al legeire per reconéisser cada element: contraofensiva
[,kuntrufen'si
Aquò val quitament dins los compausats
que son segond formant comença per una vocala accentuada: curauèlhs
[kyr'ɥɛls], gripaòme [gri'pɔme], subreòs [sy'
Ça
que
la l’elision se nòta dins los
toponims quand es plan fixada per la tradicion: Entraigas (e non
Entreaigas
Par exemple dans pòrta
+ avions > pòrtavions, l'élision
se note à l'écrit. On peut considérer cette élision comme une haplologie
écrite.
Exemples (PCLO:59) :
pòrtavions (< pòrta
avions)
manjagaças (< manja
agaças)
subrendeman (< subre
endeman)
centreuropèu (<
centre europèu)
telaranha (< tela
aranha)
aigardènt
(< aiga ardènt) (voir ci-dessous aigardènt)
Ribauta (< Riba Auta) "Ribaute" (11)
Autres exemples :
(dans les cas ci-dessous, on peut considérer
qu'il y a élision de
ailabàs (< ailà abàs)
ailamont (< ailà
amont)
ailavau
(< ailà avau)
C'est le cas de nombreux préfixes, qui
entraînent donc un
Que les voyelles soient différentes ou identiques, puisqu'elles sont prononcées, on les écrit dans tous les cas :
antiunionista, antiimperialista (PCLO:58).
(PCLO:58)
(j.m.c.g.) "Se pausa pas nimai de jonhent per notar l’iat entre la darrièra vocala del prefixe e la primièra del radical, mas un trèma se ne vira [?]: reünir, proïbir, coïncidir, Preïstòria, Protoistòria, infrauman, antiunionista.
Observacion - S’emplega lo trèma sonque après los prefixes leugièrs d’una sillaba (reünir, proïbir, coïncidir, Preïstòria) e se fa fisança al legeire per reconéisser los autres (Protoistòria, infrauman, antiunionista).
Se pausa pas nimai encara de jonhent per evitar lo contacte de doas vocalas identicas dins la prefixacion: antiimperialista, neooccitanisme, supraaxial, intraalpenc."
Pour
l'orthographe :
Dans les cas d'univerbation, on écrit les deux consonnes. Même dans les cas où les deux consonnes sont identiques : (l) cap pelat > cappelat "chauve".
Pour la prononciation :
Selon les mots et les dialectes, la consonne finale peut être encore prononcée ou non. Par exemple en Provence, on prononce généralement :
bèc [bè], d'où bècfin [bèfĩ] "oiseau passereau à bec fin" ;
cap Negre
[kanégré] "cap Nègre".
Le passage par un ancien stade avec consonne
Cas
d'assimilations consonantiques donnant des géminées
Dans certains dialectes à l'ouest du Rhône,
la deuxième consonne peut assimiler la première, donnant une
prononciation
capbal
(capval) (cabbal
caplevar
[ll] "faire la bascule" (TDF)
capmartèu (rouerg) [mm] "clou à grosse tête ; caboche" (TDF)
capmestre [mm] "grand-maître" (TDF)
capnegre
[kannégré] (cannegre
caprós
[rr] "rouge-gorge, en Gascogne" (TDF)
Il est possible que dans les autres régions,
dont la Provence, le stade de la consonne
bècfin
Capcau
(ou cap Cau ?)
Capnalha
(ou cap Nalha ?)
cap Negre
Une étude fine des anciens textes, notamment
dans la toponymie, pourrait apporter des renseignements.
Voir aussi les groupes
consonantiques.
En cas de rencontre entre
bòn + pas
"bon passage" > Bònpàs (avi84, [bõpas])
tan(t) + bèn > tanbèn "aussi" (mais esp tambien, cat també)
l'enbàs "la partie du bas"
En cas de rencontre entre
En cas de rencontre d'un préfixe en
Sur le plan de la prononciation, le préfixe semble plus systématiquement nasalisé (j'ai enregistré immortala avec i légèrement nasalisé alors qu'on dit [imòrtèl] en français).
Le contact entre une
Exemple : caprós
Par exemple cap
+ ros "tête + rousse" > caprós
"lotier (plante) ; rouge-gorge". Dans les dialectes prononçant encore cap [kap], il faudrait étudier
systématiquement la pronciation de ce type de composé. Il est possible
que dans certaines régions, pr
soit effectivement prononcé [pr]. Mais concernant le languedocien, PCLO:57 donne une assimilation
de la consonne finale à la suivante :
caplevar [ll]
caprós
[rr]
Voir ci-dessus : assimilations
consonantiques donnant des géminées.
Exemple : Montredon
Montredon
[mʋ̃rédʋ̃] < Mont Redon ("Mont Rond")
s'écrit en un seul mot : le PCLO:57 estime l'orthographe est assez claire en
soudant les deux mots. Il faut remarquer que le français Montrichard
(commune du Loir-et-Cher) se prononce Mon-trichard et non Mont-richard
(l'étymologie est incertaine, mais l'origine "Mont Richard" est
possible, avec un -t prononcé
en a.fr. et
fossilisé au contact de "Richard", voir par exemple Bourg-en-Bresse).
En
occitan, il est d'ailleurs possible que [tr] existe dans ce type de
composé : à étudier.
Donc on écrira :
Montredon
(< Montem Rotundum "Mont
Rond")
Montreiau,
Montreau... (< Montem
Regalem "Mont Royal")
Dans pieg
/ puèg "colline (puy)", mieg
demi", gavag
"gorge, gosier", le
Au contact avec r
ou l
Donc je propose d'écrire :
Pieg
Redon [p
Pieg
Ros [pyér
gavag
roge [gavar
etc.
Le problème est
le même pour Puèglaurenç
[pɛlljaurens] (81) (graphie
conforme au PCLO:54).
Il vaudrait donc mieux écrire Puèg Laurenç (graphie conforme au DOGMO) :
Puèg Laurenç "Puylaurens" (81) (ou Pellaurenç, voir ci-dessous), "Puilaurens" (11)
Je propose
donc une homogénéisation de traitement pour -g
+ r- / l- : on écrit le
composé toujours en mots séparés (locution) : Pieg
Redon, Pieg Ros, gavag roge, Puèg Laurenç.
Le DOGMO donne tous les composés en Puèg en mots séparés, mais je propose ce traitement seulement pour une ambiguïté de gr, gl ; on a donc Puègmejan, Puègvèrd, voir le paragraphe suivant.
Pour Puègmejan, l'ambiguïté de lecture est beaucoup moins marquée. Le DOGMO donne quand même Puèg Mejan : ce dernier ouvrage présente tous les composés en Puèg en locutions. Le PCLO présente donc un choix différent (puisqu'il donne Puèglaurenç). Il faut remarquer que de nombreux composés en Puèg / Pieg montrent des déformations dialectales, donc écrites en univerbés ; voir par exemple Peimian juste ci-dessous.
Puègmejan = Puechmeja, Pechmeja
miegjorn
[myédj
Pour les déformations dialectales, on soude
les mots (principe 6 ci-dessus) et on omet g :
Perreau [péréaw] (gar84) < *Podium Realem ;
Peimian [péymyã] (cio13) < *Podium Medianum ;
etc.
D'ailleurs, la commune ci-dessus Puèg Laurenç (81) ci-dessus peut s'écrire Pellaurenç puisque localement elle est prononcée [pɛlljaurens] (Wikipédia). Pour "Puilaurens" (11), je ne connais pas la prononciation locale en occitan.
Voir ci-dessous.
On évite
d'écrire deux consonnes identiques derrière une autre consonne :
pòstonic,
sanglaçar (et non pòsttonic
(PCLO:58)
"Observacion - S’evita
doas consonantas identicas darrièr una autra consonanta: pòstonic,
sanglaçar (e non pas pòsttonic
Mais pour
deux consonnes identiques devant une autre consonne, on conserve les
trois consonnes (je n'ai pas trouvé d'argument en faveur de
cette hétérogénéité de traitement) :
bèccrosat "bec-croisé (oiseau)"
capplumat
"chauve"
En général, le mot peut être lu "sans
nécessité de décryptage", puisque la liaison se fait : Mont
Aut > Montaut [mʋ̃taw].
Cette consonne pose problème, (voir
ci-dessus
(PCLO:57) Puèg
Orsin [pɥɛʃur'si] puslèu que Puègorsin.
"Ça que
la, en cas de problèma de desencodatge particularament fòrt, degut al
fach que la fusion en un mot es mai espandida pels toponims e congrèa
de rescontres de letras inacostumats, la notacion en dos mots pòt
èsser utilizada per lo resòlver: Puèg Orsin [pɥɛʃur'si], Borgon Nuòu
[burgu'njɔw en lemosin] (fr. “Bourganeuf”)... (puslèu que Puègorsin
Donc : pour
les composés en -g + voyelle, on écrira les mots séparés
(locutions). De façon moins normée, on peut écrire aussi les
composés avec ch, quand
celui-ci s'entend.
Puèg
Orsin (= Puèchorsin)
Pieg Aut (= Piechaut)
Pieg Aurós (= Piechaurós)
Pieg Agut (= Piechagut), Puèg Agut (= Pechagut) (30) ;
Pour les déformations dialectales, on soude
les mots (principe 6 ci-dessous) :
Pijaut (puj30), Piaut (mal84)... < *Podium Altum ;
Piegut (nombreuses communes) < *Podium Acutum ;
etc.
(PCLO:53) "L’abséncia de soudadura se fa en particular quand pòt i aver una flexion (marca del plural, del femenin, terminason verbala) a l’interior del mot compausat:
telefòn
mobil
> telefòns mobils
agre-doç
>
agra-doça
montar-davalar > monti-davali."
(PCLO:53) "S’evita
sovent lo jonhent per subrecargar pas l’ortografia: pòrtamoneda (e non
pòrta-moneda
Mon propos n'est pas de remettre en faveur le trait d'union, mais
simplement de faire quelques constatations.
- La surcharge imposée par les traits
d'union est quand même bien légère. Cet argument du PCLO est étrange ; je dirais même qu'il n'est pas
recevable. Le DOGMO:130 fournit le même argument : "écriture
bien lourde" (en parlant des traits d'union utilisés par F. Mistral).
- La défaveur pour le trait d'union conduit à quelques situations inextricables : voir ci-dessous rèire-maire-grand, où j'emploie le trait d'union malgré rèiregrand, et maire grand.
- La défaveur pour le trait d'union conduit à des situations contre-intuitives : par exemple dans les univerbés un pòrtavions, un manjacocordas, le s final peut sembler étrange. Il respecte pourtant l'origine du mot (un pòrtavions porte plusieurs avions) ; la présence d'un trait d'union eût été moins dérangeante : un porta-avions, un manja-cocordas.
- Cette norme s'oppose à celle du TDF qui utilise abondamment le trait d'union. Par
exemple : Vilo-nòvo
"Villeneuve", Castèu-nòu-de-Papa
"Châteauneuf-du-Pape", porto-fueio
"portefeuille". De plus en graphie mistralienne, les pluriels ne posent
pas de problème puisque le
- La graphie médiévale utilise le trait
d'union, moins que la graphie mistralienne, mais plus que la graphie
"classique" (avec des hésitations dans la norme : mieg-j
Voici cependant quelques emplois du trait d'union dans le domaine
lexical de l'AO (sources DOM) :
| argen-viu | "vif-argent, mercure" |
| branca-orsina | "branche-ursine, acanthe (plante)" |
| cocha-disnar | "celui qui hâte le dîner" |
| crop-en-camin | "qui s'accroupit en chemin, poltron" |
| fai-mi-drech | "juridiction" |
| meja-ser |
"sœur consanguine" |
| mieg-jorn
(= miegj |
"midi" |
| mieia-nuech | "minuit" |
| part-ier |
"avant-hier" |
| pe-dr |
"pied-droit" |
| peis-r |
"ombre, poisson" |
| pe-n |
"pied noir [nom de plusieurs espèces d'oiseaux]" |
| pe-verm |
"sorte d'oiseau [chevalier aux pieds rouges?]" |
| porc-espin
|
"porc-épic" |
| porc-marin
|
"porc‑marin [poisson]" |
| pres-fag
(= pretzfach) |
"prix-fait, forfait" |
| prim-caresme | "mercredi des cendres" |
| rata-penada
(= ratapenada) |
"chauve-souris" |
| sanc-de-drag |
"sang-dragon, résine" |
| sanc-fusion
(= sancfoiz |
"effusion de sang" |
| seis-vint
|
"cent vingt (six vingt)" |
| terra-maire
|
"terre" |
| testa-c |
"ante, sorte de pilier (?)" |
| testa-tondut
|
"qui a la tête tondue" |
| toca‑tocan
|
"côte à côte, en troupe serrée [en parlant de bestiaux] (?)" |
| torca-cul
|
"torche-cul" |
| torca-man
|
"essuie-main" |
| tori‑l |
"fête bruyante (?)" |
| vedel-mari
|
"veau-marin (phoque)" |
| vice-auditor (et vicecancelier, vicegeren) | "vice-auditeur ;
vice-chancelier ; vice-gérent" |
Tableau ci-dessus : quelques emplois
du trait d'union dans la graphie médiévale de l'AO
(sources DOM).
On trouve les cas "nom + adjectif" (rata-penada,
mieg-jorn), "verbe + nom" (cocha-disnar),
"nom + nom" (testa-cọa),
mots-phrases (fai-mi-drech
"fais-moi-le-droit"), etc. On trouve aussi sans surprise les hésitations
graphiques, avec les variantes rata-penada
= ratapenada, mieg-j
Dans un mot composé soudé, on laisse l'accent sur le premier élément (PCLO:60 Castèlnòu, Puèglaurenç).
À la lecture, cette graphie peut parfois mener à une prononciation
erronée, mais les situations sont diverses, et c'est quand même un
compromis acceptable. Examinons les cas de bònjorn,
còrsoitalian,
pròamerican :
Pour "bonjour", un provençalisant authentique pourra prononcer [bʋ̃djʋr], [bʋ̃djʋ]
(pr.ma.). La
fermeture [ò̃] > [ʋ̃]
(bòn > "bon") est un bon
argument pour écrire un univerbé : bòn
et jorn ont fusionné.
Cependant, faut-il écrire bonjorn
ou bònjorn ? Le problème est
que la prononciation [bʋ̃djʋr]
n'est
pas uniforme. Certains locuteurs prononcent [bò̃djʋr]
(pr.rh.). Le
choix normatif est la conservation de l'accent à l'écrit. Il faut
remarquer que ce choix va à l'encontre de la règle "l'accent graphique
correspond à l'accent tonique". Ainsi on pourra écrire :
bònjorn, lòngtèmps...
Remarque : vers l'ouest du Rhône, bòn
se prononce [bʋ̃],
[b
Exemple de còrsoitalian
:
Dans còrsoitalian, le ò peut porter un accent tonique
secondaire : còrsoitalian. Même s'il n'y
a pas l'accent : russojaponés. Voir
ci-dessous composés de type XoY, B.
Mais pour corsofòn
"corsophone" : on n'a pas affaire à un véritable composé, mais au schéma
: adjectif (còrse) + suffixe -fòn > corsofòn
/k
Exemple de pròamerican
:
Dans pròamerican, prò-
est un préfixe tonique : pròamerican (idem pour pòstoperatori, etc.)
Remarque : accent rajouté sur le deuxième
élément
Parfois on doit mettre l'accent graphique pour assurer l'accent tonique
sur le deuxième élément.
Par exemple PCLO:57 donne caprós
"cap + ros" (mot à mot "tête rousse", nom du lotier (plante),
du rouge-gorge... : composé
exocentrique).
cap ros > caprós
(loc.adv.) en bas > (n.) enbàs.
Les dérivés de composés sont écrits en
un seul mot :
(PCLO:55) "Lo
jonhent s’emplega pas dins los derivats de compausats (que son eles
escriches en mai d’un mot). Aqueles derivats de compausats s’escrivon
soudats:
aiga senhada >
aigasenhadièr
fèrre blanc >
fèrreblancariá
a plen ponh >
aplenponhar
en naut / en aut
(locucion adverbiala) > l’ennaut / l’enaut (nom) (vej. § 11.6)
Dins los toponims:
Cap Verd > capverdian
la Franca Comtat > francomtés
Nòva York > nòvayorkés
Sant Geli > santgelenc
Sant Africa > santafrican
Santa Elena > santaelenenc [sãtéléné̃]"
(DOGMO:131)
faussa
moneda > fausmonedier
Aigas Mòrtas > aigasmortenc
Exception : pour les dérivés de nombres composés (vint
e unen "vingt-et-unième"), les dérivés en
Je rajoute ce principe :
Les "déformations dialectales" incitent à écrire les mots composés en un seul mot.
Déformations dialectales : Le lexicographe est très souvent confronté aux composés "déformés dialectalement", que ce soit dans les noms communs, les noms de lieu, etc. Par exemple :
rata
penada > ratapanada, rapatanada... "chauve-souris"
Pŏdĭŭ(m)
... > Puèg ..., Pieg ... > Pi..., Pe... "colline de ..."
(ci-dessus
a-dieu-siatz
>
adessiatz "au revoir"
Dans ces cas, si on veut retranscrire la parole "de façon étroite", on est obligé d'écrire les mots composés en un seul mot (univerbé), puisque lorsqu'un élément n'a plus de signification, il n'y a pas de raison de l'écrire séparé.
L'exemple de rata penada "chauve-souris" est traité dans PCLO:54, mais aussi l'exemple de a-Dieu-siatz (plus loin ci-dessous).
Formes soudées anciennes : L'attestation d'univerbés en AO, mais aussi en usage plus tardif (littérature, dictionnaires),
rata penada "chauve-souris" (réf.orth. "chauvesouris") signifie mot à mot en AO "souris munie d'ailes". On se trouve dans le cas "nom + adjectif" : en vertu de l'application du principe 2, on écrit rata penada en deux mots, avec le pluriel ratas penadas "chauves-souris". Le cas semble simple.
Cependant, la forme soudée ancienne est attestée : ratapenada : il convient donc d'accepter aussi cette forme, comme le fait PCLO:54 (principe 7) ; et l'on doit aussi rajouter AO ratapennada, avec deux n, qu'on peut considérer comme une variante dialectale conservant nn latin (voir nn).
Et par ailleurs, de nombreuses déformations dialectales proviennent de la forme primitive :
TDF (graph.aut.) : rato-panado, rato-plenado, rato-pleno, rato-perna, rata-pernada, rouerg rapatanado, pr.ma. rapatanardo, etc. On voit ici la solution adoptée par F. Mistral : quand on reconnaît le premier composant, on garde rato suivi d'un trait d'union ; quand on ne le reconnaît plus (ici à l'occasion d'une métathèse), on forme un univerbé.
On peut adopter alors deux solutions :
- normaliser fortement : on ne retient que rata
penada ou ratapenada, en laissant les locuteurs libres
de prononcer comme ils veulent (rata
penada est une
- normaliser mollement pour respecter les formes dialectales ;
c'est cette voie qui a été choisie
pour le site, puisque lexique-provence existe en particulier pour
sauver la vraie parole des provençaux.
On peut donc considérer les graphies suivantes comme normées :
rata penada (pl. ratas penadas), avec ratapenada (pl. ratapenadas) ;
ratapanada
(pl. ratapanadas),
rapatanada (pl. rapatanadas) ;
etc.
L'attestation de formes soudées anciennes incite à poursuivre l'écriture en un seul mot.
On pourrait rajouter : l'attestation de formes séparées anciennes incite à poursuivre l'écriture en plusieurs mots, mais cet aspect est très discuté (ci-dessous : a-Dieu-siatz, aigardent).
À plusieurs reprises, le PCLO indique que les formes soudées anciennes devraient (doivent) être maintenues actuellement ; cela semble naturel car on procède de même en français : "Châteauneuf", "Villefranche", "portefeuille" (année 1544)... ; en italien : Castelnuovo, Villafranca, capodanno..., en catalan : Castellnou, etc. Cependant, ce n'est pas le choix qu'à fait F. Mistral (ci-dessus), qui utilise systématiquement le trait d'union : Vilo-novo, Castèu-nòu, porto-fueio ; il se démarque ainsi radicalement des langues des pays voisin, et des usages du passé, évidemment dans un but de simplification.
Voir notamment ci-dessous : formes soudées anciennes nom + adjectif, type posaraca. Voir aussi ci-dessus : rata penada / ratapenada.
Pour le français, les rectifications orthographiques de 1990
conseillent des soudures de mots (univerbations), avec comme objet : la régularisation de séries de mots
semblables (source CNRS). Ainsi, "porte-monnaie" et
"porte-clé(s)" ont été soudés en "portemonnaie" et "porteclé" sur le
modèle de "portefeuille" qui existait déjà (mais anciennement
"porte-feuille"). Mais on garde toujours "porte-bonheur",
"porte-voix"... La série n'est donc toujours pas régularisée.
Un autre problème touche les pluriels : "le porte-avions" devient "le
porte-avion" (mais "des porte-avions"). Le PCLO:59
donne un pòrtavions, avec l'haplologie.
Voir ci-dessous le problème de logique.
Dans la règle générale, l'orthographe
rectifiée du français ne supprime pas le trait d'union pour "les verbes,
noms, adjectifs, adverbes ou prépositions servant de préfixe" :
attrape-, cache-, casse-, perce-, pèse-, hors-, sous-, sud-, vice-...
(même source CNRS). Alors qu'en occitan, le PCLO préconise de toujours souder "verbe + nom".
Mais avec le temps, la tendance en
français est bien à souder les mots. Les rectifications de 1990
proposent des soudures de mots, et jamais des coupures. "Le procédé de
l’agglutination, ou soudure, dans les mots composés devrait connaître un
renouveau d’extension, d’ailleurs conforme à la tradition de l’Académie
française. (...) Cette mesure concerne en particulier : -
des noms fortement ancrés dans l’usage, formés ou non d’un
élément verbal suivi d’un élément nominal, tels que :
croquemitaine, portemine, piquenique ou encore : quotepart,
terreplein (...)" (source Académie Française, archivée
p. 3).
Par contre en 1990, des traits d'union sont rajoutés pour les adjectifs
numéraux :
"L'usage du trait d’union sera étendu aux numéraux formant un nombre complexe, en deçà et au-delà de cent. Exemple : on reliera par un trait d’union les composants de cent-deux et ceux de cent-soixante-douze, etc." (même source Académie Française, archivée). Voir ci-dessous nombres composés.
Au total, cette réforme de l'orthographe française (qui porte aussi sur d'autres points que les mots composés) est quand même assez légère, mais elle est assez fortement critiquée. Parmi les critiques, citons :
"Le dernier argument est en général le plus employé et réunit des conservateurs et des partisans de l’évolution de la langue. La réforme de 1990 est en effet beaucoup critiquée parce que ses rectifications auraient pour conséquence de complexifier l’orthographe au lieu de la simplifier, en ajoutant de nouvelles exceptions à mémoriser au lieu d’en supprimer" (source Wikipedia consulté le 25-03-2016).
Manque de logique pour les pluriels :
Il est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue ce risque, et on peut se demander aussi si certaines règles qui semblaient logiques auparavant n'ont pas été remplacées par des règles moins logiques (exemple : un porte-avion, des porte-avions ; l'orthographe traditionnelle est : un porte-avions, des porte-avions... un seul porte-avions porte plusieurs avions : l'ancienne règle paraissait logique).
Ici sont traités les noms composés de "nom et adjectif" : rata penada "chauve-souris".
Mais aussi les adjectifs
composés de "nom et adjectif", en nombre bien plus réduit : type
alenpudènt.
(PCLO:54) De manière générale, un groupe "nom +
adjectif" est maintenu comme locution (mots
séparés sans trait d'union) : c'est la conséquence des principes 2
et 3 ci-dessus.
Les deux composants sont susceptibles
de prendre le -s du pluriel, donc on les sépare ; et
comme on évite le trait d'union, on a une
Pour les composés avec sant "saint", plusieurs cas peuvent se présenter :
● Certains composés peuvent être de type
exocentrique (ci-dessous). Par exemple s'il s'agit du poisson
appelé "saint-pierre" : un santpèire,
●
Les autres cas sont des noms propres composés. Pour les majuscules, je
propose de suivre les mêmes règles qu'en français :
- Il s'agit du saint lui-même, la personne : sant Pèire (mais pour Louis IX : Sant Loís "Saint Louis").
- Il s'agit d'une fête : la Sant Pèire, la fèsta de Sant Pèire.
- Il s'agit d'un nom de lieu : Sant Pèire (voir aussi ci-dessous toponymes en sant).
- Pour les noms de plantes, le DOGMO semble suivre cette règle pour les majuscules : èrba de Sant Joan "herbe qu'on ramasse à la Saint Jean", èrba de sant Jacme "herbe du saint appelé saint Jacques". Cette règle est difficile dans son application, car la différence de sens entre les deux situations est souvent mal connue. Je propose d'écrire tout le temps sant avec minuscule.
|
|
|
|
|
|
| nom + adjectif = | |
nom adjectif | |
|
| ou adjectif nom |
||||
|
|
|
|
|
|
| rata + penada = |
rata
penada "chauve-souris" aussi ratapenada (ci-dessus) |
|
||
| chaine
+ pichòt = |
pichòt
chaine "germandrée petit-chêne" |
|||
| telefòn + mobil = |
telefòn mobil "téléphone mobile" | |||
| mieja + ora = |
mieja
ora [myét |
|||
| branca + orsina = |
branca orsina [brãkʋrsino/a] (élision) "branche ursine, acanthe (plante)" | |||
|
|
|
|
|
|
| cas des locutions figées de type
aiga bolhènt |
||||
| aiga
+ ardènt (1) = |
aigardènt "eau de vie" (exception) | |||
| aiga
+ bolhènt (1) = |
aiga
bolhènt "eau bouillante" |
|||
| maire
+ grand = |
maire
grand
; grand maire (2) "grand-mère" |
|||
|
|
|
|
|
|
| pour
les noms de lieux (notamment ci-dessous toponymes
avec Sant, -a ) |
||||
| Pèire
+ sant = |
sant
Pèire "saint Pierre" (le personnage) Sant Pèire "Saint-Pierre" (toponyme ; fête) santpèire (saint-pierre, poisson : composé exocentrique) |
|||
| aigas + mòrtas = | Aigas
Mòrtas ("Aigues-Mortes" |
|||
| pieg
+ redon = |
Pieg
Redon |
|||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : les composés en
nom + adjectif (règle générale : on obtient des locutions)
(1) pour l'accent dans ardènt,
bolhènt, voir en, én, èn.
(2) grand maire est un
(3) Sanch Amans est une forme
d'origine médiévale, souvent perçue comme Sant
Chamans, voir sanctus + voyelle. Je pense
qu'il faut accepter dans la norme Sanch
Amans et Sant Amans.
Il existe une hétérogéneité de traitement concernant ces
Il s'agit toujours de locutions figées provenant de l'AO, qui perpétuent la déclinaison des adjectifs
latins de la granda
casa. En français aussi, ce type d'adjectif est conservé dans :
"grand-mère", "mère-grand", "grand-rue", "grand-messe", "pas
grand-chose"... L'ancienne orthographe française montrait d'ailleurs une
mauvaise compréhension de ces adjectifs en écrivant grand'mère
(ce qui représente une élision
de "grande"). Or on est en présence non pas d'un élision, mais d'une apocope
généralisée dans la langue d'oïl comme dans la langue d'oc (
En occitan, ce type de locution figée est plus fréquent qu'en français : grand pluiea, maire grand, aigardènt < aiga ardènt, aiga bolhènt... et également dans les toponymes : la Grand Bastida, lei Grands Tèrras, Fòntverd ("fontaine verte")...
Paire grand "grand-père", òli bolhènt "huile bouillante",
peuvent aussi être considérées comme des locutions médiévales figées,
mais on ne s'en rend pas compte puisqu'il s'agit de masculins.
Concernant le pluriel, les deux genres prennent un
Concernant ces locutions figées, les consignes du PCLO ne sont pas claires, et en fait elles
n'existent pas car ces locutions ne sont pas distinguées en tant que
telles. Le PCLO:59 donne simplement aigardent
à propos des haplologies,
quand celles-ci sont "bien fixées par la tradition" (pour éviter aigaardent
On peut se demander si l'orthographe aigardènt
est vraiment fixée par l'usage. La graphie médiévale a toujours noté les
deux éléments séparés : ayga ardent,
ayga arden, aigua ardent...
Puis on trouve en OM "ancien", mais à une époque où la graphie classique était oubliée : aygarden (LDP:243), aygardent (NNNN. peut-être par analogie sur aygardentier qui le précède dans le texte). Puis aiguardent (DPCV), âigarden (DLF-BS), aiguardent (NDPF), aig'ardèn (DPF-A), aiguardent (DPF-H). F. Mistral donne dans le TDF : aigo-ardènt, (l) (g) aigardent. L'haplologie se réalise à l'oral en pr comme en l et g ; il n'y a donc pas de raison d'écrire différemment à l'ouest et à l'est du Rhône. Ainsi on constate que la plupart des dictionnaires ont considéré aigardènt comme un seul mot. L'orthographe actuelle montre la même soudure en esp aguardiente, en cat aiguardent.
On peut donc considérer qu'on se trouve dans le cas des formes
soudées anciennes ci-dessous, bien que l'AO n'ait jamais soudé les deux éléments. On
écrira donc aigardènt, mais il
me semble qu'on peut accepter aiga
ardènt.
L'univerbation pour aigardènt
semble avoir été entraînée par l'haplologie
; il n'en est pas de même pour les autres locutions figées (aiga
bolhènt, maire grand...).
Donc en dehors de aigardènt,
il vaut mieux toujours suivre la règle générale pour "nom + adjectif",
donc laisser les mots séparés.
De plus les deux éléments portent le
Pour les toponymes, en fonction des usages, on écrira (avec
majuscules) : La Grand Comba, Lei
Grands Bastidas, mais Ròcafòrt, où les deux éléments
sont liés par l'usage, comme dans Vilanòva et Castèunòu.
Voir ci-dessous rèire-maire-grand.
|
|
|
|
|
| nom
+ adjectif = (expression médiévale figée de type aiga bolhènt) |
nom
adjectif ou adjectif nom |
|
|
|
ardènt
|
|
|
|
| aiga
+ ardènt = |
aigardènt
"eau-de-vie" (exception aigardènt
ci-dessus) |
||
| bolhènt | |||
| aiga
+ bolhènt = |
aiga
bolhènt "eau bouillante" |
||
| fònt + bolhènt = | Fòntbolhènt (sau30,
mon03)
(ci-dessous formes
anciennes soudées) |
||
| fòrt | |||
| ròca + fòrt = |
Ròcafòrt (nombreux toponymes) (ci-dessous formes anciennes soudées) |
||
| vila + fòrt = |
Vilafòrt (11,
48) (ci-dessous formes anciennes soudées) |
||
| fòu (fòl) | |||
| aura + fòu = |
L'Aura Fòu (pern84) | ||
| ròca + fòl = |
Ròcafòl (mey48) |
||
| grand | |||
| bastida
+ grand = |
Grand
Bastida (toponyme fréquent : grands
bastidas) |
||
| bèstia
+ grand = |
grand bèstia "élan (espèce de cervidé)" | ||
| cadiera
+ grand = |
grand cadiera "grande chaise" | ||
| carriera
+ grand = |
grand carriera "grand-rue" | ||
| coa
+ grand = |
grand coa "variété de poire à longue queue, blanqueta" | ||
| comba
+ grand = |
La
Grand
Comba ("La Grand Combe", |
||
| gòrja
+ grand = |
grand gòrja "engoulevent (oiseau)" | ||
| maire
+ grand = |
maire
grand,
grand maire (1) |
||
| messa
+ grand = |
grand
messa "grand-messe" |
||
| tanta
+ grand = |
grand
tanta |
||
| tèrra
+ grand = |
La
Grand Tèrra (toponyme fréquent : Grand
Tèrra) |
||
| tina
+ grand = |
(toponyme pluriel) |
||
| verd | |||
| fònt + verd =
|
Fòntverd (pon84) (ci-dessous formes anciennes soudées) | ||
| pèira + verd
= |
Pèiraverd (pie04) (ci-dessous formes anciennes soudées) | ||
| ròca/ròcha +
verd/berd = (sans doute) |
Ròcaverd, Ròcaberd (sud-ouest), Ròchaverd (vol63) (ci-dessous formes anciennes soudées) | ||
|
|
|
|
|
(1) grand maire est un
Tableau ci-dessus : exemples de type maire grand, aiga bolhènt.
Voir le principe 6 ci-dessus.
L'application du principe 7 ci-dessus incite à continuer l'usage des formes soudées anciennes.
Pour les toponymes, voir ci-dessous noms composés de lieu.
|
|
|
|
|
|
| nom + adjectif = | |
nomadjectif | |
|
| ou adjectifnom |
||||
|
|
|
|
|
|
| carna
+ salada = |
carnsalada
"petit salé" |
|||
| jorn
+ bòn = |
bònjorn
"bonjour" |
|||
| jorn
+ mieg = |
miegjorn
"midi" |
|||
| mercé
+ grand = |
grandmercé
"merci" (grandmarcí,
gramací) |
|||
| nuech
+ mieja = |
miejanuech
(ou mieja nuech règle générale)
"minuit" |
|||
| rata
+ panada = |
ratapenada
(ou rata penada ci-dessus) "chauve-souris" |
|||
|
|
|
|
|
|
| noms
de lieux voir ci-dessous toponymes |
||||
| castèu
+ nòu = |
Castèunòu
"Châteauneuf" |
|||
| ròca + fòrt = | Ròcafort "Roquefort/Rochefort" (type maire grand ci-dessus). |
|||
|
|
|
|
|
|
Formes soudées anciennes de type
"nomadjectif"ou "adjectifnom"
Un composé exocentrique est un composé désignant le tout par une partie (synecdoque). Par exemple, una tèstanegra "une tête-noire" n'est pas une réelle tête noire, mais un oiseau caractérisé par sa tête noire.
Dans ce cas, le composé est soudé. Par exemple pour tèstanegra, la logique est :
tèstanegra
est l'
Cependant, je propose une marge de tolérance (ci-dessus marge de tolérance). En effet, una tèsta negra, de tèstas negras, ne me semblent pas véritablement choquants.
Même chose pour òliroge,
utilisé dans la région du mont Ventoux : l'òliroge
est l'
Même chose pour santpèire
"saint-pierre (poisson)" : lo
santpèire est l'
Avec la marge de tolérance, on peut accepter l'òli roge, lo sant
pèire / lei sants pèires.
Sources :
(PCLO:55) "Lo jonhent s’emplega pas dins los compausats formats d’un nom e d’un adjectiu de tipe dich “exocentric”. Los noms e adjectius “exocentrics” designan un èsser o una causa, non pas dirèctament mas a travèrs d’una proprietat possedida per aquel èsser o aquela causa: papachrós [papa'rrus]: “aucèl qu’a lo papach ros” (o “qu’es roge del papach”), etc. Los noms exocentrics s’opausan als endocentrics que n’avèm evocat d’exemples çai subre coma rata penada (qu’es ben una mena de rata) e que (levat calhament del compausat marcat per l’abséncia d’acòrd) se nòtan en dos mots."
(DOGMO:130-131) "s'écrivent soudés les noms ou
adjectifs qui n'accordent en genre et en nombre que la deuxième partie
(...) du type nom + adj remplaçant la périphrase "individu/animal qui a
un(e)..." (clòscpelat, -ada, pelgris,
-isa, cambalong, -a, capnud, -a, bècfin, bècjaune, cuolblanc,
cuolcosit, tèstanegra, pèterrós, pèdescauç, papachrós) (...)".
Tableau ci-dessus : quelques composés exocentriques de type nom + adjectif (on obtient des univerbés)
Les composés en nòrd-, sud-, èst-, oèst-, aut-, bas- s'écrivent avec trait d'union.
Source :
(PCLO:53) "Lo jonhent s’emplega darrièr los prefixes que provenon dels noms dels ponches cardinals (nòrd-, sud-, èst-, oèst-) e dels adjectius naut- (aut-, haut-) e bas- (baish-) (lo jonhent se consèrva dins los derivats): Sud-Africa, sud-african ([,sytafri'ka]: notar que la -d finala del primièr formant s’assordís en [t]), nòrd-vietnamian, nòrd-irlandés [nɔrtirlandes], naut-auvernhat, bas-auvernhat..."
Voir aussi nom et nom ci-dessous.
Selon (PCLO:53), normativement, "la finale du premier formant s'assourdit en [t]" :
"Sud-Africa,
sud-african
([sytafri'ka]: notar que la -d finala del primièr formant s’assordís
en [t]), nòrd-vietnamian, nòrd-irlandés [,nòrtirlan'dés],
naut-auvernhat, bas-auvernhat..."
La pronciation [t] peut affecter sud ou nòrd, en composition ou non ; le TDF donne les variantes (g) nort, (l) sut. En Provence, de telles prononciations ne semblent pas réalisées, mais elles sont la conséquence logique du durcissement de la consonne finale.
Exemples :
nòrd-oèst,
nòrd-nòrd-oèst ;
sud-Africa [sutafriko/a], sud-african [sutafrikã] ;
nòrd-irlandés
[nòrtirlãdés] ;
aut-auvernhat,
bas-auvernhat,
Auta-Auvernha, Bassa-Auvernha.
Dans les dérivés de "nom adjectif", on soude les mots (voir principe 5 ci-dessus) :
aiga
senhada > aigasenhadièr
fèrre blanc > fèrreblancariá
Dérivés de toponymes :
Cap Verd > capverdian
la Franca Comtat > francomtés
Nòva York > nòvayorkés
Sant Geli > santgelenc
Sant Africa > santafrican
Santa Elena > santaelenenc [sãtéléné̃].
Contrairement aux cas précédents, il s'agit non pas de noms, mais d'adjectifs.
Exemple : alenpudènt,
littéralement "puant de l'haleine". On constate que dans ce cas précis,
la préposition de est
sous-entendue : d'alen pudènt,
ou de l'alen pudènt "à
l'haleine puante".
L'application du principe 1 ci-dessus
conduit à écrire ce type d'adjectif en univerbé, puisqu'il n'y a pas de
flexion interne (voir principe 2).
Voir aussi adverbe + adjectif ci-dessous (maufasènt).
Autres exemples :
● avec adjectif participe présent :
- AO
bocapud
● avec adjectif simple :
- AO
capc
Quelques rares adjectifs occitans sont construits sur le schéma :
nom suffixé par -i + adjectif
Il me semble que les types
Cependant en latin, c'est l'adjectif qui est placé avant, et suffixé
avec
Voir le type latin albĭcŏmŭs (apophonie).
Voici quelques exemples :
còl + mòrt → còlimòrt "affaibli par la faim" (FEW 2:914b)
còl
+ AO
l
Voir aussi le type carivènd (ci-dessous).
Par ailleurs, il faut expliquer AO batic
(voir notamment NCF-i-)
En espagnol, ce type est beaucoup plus fréquent : pelirrojo
"à poil roux, roux", boquiabierto
"qui a la bouche ouverte", rabilargo
"à longue queue", petirrojo
"rouge-gorge".
En espagnol, une autre construction existe avec
Dans le cas nom + verbe = verbe : on soude les deux mots.
Par exemple : peutirar
"tirer par les cheveux ; arracher".
Voir aussi : sòu catat, ou sòucatat (à discuter).
Au niveau terminologique, K. Klingebiel (ORSCC:743) signale qu'elle reprend l'opposition entre "composition par préfixe" et "composition proprement dite", d'après TFMCLF:137-237. Aujourd'hui, on dit plutôt "dérivation par préfixation" et "composition".
K. Klingebiel présente une discussion pour l'occitan et le catalan sur la limite entre préfixation et composition. Par exemple pour cap "tête, bout, cap..." : en composition, cet élément a souvent la valeur d'un nom (caprós), mais aussi parfois la valeur d'un préfixe (cat capmartell "gros marteau en forme de tête") (ORSCC:745). Dans le premier cas (caprós), cap est l'élément déterminé, alors que dans le second cas (capmartell), cap joue de rôle de déterminant : il détermine la forme du marteau.
Il peut s'agir du cas : verbe
(3e.p.s.)
+ nom (compl) = nom ou
adjectif. La règle est de souder
le verbe et le nom : pòrtaclaus
"porteclé".
- Lorsque le nom (compl)
est au pluriel, le -s du
pluriel est écrit même quand le composé est au singulier :
un
talhacebas "une courtilière" "qui coupe les oignons". C'est une
différence avec le français (réf.orth. "un porteclé", av.réf. "un porte-clé / un porte-clés").
- Décryptage de l'écrit : on fait confiance au lecteur pour décrypter l'écrit (voir annexe au principe 1 ci-dessus).
• On fait confiance au lecteur pour décrypter la composition et
prononcer la voyelle -a du
verbe conjugué à sa convenance : /o/, /a/, /
• Lorsque le nom commence par s
ou r, et qu'il suit la voyelle
-a ou -e
du verbe conjugué, on fait confiance au lecteur pour reconnaître la
composition, et prononcer s et
r de façon "dure" : /s/ et /r/
(et non /z/ et /
un
manjasants "un manjeur de saints, un bigot" (et non un
manjassants
lo
traucasacs "l'orge des rats, plante ('celle qui troue les
sacs')" et non lo traucassacs
lo
tiraregas "le tire-lignes (instrument de dessin)" et non lo tirarregas
Tableau ci-dessus : quelques composés de type verbe + nom (on obtient des univerbés)
Il s'agit d'adjectifs écrits en un seul mot, voir ci-dessus le type alenpudènt.
Il faut mettre un (des) trait(s)
d'union pour une répétition ou une succession de "formes équivalentes".
C'est-à-dire par exemple : pòrta-fenèstra,
plan-planet,
doça-amara.
Pour certaines formes, comme tèrratrémol
"tremblement de terre", le mot est soudé depuis l'AO.
(PCLO:53-54)
"Lo jonhent s’emplega
quand la composicion se fa per la repeticion o la succession de formas
equivalentas, del nom dels ponches cardinals, d’onomatopèias, de formas
expressivas o de reduplicatius: pòrta-fenèstra, cava-cooperativa,
agre-doç, ivèrn-estiu, montar-davalar, tifa-tafa, barlinga-barlanga,
sòm-sòm, bèl-bèl, tifa-tafa, riga-raga, lèu-lèu, plan-plan(et),
balin-balan , nò-nò, lani-lini, sud-èst, èst-nòrd-èst.
Dins cèrts mots, lo primièr formant pòt conéisser una flexion. Aiçò
justifica la separacion dels formants per un jonhent:
pòrta-fenèstra > pòrtas-fenèstras
agre-doç> agra-doça e agres-doces
montar-davalar >
monti-davali.
Lo jonhent s’emplega dins los toponims qu’agropan mai d’un nom equivalent levat quand i a la conjoncion e: Clarmont- Ferrand, Alsàcia- Lorena, Provença-Aups-Còsta d’Azur, Papoa-Nòva Guinèa.
Mas: Lit e Mixa, Polanh e Possòls, Tarn e Garona."
Pour les composés de type posaraca (posa-raca), les consignes orthographiques sont confuses (ci-dessous).
On met le trait d'union entre nom
commun et nom commun.
(PCLO:55)
"Los compausats formats de dos noms s’escrivon en dos mots amb un jonhent se marcan l’acòrd sus cada tèrme e s’escrivon soudats se marcan pas l’acòrd que sul segon tèrme: vagon-cistèrna, martèl-pic, tais-pòrc (vagons-cistèrnas, martèls-pics, taisses-pòrcs) mas aiganèu, palfèrre, capfoguièr (aiganèus, palfèrres, capfoguièrs)".
De même avec les préfixes provenant des points cardinaux, on met le
trait d'union :
Voir ci-dessus :
Pour les prénoms composés :
Selon le PCLO, le trait d'union est facultatif : Joan-Pèire
= Joan Pèire "Jean-Pierre".
(PCLO:54)
"Lo jonhent s’emplega facultativament
dins los noms de personas: Joan-Pèire = Joan Pèire".
Il faut remarquer que l'absence du trait d'union peut être la source
d'ambiguïté : Joan Pèire peut
être compris comme Jean Peyre, ou Jean Pierre (nom de famille Peyre,
Pierre).
Lexique-provence donne donc la préférence
au
trait d'union dans les prénoms composés.
Voir aussi ci-dessous le type joan-que-saup-tot.
|
|
|
|
|
|
| nom + nom = | |
nom-nom | |
|
|
|
|
|
|
|
| cat + tigre = |
cat-tigre "(nom donné à diverses espèces de félins tachés)" (erreur du PCLO:58, qui donne gattigre en un seul mot) | |
||
| freg
+ caud = |
freg-caud,
chaud-e-freg ("chaud et froid") |
|
||
| martèu + pic = |
martèu-pic "(type d'outil)" (PCLO:55) | |
||
| pòrta + fenèstra = |
pòrta-fenèstra "porte-fenêtre" (PCLO:53) | |
||
| tais
+ pòrc = |
tais-pòrc "blaireau dont le museau ressemble au groin du porc" (PCLO:55) | |||
| vagon + cistèrna = |
vagon-cistèrna "wagon-citerne" (PCLO:55) | |||
|
|
|
|
|
|
| nòrd
+ èst = |
nòrd-èst
"nord-est" |
|||
| èst
+
nòrd + èst = |
èst-nòrd-èst
"est-nord-est" |
|||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus. Les composés "nom + nom" : on met le trait d'union.
|
|
|
|
|
|
| adjectif + adjectif = | |
adjectif-adjectif | |
|
|
|
|
|
|
|
| aigre + doç = |
aigre-doç "aigre-doux" | |
||
| doça + amara = |
|
|||
| flac
+ flac = |
flac-flac |
|
||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus. Les composés "adjectif + adjectif" : on met le trait d'union.
|
|
|
|
|
|
| adverbe + adverbe = | |
adverbe-adverbe | |
|
|
|
|
|
|
|
| lèu + lèu = |
lèu-lèu "vite, vite ; tout de suite" (PCLO:53) | |||
| plan + plan = |
plan-plan "tout doucement" | |||
|
|
|
|
|
|
| bèn
+ lèu |
bèn-lèu
"bientôt" (voir belèu, bèn-leu ci-dessous) |
|||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus. Les composés "adverbe + adverbe" : on met le trait d'union.
Voir GIPPM-3:474 §734.ε.
En occitan, il existe une série de mots du type posaraca ; ils sont composés de deux verbes conjugués (posa "puise", raca "vomit").
Concernant l'orthographe, cette série de mots n'est pas mentionnée dans le PCLO ; le DOGMO donne : bolhabaissa, cantaplora, caucatrepa, posaraca, tiranega (corr. tiranèga), mais monta-davala, tomba-lèva, tira-mòla, vira-vira. Il ne semble pas y avoir de choix de cohérence. Il faut même dire que cette série de mots a été peu traitée par les auteurs ; Jules Ronjat en développe brièvement l'étude (GIPPM-3:474 §734.ε. où il donne les mots en graphie mistralienne avec l'utilisation systématique du trait d'union : pouso-raco, boui-abaisso, mounto-davalo, etc.).
En applicant le principe 7 ci-dessus, il me semble que l'existence d'attestations anciennes sous leur forme univerbée doit orienter vers une univerbation générale de ces composés (AO : calcatrepa, cantaplora, posaraca ; bolhabaissa (bolh-abaissa) n'est pas attesté en AO, mais écrit depuis longtemps sous sa forme soudée). On pourrait certes conserver l'univerbation seulement pour ces trois mots attestés anciennement, mais dans un but de simplification, je propose de généraliser l'utilisation des formes soudées à tout le groupe de mots.
Dans ce groupe de mots, le genre est parfois indéterminé (masculin ou
féminin), ou parfois fixé (posaraca est féminin). Au pluriel, ces
mots portent le
Je propose la dénomination de composés bi-actionnels pour ce groupe de mots : ils décrivent la succession de deux actions.
Les mots de type posaraca sont composés de deux verbes conjugués, comme posaraca "installation d'irrigation de type noria". Ce type de composé est très souvent mal compris dans les dictionnaires, qui donnent des explications trop vagues. Il faut être clair : les deux verbes conjugués décrivent la succession dans le temps de deux actions. Pour certains de ces mots, la signification est encore évidente et permet de comprendre le type de construction : montadavala, m. à m. " monte-descend", tiranèga, m. à m. "tire-noie". Une montadavala est une irrégularité de terrain (on monte et on descend) ; ce mot est bien connu des paysans pour décrire une terre. Dans le Gard, les tiranèga sont des êtres imaginaires malfaisants vivant sous l'eau, dont on menace les enfants pour les dissuader d'approcher du bord : ils tirent et ils noient l'enfant. Lèva-te, que lei tiranègas te van prendre ! gou30 "Enlève-toi, que les tiranègas vont te prendre !".
Mais souvent le sens n'est plus compris : ce type de composé n'étant pas fréquent, la métaphore échappe aux locuteurs ; les verbes employés sont devenus rares ; les évolutions dialectales rendent l'origine méconnaissable (tous ces phénomènes interagissant). Par exemple : la posaraca a pu devenir la porraca (z > ∅), la posarranca ; la caucatrepa a pu devenir la caucatripa, l'escaufatripa, la traucatripa.
La posaraca est un mécanisme de type noria, permettant de remonter l'eau d'un puits avec des godets : "elle puise" (posa) puis elle verse (raca "elle vomit"), voir les vidéos Youtube de Robert Geuljans (vidéo 1, vidéo 2). (TDF, FEW 9:632, note 17).
La caucatrepa est une plante (Centaurea calcitrapa) avant de dénommer le piège militaire, plante dont la rosette montre typiquement un bourgeon avec des épines féroces à ras de terre. Si l'on marche dessus pieds nus (cauca "il foule"), ensuite on trépigne de douleur (trepa "il trépigne") (CNRTL "chausse-trappe").
Pour le français :
L'existence de ce type de composé paraît plus marginale. Les deux mots les moins rares ("chausse-trappe" et "chantepleure") montrent leurs équivalents dans d'autres langues, mais leurs premières occurrences sont très anciennes, et permettent de réfléchir à la période de formation de ces composés.
- "Chausse-trappe" (plante), déformation de chauche-trepe, est attesté dès 1180 en picard sous la forme cauketrepe, avant 1220 chauchetrepe (CNRTL "chausse-trappe")
Le nom scientifique de l'espèce (calcitrapa) fut donné par Linné (1753) à cette centaurée ; c'est une latinisation incorrecte du nom vernaculaire chaucetrape.
- "Chantepleure" est attesté vers 1230 ; AO cantapl
- "Tire-laisse", "tire-arrache".
Pour chausse-trappe : voir Antoine Thomas 1912 Romania p. 449 (persee.fr), qui cite aussi chantepleure.
Pour le français, Pierre Guiraud propose la notion de "composés
virevolte : de l'italien giravolta (CNRTL : comp. déverbal tautologique de girare « tourner », v. girer, et de voltare « id. »).
Pour le -i- de liaison : TDF (dauph.) "virivouto" le i est secondaire puisque le mot provient de l'italien giravolta.
Voici les différentes hypothèses de construction (voir CNRTL "bouillabaisse" ; je rajoute la première
hypothèse).
1. Troisième personne - troisième personne (indicatif présent) :
Par exemple pour bolhabaissa,
en parlant du mets : (3e.p.s.) "il bout et il baisse en
température" (abaissar en AO
peut être intr, et peut signifer par exemple "s'atténuer", DOM).
2. Impératif - impératif :
Par exemple pour bolhabaissa, en s'adressant au mets : (2e.p.s.i.) "bous et baisse la température !"
3. Troisième personne (indicatif
présent) et impératif :
Par exemple, pour bolhabaissa,
le CNRTL
("bouillabaisse") propose "elle [la marmite] bout, abaisse-là".
Cependant, ce mode de construction convient mal pour les autres
composés de ce type. Il me semble donc peu probable.
Au final, on peut hésiter par exemple pour montadavala entre :
1. "il monte et il descend" ou "ça monte et ça descend" ;
2. "monte et descends !"
Il faut remarquer que montar-davalar
est un verbe composé noté dans PCLO:53. Mais l'origine est sans doute montadavala.
Il est possible d'y voir une ressemblance avec certains mots composés
de type "verbe et nom",
comme bramafam "crie la faim",
brantalas "remue les ailes"
(gobemouche)...
Notons que quelle que soit l'hypothèse
envisagée, cela ne change pas la graphie en occitan.
La liste provisoire des mots ainsi construits est la suivante :
bolhabaissa ;
cantaplora ;
caucatrepa ;
gachaempega ;
montadavala ;
posaraca ;
tiralònga ;
tira-bota-au-sac ;
tiralaissa ;
tiramòla ;
tiranèga ;
tirapossa (n.m.) "mouvement en avant et en arrière" ;
tirarecuela (n.f.) "ancienne danse provençale" ;
tiravèrsa [tirovèso] (n.f.) "jeu dans lequel les enfants se tiraillent pour s'enlever les objets les uns aux autres" ;
tiravira (n.f.) "roulette, roue de fortune, jeu de hasard" ;
tombalèva ;
trencafila
;
Trencatalha (quartier d'Arles, peut-être nommé ainsi de par son activité commerciale : on tranchait et on coupait de la viande ? du bois ?)
viravira "filet de pêche qui tourne
et plonge incessamment au moyen d'un mécanisme mu par l'eau" (c'était en
particulier le filet à aloses sur le Rhône, par exemple à Avignon). Je
place ce doublet viravira non dans des composés tautologiques,
qui semblent essentiellement français, mais dans les composés
bi-actionnels, qui sont essentiellement occitans.
L'anar-venir "l'aller-retour".
Pluriel : leis anars-venirs "les allers-retours".
|
|
|
|
|
|
| onomatopée
+ onomatopée = |
|
onomatopée-onomatopée | |
|
|
|
|
|
|
|
| balin + balan = |
balin-balan "en balançant d'un côté de l'autre" (PCLO:53) | |||
| pachin + pachau = |
pachin-pachau
"de ci, de là ; ..." |
|||
| tura + lura = |
tura-lura "turelure, son d'instrument à vent" | → (d) turalurar "jouer de la
flûte" |
||
| tura + lura + lura = |
tura-lura-lura "turelure, son d'instrument à vent" | |||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus. Les composés "onomatopée-onomatopée" : on met le trait d'union.
Dans le cas de "nom + préposition (de...)
+
complément du nom", les mots restent séparés (locution
nominale).
Ais de Provença ;
Vilanòva
d'Avinhon.
(PCLO:56)
"Lo jonhent s’emplega pas dins los
compausats formats d’un nom, d’una preposicion e d’un complement (que
siá exocentrics coma
[...]
Lo primièr formant coneis la flexion, çò que justifica la separacion
tipografica:
uèlh de pavon > uèlhs de pavon."
Commentaire de lexique-provence :
La séparation sans trait d'union peut également mener à certaines ambiguïtés (par exemple la coa de chivau pour le nom d'une plante, qu'on peut confondre avec une queue de cheval... ; voir également ci-dessous les nombres composés).
Dans les constructions adverbiales "de
+ adjectif", on a affaire à des locutions : on
les écrit à deux mots séparés (voir
d'amont
d'aut, (de aut)
de bas
de fons
de lònga
de fèr (locution adjectivale)
de fresc
de tard
de travèrs
etc.
en aut
en bas
en amont
etc.
Les dérivés de type debàs
"bas, partie inférieure ; vêtement du pied", de
debàs, per debàs, de per debàs contiennent debàs
univerbé. En effet dans ces cas, debàs
est dérivé de
(PCLO:55)
"en naut / en aut (locucion adverbiala) > l’ennaut / l’enaut (nom)"
(PCLO:60) enbàs (adverbe) est donné par L. Alibert, mais vu l'ensemble des règles ci-dessus, il vaut mieux l'écrire en deux mots : en bas.
La locution languedocienne et rhodanienne de
qué s'ecrit en deux mots (DPF:402 et DOGMO:454 donne seulement dequé
comme nom, voir TDF "avoir, bien, aisance"). Le TDF donne la locution interrogative en un seul
mot : dequé fas ? = que fais
tu ?.
De
qué fas ? = Que fais-tu ?
La préposition devèrs "du
côté de" est écrite en un seul mot (préposition de
+ préposition vèrs). (DOGMO:482).
Les constructions de type amont,
abàs, avau (adv. ou
n.) sont univerbées, par
tradition.
Certains composés peuvent (selon moi) être considérés comme univerbés
par tradition : ailamontdaut,
voir TDF
"eilamoundaut".
(POP).
Remarque : de nombreux
préfixes ont la valeur d'adverbes (le flou de la limite entre
préfixation et composition est signalé en avertissement
ci-haut). Par exemple quasi
"presque", rèire "arrière"
sont des adverbes, également utilisés comme préfixes. On peut
généraliser en les appelant "éléments formants".
De façon générale, les mots "adverbe
+ ..." sont écrits soudés (univerbés) : avantgarda,
avantgost, rèiregrand...
C'est la conséquence de l'application des principes 1
et 2 ci-dessus.
Il en est de même pour les mots
"préfixe + ...", excepté les préfixes
(DOGMO:130) : "s'écrivent soudés les noms et adjectifs qui n'accordent en genre et en nombre que la deuxième partie, du type adv + verbe ou adv + adj (paucval, malpensa, malbastit), [...], et tous les composés comportant des préfixes (neoliberal, pòstoperatori, preeminéncia, pròalemand, antialcolic, mensdicha, subredire, viceamiral, rèirebotiga, contradança)."
Remarque : pour les contacts voyelle-voyelle, voir ci-dessus
(antiimperialista, centreuropèu).
- Adverbe (ou préfixe) + verbe :
maufaire, bènfaire, refaire...
- Adverbe (ou préfixe) + nom :
avantgost, entresenha / entresigne,
rèirebotiga, rèireoncle, viceamirau, contradança, preeminencia...
-
Adverbe (ou préfixe) + adjectif :
maufasènt (voir aussi type
alenpudènt ci-dessus)
maubastit,
centreuropèu (centreuropean), antialcolic, antiimperialista, neoliberau, pòstoperatòri, pròalemand, subreuman...
Carivènd "qui vend cher"
semble construit sur un schéma analogue à còlimòrt ci-dessus, avec un
On met le trait d'union derrière èx, non, quasi.
(PCLO:53) : "Lo
jonhent s’emplega darrièr los prefixes que pòdon èstre de mots
gramaticals autonòms (èx-, quasi- e non-): l’èx-ministre (mas:
Volgograd, èx Tzaritzyn), lo quasi-delicte (mas: aquò es quasi un
delicte), la non-violéncia (mas: non pas el)."
Commentaire de lexique-provence :
le sens de "mot grammatical autonome" n'est pas clair ; par exemple pauc, mau, mens, subre, rèire
devraient entrer dans cette catégorie. Pourtant le PCLO donne : rèirenom
"prénom" (p. 83), subreinvestida
(p. 11), subretot (p. 18), subrecargar (p. 33), subreòs,
subrora (p. 58), subrendeman
(p. 59), etc.
Je pense la véritable explication est : èx,
non, quasi sont des adverbes-préfixes pouvant
s'associer à une grande variété de mots : èx-femna,
èx-bèu-paire,
èx-ministre, èx-notari, èx-paisan... La grande quantité des
mots composés obtenus peuvent donc être considérés comme non
lexicalisés, donc on met le trait d'union.
Cela dit, ce raisonnement a ses limites.
Bien qu'on écrive rèiregrand
"arrière-grand-parent" et maire
grand "grand-mère" (locution
figée), pour "arrière-grand-mère", je ne vois guère d'autre
solution que de mettre des traits d'union :
una rèire-maire-grand, de rèire-maires-grands
- Si on écrit rèiremaire grand
ou rèiremaire-grand : il
semble que "l'arrière-mère est grande", ce qui ne veut rien dire.
- Pour une orthographe rèiremairegrand : le pluriel exige le -s à maire et à grand ; cela s'oppose au principe 2 : l'univerbé n'est pas possible.
- Une orthographe rèire maire
grand serait possible, mais les mots semblent lâches et la
préfixation avec rèire
n'apparaît plus clairement.
L'emploi plus général du trait d'union aurait permis d'éviter cette incohérence, voir le commentaire ci-dessus.
Tous ces préfixes donnent des mots univerbés.
(PCLO:58)
Voir a-,
exprimant le passage d'un état à un autre.
Pour les
Par exemple : arramar, assaborar,
associar (AO associat).
Le a-
privatif est essentiellement utilisé pour les mots savants.
Pour les
Par exemple : aritmic, asexuat,
asociau.
Le préfixe bi-/bis-
Pour "bissectrice", "bissextile", PCLO:58 se range à l'orthographe majoritaire parmi les langues voisines, et fournit bisectritz, bissextil :
- Lo mot bisectritz es un neologisme, sens equivalent en latin classic. Dins las lengas vesinas, lo catalan bisectriu e l’italian bisettrice se destrian del francés bissectrice. L’occitan causís la forma majoritària bisectritz.
- Lo mot bissextil ven del latin bisextilis. Mas dins las lengas vesinas, lo catalan bissextil e lo francés bissextile se destrian de l’italian bisestile. L’occitan causís la forma majoritària bissextil.
L'argument de l'étymologie et de l'homogénéité me semble plus
convaincant ; je propose donc bisectritz
(inchangé), mais bisextil
(plutôt que bissextil
Le préfixe di-, du grec δι- "deux fois, double" est essentiellement utilisé pour les mots savants.
Pour les
Par exemple :
- disyllab, disepal (le français est hétérogène : "dissyllabe", "disépale") ;
- dir...
? (pas d'exemples ?)
Le préfixe dis-, du latin dĭs- exprimant l'éloignement, la séparation (voir des-), est essentiellement utilisé pour les mots savants.
Pour les
Par exemple : disruptiu,
dissemblable, dissension, dissimilacion, dissimulacion.
(Remarque : en dérivation latine pour les
Le préfixe dis-, du grec
δυσ- (par l'intermédiaire du latin médiéval dys-),
exprime une difficulté, un défaut. Il est essentiellement utilisé pour
les mots savants.
Pour les
disregulacion
"dysrégulation"
dissimetria
"dissymétrie, anc.
dyssymétrie"
dissomnia "dyssomnie"
En une première approximation, on peut utiliser la règle :
- le mot est emprunté au latin : on conserve l'orthographe latine : col- (colleccion), com- (combinar, comparar, commemorar) ; con- (connectar), cor- (corregir) ; etc.
- le mot est un néologisme : on utilise le préfixe sous la forme co- : colocacion,
coresponsable, cosignar...
(PCLO:59)
"- ancianas formacions calhadas: correspondre, correligionari, corrector
- neologismes: coresponsable, codirector, copresident, coedicion, cosinus, cosignar."
Mais notamment pour la consonne m, il y a une hétérogénéité, par exemple tantôt un m, (cometre, comun, comissari) tantôt deux m : commemorar, commocion... Voir co-, et aussi pour la question de la prononciation.
Belèu, bessai signifient
"peut-être". Leur origine est :
- bèn + lèu "bien + léger" (FEW 5:290b, RUHAOL, DOM) ;
- bèn + sai "bien + je sais" (RUHAOL:94).
Le PCLO donne les orthographes benlèu,
bensai comme
"18.6 Formas referencialas de quauquei mots gramaticaus
[...]
18.6.5
Benlèu, bensai
[PCLO:144] Lei
mots benlèu e bensai s’escrivon amb una n muda: [be'lèw, be'saj]"
L'inconvénient est que benlèu
est source de confusion avec bèn-lèu
"bientôt" (bèn-lèu en graphie
mistralienne, TDF). Bèn-lèu
"bientôt" est une forme plus tardive que benlèu
"peut-être", et ce peut être un
Dans tout le domaine d'oc, benlèu et bensai sont prononcés sans nasalisation, c'est-à-dire comme si le n n'existait pas.
"Peut-être"
afin d'éviter les confusions, je pense qu'il vaut mieux proposer les formes référentielles (au moins pour la Provence) : belèu, bessai (bessai aligné sur belèu).
Concernant "bientôt" : le DOGMO est obscur : il ne donne ni ben
lèu, ni ben-lèu.
Soit il considère qu'il s'agit d'un francisme négligeable, soit il
inclut "bientôt" dans benlèu
(rappelons qu'il n'y a pas de traduction dans le DOGMO), mais je penche pour la première
solution. Le DBFP
donne "bientôt" lèu. Le DBFP et le DPF mentionnent ben
lèu pour "bientôt". Mais alors, ne se trouve-t-on pas dans le
cas de répétition de formes équivalentes ?
(adverbe + adverbe). C'est discutable : soit bèn
et lèu sont considérés sur
le même plan, comme lèu-lèu,
plan-planet, soit bèn
précise lèu, dans le sens
"bien, vraiment" tôt, vite. Mais la nuance est sans doute subtile, et
dans ce dernier cas, comment écrire le composé ? Avec trait d'union,
soudé ou séparé ?
Je propose de reconnaître simplement une "répétition de formes
équivalentes", donc je propose d'écrire bèn-lèu.
Remarquons que c'est la même graphie que pour la graphie mistralienne.
Pour la construction adverbiale lòngamai, lònga mai "longtemps encore (formule de souhait)", DOGMO:744 donne les deux solutions : univerbé ou locution.
(PCLO:54)
On met le trait d'union pour des phrases non limitées à une forme verbale avec un seul mot complément.
[PCLO:54] "Lo jonhent s’emplega quand los mots compausats son formats de frasas que son pas limitadas a una forma verbala amb un sol mot complement: manja-pan-mosit, adieu-siatz [a-Dieu-siatz], fug-l’òbra, manja-quand-n’a.
A costat de la forma classica adieu-siatz, de formas mai evoluidas s’escrivon
soudadas (adissiatz,
adishatz,
adessiatz...)."
Ci-dessous je propose a-Dieu-siatz.
(Pour ce dernier problème des formes évoluées soudées, voir ci-dessus : principe 6).
mau-m'agrada (nom) "celui qui n'est jamais content".
Également pour les autres constructions complexes (sans verbe) : cap-sens-uèlhs, mèrda-au-cuòu (DOGMO:130).
Pour les prénoms entrant dans des mots complexes, on met des traits d'union, avec ou sans majuscule selon les cas :
- sans majuscule s'il s'agit d'un emploi comme nom commun : un joan-que-saup-tot "un monsieur Je-sais-tout", mot à mot "un jean-qui-sait-tout" ;
- avec majuscule s'il s'agit un emploi
comme nom propre : Joan-que-saup-tot
èra mon nom (TDF) "Monsieur Je-sais-tout était mon nom".
Par ailleurs, ces mots sont invariables : ils sont comme figés au
singulier. Voir par exemple (fr)
"jean-le-blanc", "jean-foutre".
Pour a-Dieu-siatz "au revoir (aux personnes qu'on vouvoie ou à plusieurs personnes)", le PCLO:54 l'orthographie adieu-siatz. Cette dernière orthographe est sans doute influencée par le catalan adeu-siau (même sens). Je pense que l'orthographe a-Dieu-siatz "est plus logique : le mot-phrase est logiquement décomposé en "à Dieu soyez". En AO on trouve : a Dieu siatz (BertrAl, Cad in LR 3:32b), voir la discussion au principe 7 ci-dessus (influence des formes écrites anciennes).
La question de la majuscule à Dieu se pose. F. Mistral, pourtant connu comme sensible à la religion, écrit sans majuscule : à-diéu-sias. Mais comme on considère qu'il s'agit d'une phrase contenant Dieu, il me semble que la logique voudrait qu'on mette la majuscule. Voir aussi la forme citée ci-dessus en AO : a Dieu siatz avec majuscule.
L'origine de adieu
est selon le DOM la variante
Pour les évolutions dialectales de a-Dieu-siatz, en vertu du principe 6, on les écrit de façon univerbée : adessiatz, adossiatz, adissiatz... PCLO:54 : "A costat de la forma classica adieu-siatz, de formas mai evoluidas s’escrivon soudadas (adissiatz, adishatz, adessiatz...)"
Voir aussi Toponymie.
Les toponymes de type "nom et adjectif" échappent souvent à la règle générale pour nom et adjectif. En effet il s'agit souvent de formes soudées anciennes (ci-dessus), pour lesquels la norme actuelle reflète la norme médiévale : on écrit Vilanòva, Ròcabruna, Castèunòu de Papa, Vauclusa, Sant Amans, La Ròca... Ce système est le même que pour le français : Villefranche, Châteauneuf, l'italien : Villafranca, Castelnuovo...
(j.m.c.g.) "Los compausats d’aquel tipe [nom e adjectiu] s’escrivon ça que la en un sol mot quand son de toponims fixats coma de mots: Vilanòva, Castèlnòu, Murvièlh, Montaut... Seguisson la règla generala dels toponims venguts mots que vòl que s’escrigan soudats, levat:
- en preséncia d’una
preposicion coma de: Ais de
Provença, Clarmont d’Erau, Murvièlh de Besièrs
- en preséncia del mot Sant, Santa:
Sant Roman de Codièira, Santa Fe la Granda, Sant Petersborg.
Son considerats coma mots los
toponims desprovesits d’article. Los toponims qu’an l’article
s’escrivon coma de sintagmas (a las majusculas prèp): s’opausan
aital Castèlnòu e Lo Mas Nòu, Ròchamaura e La Ròca, Puèglaurenç e Lo
Puèi Nòstra Dòna...
Los toponims formats d’un nom e d’un
adjectiu al plural
s’escrivon tanben en dos mots: Aigas Mòrtas, Ribas Autas."
|
|
|
NOMS DE LIEUX
|
|
|
| nom + adjectif = | |
nomadjectif | |
|
| ou adjectifnom |
||||
|
|
|
|
|
|
| aigas + mòrtas = | Aigas
Mòrtas ("Aigues-Mortes" |
|||
| mont
+ bèu (bèl) = |
Bèumont
"Beaumont" |
|||
| mont + agut = | Montagut (divers
"Montagut, Montaigut, Montégut...) |
|||
| lo + mont + blanc | lo mont Blanc (article) | |||
| castèu
(castèl) + nòu = |
Castèunòu
"Châteauneuf" |
|||
| vez |
Bèuveser,
Bèlvéser... (Beauvezer, Belbèze...) |
|||
| vila
+ franca = |
Vilafranca
"Villefranche" |
|||
| vila
+ nòva = |
Vilanòva
"Villeneuve" |
|||
| puèg
+ orsin = |
Puèg
Orsin "Puéchoursi" ( (-g + voyelle) |
|||
| pieg
+ redon = |
Pieg
Redon (-g + consonne) |
|||
|
|
|
|
|
|
Noms de lieu : formes soudées anciennes de type "nomadjectif"ou "adjectifnom" (avec quelques exceptions)
Contrairement au français, on ne met pas le trait d'union s'il y a l'adjectif Sant, Santa : Sant Savornin, Sant Estève.
(Voir les préconisations ci-dessus.)
Voir aussi sant + nom ci-dessus.
Pour le problème de Sanch (Sanch Amans perçu comme Sant
Chamans), voir sanctŭs, sanctă + voyelle.
|
|
|
|
|
|
| nom + adjectif = | |
nom adjectif | |
|
| ou adjectif nom |
||||
| Pèire
+ sant = |
Sant
Pèire "Saint-Pierre" (toponyme ; fête) sant Pèire "saint Pierre" (le personnage) santpèire (saint-pierre, poisson : composé exocentrique) |
|||
| Nasari
>
Nari + sant = |
Sant
Nari ("Sanary" |
|||
| Amans
+ sant (sanch) = |
Sanch
Amans perçu comme Sant
Chamans "Saint-Chamand, Saint-Amand" (voir sanctŭs + voyelle) |
|||
| Lei
+ Santei + Marias = |
Lei
Santei Marias "Les Saintes-Maries-de-la-Mer" ( |
|||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : les toponymes en Sant + nom (règle générale : on obtient des locutions)
Contrairement au français, on ne met pas de trait d'union s'il y a la préposition de : Ais de Provença, Vilanòva d'Avinhon, Castèunòu de papa, Bocas de Ròse (Bocas dau Ròse).
Comme en français, on ne met pas la majuscule à la préposition.
(Voir les préconisations ci-dessus.)
Contrairement au français, on ne met pas de trait d'union s'il y a la conjonction e : Tarn e Garona. (PCLO:54).
Comme en français, on ne met pas la majuscule à la conjonction.
(Remarque : existe-t-il des toponymes occitans avec la préposition sus "sur" ?).
Comme en français, s'il y a un article, on ne met pas de trait
d'union : Lo
Rastèu, La Ròca.
Comme en français, on met la majuscule à l'article, voir fr "Le Vésinet", mais "la France". Mais "je vais au Vésinet", vau au Rastèu, vau a La Ròca (à mieux étudier).
Pour les dénominations
(groupes de mots) comme lo mont
Blanc, il n'y a pas de majuscule à lo
mont (voir ci-dessous puèg,
mont...).
(Pour un article à l'intérieur d'un toponyme, on met la minuscule.
Exemples en occitan ? Voir le français Ivry-la-Bataille).
La présence de l'article empêche l'univerbation de "nom et adjectif"
(comme en français).
Lo mont Blanc (mais Montagut, Montaut, Montredon, Bèumont...).
(Voir les préconisations ci-dessus.)
Contrairement au français, on ne met pas de trait d'union dans :
Aigas
Mòrtas "Aigues-Mortes" (
Aigas
Vivas "Aigues-Vives" (
Caudas
Aigas "Caudesaigues" (Caylus,
etc.
(Voir les préconisations ci-dessus.)
La règle générale est en accord avec les points qui précèdent :
- s'il y a un article ou une préposition, on a une dénomination : lo mont Blanc ;
- dans les autres cas, on a un univerbé : Montaut, Montredon, (localité Montgenèbre ?) ;
- pour Puèg, voir ci-dessus : Puèg + consonne, Puèg + voyelle ;
La perte d'un article montre que la langue s'est engagée dans la voie
d'une perte de sens (Puèg),
le mot n'étant plus utilisé comme nom commun. Cependant il est
intéressant de noter que les provençalisants comprennent encore le
vrai sens Pie-, Pi-, Pé-, Pue-
; on trouve aussi souvent Lo Pièg,
Lo Puèg... La perte de sens n'est que partielle dans ce cas.
Le DOGMO donne :
mont Ararat, Mont Blanc,
etc. Le traitement semble donc montrer une incohérence.
L'auteure précise :
"en occitan, s'emplega sovent lo nom pròpri solet : se ditz puslèu Losera, Ventor, Venturi, Sant Clar, etc. que lo mont Losera, lo mont Ventor, lo mont Sant Clar, etc. al contra de Mont Blanc. Per d'unes, avèm donc escrich mont entre parentèsis. Quant a l'esitacion mont/Mont, es generala, tant en francés coma en occitan." (DOGMO:800-801).
Certes l'hésitation existe en français, mais il existe une règle :
(Dictionnaire de l'Académie française, ici)
"[principe général pour les dénominations] Dans les dénominations
formées de plusieurs mots, le principe général est de réserver la
majuscule au premier mot caractéristique, c’est-à-dire à celui qui
permet l’identification, ainsi qu’à l’adjectif qui éventuellement le
précède : la guerre de Sécession, la révolution d’Octobre, le musée du
Louvre, la guerre de Cent Ans, le Petit Trianon, etc.
De nombreux cas particuliers existent [...].
Majuscules en géographie
[...]
On met une majuscule aux noms propres, non aux adjectifs qui leur
sont adjoints (l’Italie méridionale), sauf dans les cas où
l’appellation fait office de nom propre, de quasi nom composé : le
Grand Nord, l’Asie Mineure.
Selon le principe général énoncé plus haut, les noms communs d’entités
géographiques (lac, mer, pic, mont, etc.) individualisés par un nom
propre ou un adjectif gardent leur minuscule initiale. C’est le terme
distinctif qui prend la majuscule : la baie des Anges ; la mer
Méditerranée, le pic du Midi, le golfe du Lion. Certains adjectifs
généraux prennent en géographie une valeur caractéristique et
porteront la majuscule : le mont Blanc, le fleuve Jaune, l’océan
Pacifique, la mer Noire."
Par contre, on met une majuscule pour "le massif du Mont-Blanc" (avec trait d'union en français).
Je propose de suivre les mêmes
règles qu'en français (au trait d'union près) : lo
mont Blanc, mais lo massís dau Mont
Blanc. (Voir
Wikipédia : usage des majuscules en français lorsque le
spécifique est un adjectif).
Également, comme en français (pour les majuscules) :
Lo despartament
dei Bocas de Ròse, mais pour parler de l'embouchure : lei bocas de Ròse.
Le groupement de deux toponymes exige le trait d'union : Clarmont-Ferrand, Alsàcia-Lorena, Provença-Aups-Còsta d’Azur. Voir la règle ci-dessus : nom et nom.
Cependant il ne faut pas le trait d'union en présence de la
conjonction de coordination : Tarn
e Garona, voir ci-dessus présence
de e.
Remarque : parfois, les règles peuvent mener à des ambiguïtés de lecture : Papoa-Nòva Guinèa (Papouasie-Nouvelle-Guinée) : on peut penser en première lecture qu'il s'agit de Papouasie-Nouvelle, et de Guinée.
En vertu du principe 5 ci-dessus, les dérivés de toponymes composés sont écrits en un seul mot (exemples de PCLO:55) :
Cap Verd > capverdian
la Franca Comtat > francomtés
Nòva York > nòvayorkés
Sant Geli > santgelenc
Sant Africa > santafrican
Santa Elena > santaelenenc [sãtéléné̃].
On écrit de façon univerbée tous les composés de type XoY : termomètre, sociologia, occitanocatalan, cardiovascular.
"Lo jonhent s’emplega pas dins los mots que se forman segon l’estructura XoY (quand “o” religa los formants): termomètre, sociologia, occitanocatalan, cardiovascular."
On peut distinguer trois cas :
Pour les mots en
Il n'y a jamais d'accent tonique sur le premier élément.
(PCLO:56)
"En occitan termomètre, nomotèta o acantopterigian son de derivats e non de compausats: an pas qu’un accent tonic, e es pas question de pausar un accent escrich sus o abans l’o que ne jonh los formants."
Pour quilograma, la norme
impose donc d'écrire quilo
"kilo" en abrégé, et non quilò
Il s'agit très généralement des composés
écrits
avec un trait d'union en français ("franco-italien",
"serbo-croate"...).
(PCLO:56)
Ce sont souvent des adjectifs composés désignant des nationalités ou
des appartenances ethniques : russojaponés,
francoitalian,
còrsoiatalian, arvèrnomediterranèu. Le
russojaponés ;
ispanofrancoitalian
;
còrsoitalian ;
sèrbocroat ;
cardiovascular ;
politicoeconomic.
Le PCLO signale des cas qui peuvent paraître
délicats :
(PCLO:56-57)
"Tre que la formacion quita de valer
estrictament una coordinacion d’adjectius, lo compausat passa derivat
e lo primièr formant es inaccentuat: sociolingüistic
(non pas “a l’encòp social e linguistic” mas “que relèva de la
disciplina dicha sociolingüistica”), checoslovac
çò es ciutadan de Checoslovaquia (e non Chècoslovaquia*), celtoligur
(que transpausa lo grèc Keltolígys, coma celtibèr
transpausa Keltíbēr).
Remarca
Las formacions seguentas tomban
clarament dins lo sistèma general de la derivacion culta (type A).
Lo primièr formant i es inaccentuat en tota ipotèsi: serbofil,
sociologia, corsofòn, celtomania (e non pas sèrbofil
La présence des traits d'union dans les nombres composés occitans
n'est pas encore tranchée, elle entre dans les "cas en discussion" (PCLO:60). Je présente ci-dessous une
comparaison entre la norme occitane et la norme française.
Occitan avant 2007 :
(PCLO:60)
(j.m.c.g.) "Los nombres compausats, segon Alibèrt, an de jonhents de 17 a 29 mas n’an pas delà 29: dètz-e-sèt, dètz-e-uèch, dètz-e-nòu, vint-e-un, vint-e-nòu... trenta un, dos cents, cinc mila."
Français avant 1990 :
(page Académie Française)
(j.m.c.g.) "Dans les nombres écrits en toutes lettres, la règle traditionnelle veut qu’on lie par un trait d’union les éléments inférieurs à cent, à moins qu’on ne soit en présence de la conjonction « et » : elle a vingt-trois ans ; elle a cent trois ans ; elle aurait cent quatre-vingt-quatre ans ; quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-huit, mais elle a vingt et un ans."
Conclusion : ces deux
anciennes normes s'opposaient sur la conséquence de la conjonction "e / et" mais elles se
rejoignaient sur la présence du trait d'union pour les nombres
inférieurs à cent.
Occitan depuis 2007 :
(PCLO:60)
(j.m.c.g.) "S’es prepausat de suprimir lo jonhent dins totes los nombres, per tal de coïncidir amb la règla generala que vòl evitar lo jonhent (§ 11.1): dètz e sèt, dètz e uèch, dètz e nòu, vint e un, vint e nòu, trenta un, dos cents, cinc mila. Los nombres ordinals farián parièr: dètz e seten (o regionalament: dètz e setau, dètz e setesme)."
Français depuis 1990 :
(page Académie Française)
(j.m.c.g.) "Tous les numéraux formant un nombre complexe sont reliés par des traits d’union, y compris ceux qui sont supérieurs à cent. On écrira donc : vingt-et-un ; mille-six-cent-trente-cinq."
Première conclusion : l'évolution de la norme occitane suit exactement le contraire de celle du français concernant les traits d'union. C'est un peu déroutant.
À propos des rectifications de 1990 en français, Wikipedia signale
très justement que :
"la nouvelle orthographe est non ambigüe ; ainsi distingue-t-on :
mille-cent-vingt-septième (1127e)
de mille-cent-vingt septièmes (1120/7)
de mille-cent vingt-septièmes (1100/27)
de mille cent-vingt-septièmes (1000/127)
Ou encore :
vingt et un tiers (20 + 1/3)
de vingt-et-un tiers (21/3)".
Deuxième conclusion : la
rectification de 1990 en français lève les ambiguïtés, alors que la
proposition pour l'occitan introduit des ambiguïtés.
Remarque à propos de "vingt-et-un tiers" : en dialecte languedocien vint e un tèrç se distingue de vint e un tèrces ; par contre en
provençal on écrit dans les deux cas : vint
e un tèrç ; il y a
ambiguïté. Ce choix a sans doute été fait par application du
principe 3 ci-dessus, mais la présence de
traits d'union aurait été moins ambiguë.
Voir ci-dessus notamment le type "nom + adjectif" : règle
générale (rata penada
"chauve-souris", etc.) ; nom + adjectif, composés
exocentriques
(type tèstanegra).
Dans le domaine très vaste des appellations vernaculaires d'espèces vivantes, l'application des règles édictées par le Conseil de la Langue Occitane implique d'écrire :
- l'èrba rasparèla (Picris echioides, plante) ;
- l'arrapapeu (Gaillet
grateron, plante)
- l'èrba de l'òli roge
(Millepertuis, Hypericum
perforatum, plante) ;
- l'òliroge (Millepertuis,
Hypericum perforatum,
plante) ;
- la bousa de vaca
(variété de figue) ;
- l'èrba-que-sent-marrit (Bifora radians, plante).
Commentaires :
Il eût pu paraître judicieux d'écrire :
- l'èrba-rasparèla, pour
distinguer l'espèce de n'importe quelle autre herbe râpeuse ;
- l'èrba-de-l'òli-roge
pour fixer métaphoriquement le nom d'espèce ;
- la bousa-de-vaca pour
distinguer la variété de figue d'une bouse de vache.
Pour l'èrba de l'òli roge,
comme pour les centaines autres èrba
de... , il est vrai que l'ambiguïté n'est guère permise,
puisque le lecteur est averti qu'il entre dans le domaine des
appellations de plante par "èrba de".
Mais la présence de traits d'union aurait permis une unité dans le
domaine des espèces vivantes, comme l'avait fait Mistral (TDF).
Problème des majuscules :
Comme en français, l'usage de la majuscule est mal codifié. Voir par
exemple Wikipédia : typographie des noms d'espèces. Dans le site, je
ne mets aucune majuscule pour les noms d'espèces (sauf bien sûr quand
elle contient un nom propre : lo tè
dau Luberon).
_____________________________________________________________