- Un groupe consonantique est un groupe de deux consonnes ou plus, qui se suivent dans un mot.
- Cette partie traite de l'évolution des groupes
consonantiques latins
- Cette partie concerne aussi les
- Le tableau ci-dessous permet d'orienter le lecteur vers un groupe consonantique recherché.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2e cons.→
|
b |
c |
d |
f |
g |
gu
(1) |
j |
l |
m |
n |
p |
qu |
r |
s |
t |
v |
|
1e cons.
↓
|
||||||||||||||||
|
b
|
bc
|
bd
|
bf
|
bg
|
-
|
bj
|
bm
|
bn
|
bp
|
bqu
|
bs
|
bt
|
bv
|
|||
| c |
cb |
cc |
cd |
cf |
cg |
- |
cj |
cl |
cm |
cn |
cp |
cqu |
cr |
cs |
ct |
cv |
| d |
db |
dc |
dd |
df |
dg |
- |
dj |
dl |
dm |
dn |
dp |
dqu |
dr |
ds |
dt |
dv |
| f |
fb |
fc |
fd |
ff |
fg |
- |
fj |
fl |
fm |
fn |
fp |
fqu |
fr |
fs |
ft |
fv |
| g |
gb |
gc |
gd |
gf |
gg |
- |
gj |
gl |
gm |
gn |
gp |
gqu |
gr |
gs |
gt |
gv |
| j |
jb |
jc |
jd |
jf |
jg |
- |
jj |
jl |
jm |
jn |
jp |
jqu |
jr |
js |
jt |
jv |
| l |
lb |
lc |
ld |
lf |
lg |
- |
lj |
ll |
lm |
ln |
lp |
lqu |
lr |
ls |
lt |
lv |
| m |
mb |
mc |
md |
mf |
mg |
- |
mj |
ml |
mm |
mn |
mp |
mqu |
mr |
ms |
mt |
mv |
| n |
nb |
nc |
nd |
nf |
ng |
ngu |
nj |
nl |
nm |
nn |
np |
nqu |
nr |
ns |
nt |
nv |
| p |
pb |
pc |
pd |
pf |
pg |
- |
pj |
pl |
pm |
pn |
pp |
pqu |
pr |
ps |
pt |
pv |
| qu |
qub |
quc |
qud |
quf |
qug |
- |
quj |
qul |
qum |
qun |
qup |
qqu |
qur |
qus |
qut |
quv |
| r |
rb |
rc |
rd |
rf |
rg | - |
rj |
rl |
rm |
rn |
rp |
rqu |
rr |
rs |
rt |
rv |
| s |
sb |
sc |
sd |
sf |
sg |
- |
sj |
sl |
sm |
sn |
sp |
squ |
sr |
ss |
st |
sv |
| t |
tb |
tc |
td |
tf |
tg |
- |
tj |
tl |
tm |
tn |
tp |
tqu |
tr |
ts |
tt |
tv |
| v |
vb |
vc |
vd |
vf |
vg |
- |
vj |
vl |
vm |
vn |
vp |
vqu |
vr |
vs |
vt |
vv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : table des groupes
de deux consonnes en latin. Cette table oriente la recherche du
lecteur, qui peut cliquer sur les liens. Elle dirige aussi bien vers les
groupes consonantiques
(1) en latin, la consonne gu n'existe qu'après n.
Le découpage de la chaîne parlée en syllabes (
Pour le latin comme pour la majorité des autres langues (?), un groupe
biconsonantique est en général composé d'une première consonne formant
la
(CIAP:42) « Examiner le sort de la consonne
En ancien provençal (il en est de même en oc ancien et moderne) toutes
les consonnes finales de syllabe ne subissent pas le même traitement ;
en effet, leur sort est fonction : a) de la série à laquelle elles
appartiennent et b) des tendances générales qui régissent les systèmes
et qui sont susceptibles de varier suivant les
La sonorité est le degré de perceptibilité d'un son, c'est-à-dire
l'intensité perçue, la force. Pour simplifier, le degré de sonorité est
le degré d'ouverture de la bouche (à ne pas confondre avec sonorité
"vibration des cordes vocales pour les consonnes
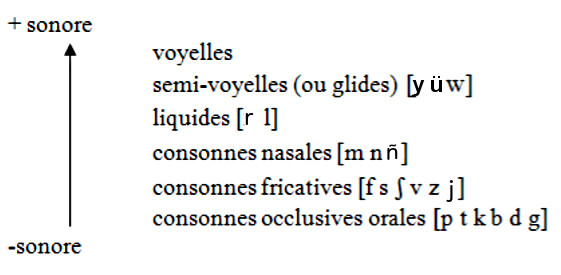
Schéma
ci-dessus : échelle de sonorité (d'après
Principe de sonorité : la
sonorité doit croître du début d'une
Loi de contact entre syllabes :
le contact préféré entre deux syllabes consécutives exige que la fin de
la première syllabe soit plus élevée en sonorité que le début de la
seconde" (
Il faut émettre des restrictions pour cette loi, notamment pour le cas difficile des muta cum liquida (ci-dessous) :
(SSMML:271) à propos du paradigme du mot latin colubra "couleuvre" : "En tout état de cause, ce paradigme montre avant tout que le statut syllabique de muta cum liquida ne peut pas être déduit de ses simples propriétés phonétiques ou de sa courbe de sonorité [...]").
Certains groupes consonantiques du latin classiques proviennent d'anciens groupes ; souvent il y a eu assimilation régressive (PHL4:128).
Max Niedermann donne des idées générales affectant les langues :
(PHL4:128) "Lorsque, dans une langue quelconque, deux consonnes entrent en contact, leurs propriétés articulatoires tendent à se niveler, celles de la seconde étant anticipées en tout ou en partie au moment de l'émission de la première ou celles de la première se reportant inversement par la force de l'inertie en tout ou en partie sur la seconde. Ce phénomène est connu sous le nom d'assimilation. L'assimilation peut porter sur la sonorité, sur le mode d'articulation ou sur le point d'articulation. Elle est dite progressive ou régressive suivant que c'est la première des deux consonnes qui exerce son influence sur la seconde ou que c'est la seconde qui agit sur la première. En latin, l'assimilation régressive était beaucoup plus fréquente que l'assimilation progressive."
(PHL4:128)
"Assimilation ayant porté sur la sonorité" : (assimilation du trait de voisement, ou trait de sonorité)
"une occlusive sonore devenait sourde devant une occlusive ou une fricative sourdes"
"une occlusive ou une fricative sourde se sonorisaient devant une occlusive sonore".
Dans la genèse de l'occitan : pĕrtĭcă(m) > AO pęrga, pęrja, pęrcha, pertẹga "perche" : perga montre que pour *pertega > *pertga, on peut imaginer l'évolution rtg > rdg > rg. Par contre, percha signifie l'évolution pĕrtĭcăm > *pertca > *perca > percha.
En français actuel, le phénomène est une tendance générale : soit dans des mots empruntés au latin classique ou à une autre langue ("absent", "anecdote", "Mac Do"), soit à l'occasion de syncopes en "français standard" (du nord de la France) : "médecin" prononcé "métsin".
Durcissement devant sourde (
B-S : absent [aps
D-S : médecin [méts
J-C : fam. "j'crois pas" = "ch'crois pas", "quand j'connais pas" = "quand ch'connais pas"
J-F : fam. "quand j'fais ça" = "quand ch'fais ça"
J-P : fam. "quand j'peux pas" = "quand ch'peux pas"
J-S : fam. "j'sais pas" = "ch'sais pas" = "ché pas"
J-T : "les jetons", "faux jeton" [
V-T : "sauvetage" [sóftaːj],
"louveteau" [l
Sonorisation devant sonore (ou voisement devant voisée) :
K-D : anecdote [anègdòt] (en fait : "k mi-sonore", CNRTL."anecdote"), aqueduc [agduk], Mac Do [magdó]
S-G : "au second tour" parfois prononcé [ó zgó̃ tʋːr]
Voir le témoignage de Quintilien :
(Quintilien De institutione oratoria, I, 7)
7 Quaeri solet, in scribendo praepositiones sonum
quem iunctae efficiunt an quem separatae observare conveniat, ut cum
dico "optinuit" (secundam enim b litteram ratio poscit, aures magis
audiunt p)
8 et "immunis" (illud enim quod veritas exigit,
sequentis syllabae sono victum, m gemina commutatur.)
9 Est et in dividendis verbis observatio, mediam
litteram consonantem priori an sequenti syllabae adiungas. "Haruspex"
enim, quia pars eius posterior a spectando est, s litteram tertiae
dabit, "abstemius", quia ex abstinentia temeti composita vox est,
primae relinquet.
"On demande si, en écrivant, il convient de se conformer au son que rendent les prépositions quand elles sont jointes à un mot, ou à celui qui leur est propre, comme dans le mot obtinuit, où la raison demande un b à la seconde lettre, quoique l'oreille entende p, et dans le mot inmunis, où cette n, qui est la lettre exigible, se trouvant effacée par le son de la syllabe suivante, est changée en une double m. Il faut aussi prendre garde, quand on est obligé de partager les mots en écrivant, si la consonne du milieu appartient à la syllabe qui précède, ou à celle qui suit : ainsi, dans aruspex, la dernière partie de ce mot venant du verbe spectare, la lettre s doit être réunie à la troisième syllabe, et dans abstemius, mot composé qui désigne l'abstinence du vin, abstinentia temeti, la lettre s sera laissée à la première syllabe."
(ŒCQ1:79).
Consonne + c
Consonne + f
(PHL4:132)
(PHL4:132)
(bf > *pf > ff) obfendo > *opfendo > offendo, obfero > *opfero > offero
(PHL4:132 )exfero > ecfero (Plaute) > effero
(PHL4:132) (df > *tf > ff) adfero > *atfero > affero
(rétablissement : nf) : p. 68, p 155-156, même la voyelle brève est rétablie (confir, enfèrn, enfant mais voir cas sujet enfas : ns), mais des variantes montrent apparemment le non retablissement de n : AO. cofermar, cofir, ifèrn (et efan ?) FEW 4:666b, 667b note 2
(PHL4:132)*opificina > opficina > officina
(hors PHL) *disfamo > diffamo "divulguer ; diffamer" *disfero > differo "disperser ; différer, remettre", disfacilis > difficilis "difficile"...
voir df ci-dessus
Les formes obfero, adfero, obfundo, adfigo... sont des doublets issus de recompositions analogiques.
Consonne + g :
p. 142-143 : occlusive + g > gg, obgero > oggero "j'offre, j'octroie"
p. 142-143 : adgero > aggero "j'amoncelle, j'entasse"
Consonne + t
(PHL4:128) Voir par exemple le type *ăgtŏs >
āctŭs : la sonore devient sourde devant
sourde (ci-dessus), et de plus la voyelle antécédente devient une
longue : c'est la
ăgĕre => supin ăgtum > āctum ;
lĕgĕre => supin lĕgtum > lēctum ;
Mais făcĕre => supin făctum : il n'y a pas d'allongement de la voyelle ă.
(LLHO.)
Cependant, les descendants romans de lectŭm témoignent d'un e bref : lĕctŭm : oc liech / lièit, fr "lit" (diphtongaison devant yod) à "Diphtongaison romane").
Je ne trouve pas de développement au sujet de ce paradoxe, mais ce cas ressemble à l'amuïssement de n devant f ou s : il a pu y avoir disparition de g en un premier temps, avec allongement compensatoire de la voyelle : lĕgtŭm > *lētŭm, puis rétablissement de g par analogie sur lĕgĕrĕ, lĕgō... suivi de l'assimilation du trait de voisement (ci-dessus). Dans la langue savante, le e long serait conservé (lat.class.) : *lētŭm > *lēgtŭm > lēctŭm comme dans īfans > īnfans, alors que dans la langue populaire, le e serait redevenu bref : *lētŭm > *lĕgtŭm > lĕctŭm comme dans īfans > infas.
p. 142 :
occlusive + g > gg,
occlusive + c > cc,
occlusive + qu > cqu,
occlusive > bb
bt > pt : *scribtum > scriptum, *nubtum > nuptum, p. 129 subtilis prononcé suptilis, plebs prononcé pleps... ("Assimilation ayant porté sur la sonorité")
Voir ci-dessous la loi occlusive +
nasale > nasale + nasale.
(p. 130) : Type *secmentom > segmentum (et *sopnos > *sobnos > somnus, *prismos > *prizmos > primus...), p. 134
(p. 141) : *tolno > tollo
(alnus et ulna : contact entre l et n plus récent : p. 141-142)
Consonne + liquide (l, r)
(p. 130) s > z n'est qu'une étape menant à l'amuïssement : *disruo > *dizruo > diruo "je démolis", preslum > *prezlum > prelum "presse ; pressoir".
p. 137 : occlusive + r > rr (semble rare, car dr, tr... conservés) : abrapio, subrapio > arripio, surripio (aussi latin vulgaire : arripare)
p. 138 : occlusive + l > ll : adloquor > alloquor "j'adresse la parole à ; je harangue, j'exhorte" ; *gradlai (gradior "je marche") > grallae "échasses"
Consonne + s (ci-dessous : occluvive labiale + s)
a-, ab-, abs- (triple forme) est exactement comparable à e-, ec-, ex- (p. 132)
occlusive dentale + s (p. 133)
adsequor > *atsequor > assequor "j'atteins"
*pets > pes "pied" (mieux expliqué dans Wiki que miles "soldat")... (dégémination de s)
occlusive labiale + s (p. 129)
bs > ps : nubsi > nupsi, *scribsi > scripsi
absinthium (< ἀψίvθιοv) > (DOM "aussens", "aissens"), *axinthium, (axentium, IXe siècle) remplace absinthium et évolue en aissent.
ns > s : p. 155-156 (amuïssement de n devant f et s)
liquide + s (p. 140) :
Il y a assimilation progressive : *ferse > ferre, *velse > velle, *wersen > verres "verrat", *kwolso > collus...
Remarque : certains aspects sont difficiles à élucider en raison de la réfection possible des mots en latin populaire, dont les traces à l'écrit sont évidemment quasiment inexistantes. Par exemple : ructare > *ruptare > rotar, "roter", captīvŭs > *cactivus (> caitieu, cautieu, catieu, "chétif").
L'occitan, comme d'autres langues romanes (mais pas toutes), a tendance
à ouvrir les syllabes
Je retranscris les propos très instructifs de CIAP:43 :
« La syllabe latine était
1. La syllabe latine ouverte a conservé ce
caractère (faba > fava). Ce
n'est pas un fait absolument normal et régulier : en italien par
exemple, la
2. La syllabe
a. réduction des
b. réduction, par une assimilation
complète, de ou des éléments consonantiques
c.
Pour l'occitan, une consonne
Pratiquement toutes les consonnes peuvent être concernées ; l'aboutissement est souvent i, parfois u (CIAP:43).
La vocalisation de la consonne
Voir aussi B-T
: dēbĭtŭm > dēbĭtăm > fr
dette / oc deute, dèude
(en AO
le genre est variable :
Voir aussi vocalisation
de v / b final et
préconsonantique.
Voir aussi ci-dessous amn, ann > aun.
Remarque, pour l préconsonantique : en catalan et dans le sud-ouest de la France :
Pour consonne implosive > u,
en catalan parfois l'aboutissement est l
(à étudier). Par exemple, pour le fleuve Aude
: Alde, decima > cat delme,
a.gasc.
delma "dîme" (LNDFA), tĕgmĭnĕm
> gallicien t
|
latin
LPC
|
|
occitan
|
|
- p
/ b + occlusive-
|
|
-ut-
|
| -pt- |
-ut- |
|
| scriptum |
escriut |
|
| -bt- |
-ut- |
|
| gab(a)ta |
gauta |
|
|
|
|
|
|
- k
/ g + occlusive-
|
|
-yt-
|
| -kt- |
-yt- > -ch- |
|
| factum |
fait > fach |
|
| (voir
évolution
de /kt/) |
||
| -gd- |
-yd- |
|
| frig(i)dam |
freida |
|
|
- t
/ d + occlusive-
|
|
-yt-
|
| -tC- |
? |
|
| pas
d'exemple |
||
| -dt- |
-yt- |
|
| imped(i)tare |
impeitar |
|
Tableau : l'occlusive devant une autre occlusive est vocalisée
captivus > cautieu, caitieu
adaptus > asaut, asautar... adaut, adautar...
abs :
absĕm
(de nom absēns
> absēs : part.
prés. latins) > abs
> AO
aus, laus "non cultivé (en
parlant d'une terre)".
/ks/ > /ys/
(pour ĕx et ŏx voir diphtongaison
conditionnée par y)
bŭxŭ(m) > bois
Caxanicis (année 956 Caxanicus) > Caissargas "Caissargues" (30)
cŏxă(m) > cuèissa
exāmĭnĕm > eissame
sĕx > sièis
laxārĕ > laissar
ps :
Déjà en latin vulgaire, ps > ss : (ALLRL:5) (lat. vulg. ixī /ĭs.sī/ « ipsī » (Leumann, 1977 : 204), x est une graphie hypercorrecte pour ss)
rs :
extrorsŭm > estrọs
Octave Nandris donne (CIAP:44) : "eructare > rotar, scriptu > escrit, rotulu > rotle-role, subtus > sotz, etc.". Remarque : pour (e)ructare, il y a eu évolution précoce en ruptare (CNRTL).
(spatula > espalla, rotulum > rolle, spinula > espilla)
Adaptation : en général, consonne + m,
n > r ou l + m, n (absinthium
> arsent à côté de aisen,
ausen "absinthe" ; bodina
> borna à côté de boina
"borne" ; almosina > almǫrna,
almǫsna, à côté de almǫina
"aumône") "Il s'agit assurément d'un phénomène non d'évolution mais
d'adaptation (traitements acquis sans formes intermédiaires) : la
consonne
Le groupe "consonne + n" n'apparaît qu'à la faveur d'une syncope de proparoxyton, voir voie 3 à consonne-N. En occitan, la syncope semble se produire surtout dans la situation occlusive -voyelle-n, auquel cas on obtient occlusive-r, qui est une muta cum liquida.
plătănŭm > blai, rouerg blasi, Vel bladre.
|
latin
LPC
|
|
occitan (et français)
|
| Carnŭtĭs > Cartŭnĭs
(LNDFA)
> *Cartnis |
fr Chartres |
|
| cŏphĭnŭ(m) |
còfre "coffre" |
|
| dĭācŏnŭ(m) | diacre (diague...) "diacre" |
|
| Lingŏnĭs |
fr Langres (52) | |
| Lŭndĭnŭ(m) |
Londre "Londres" |
|
| ŏrdĭnĕ(m) |
AO
|
|
| pampĭnŭ(m) |
pampre (pampe...) "pampre" |
|
| plătănŭ(m) |
Vel bladre (blai, blasi...) | |
Tableau. Évolution n
> r après occlusive.
pampinus > pampre (CNRTL)
diaconus > diacre
tympanon > (Byzance ?) timbanon > *timbne > timbre (FEW 13/2:455b)
Cophanus > coffre
Carnutis > Cartunis > Chartres (Thomas, article sur l'Aude)
Après nasale
Voir l'évolution de mn
de type espagnol, ci-dessus : hominem
> *omne > hombre.
nb > rb
canbe >
carbe "chanvre"
nc > rc
Dans Prob, on trouve :
"pancarpus non parcarpus" "le mot correct est pancarpus ["composé de toutes sortes de fruits"] et non parcarpus".
Ou bien c'est une assimilation consonantique ?
ng > rg :
-ānĭcis > -ánegues > -angues > ("par différenciation") -argues (noms de lieu du Gard...)
excŏmmŭnĭcāre > AO escomengar > AO escomergar
manica > manga > marga
C'est très peu certain mais possible dans quelques rares cas. Dans les
mots latins en ns, le n souvent amuï en latin
antique, et souvent rétabli par voie savante (cònse,
conseu...) ne semble pas se confondre avec le r
devant s, lui-même souvent
assimilé au s : corsejar,
emborsar, porcieu.
Manselha (voir s > ns) > Marselha ? ; c'est possible mais on peut expliquer le r autrement (voir étymologie de Marselha)
mancipium
> AO
mancip, massip, marsip "jeune
homme"
inverse : FEW : (voir escarrabilhar)
: esmarveillier / esmanveillier
nv > rv :
Dans les exemples ci-dessous, dans nv, le v provient très probablement d'un w épenthique non écrit en latin.
jānŭārĭŭm /yanuwariu/ > genovier > AO gervier, genvier "janvier"
manibus jurare > AO manbes / manves jurar" "jurer en personne" (PMM)
*manuata > a.fr. manvée "poignée"(339)
manualem
> AO mambal
"manuel"
d'après moi : manuarium > *manovier > AO marvier "alerte, prompt"
tĕnŭĕm> tenve > a.fr. terve "ténu"
nm > rm : (voir ci-dessous)
ănĭmăm > arma "âme"
ănĭmālĕm > oïl : Normandie aumé "jeune taureau, .." Doubs, Haute-Saône armau "jeune bœuf, ..." (FEW 24:588b), sursilvan armal, (FEW 24:592a). En domaine d'oc, il n'existe que la forme savante animau, sauf pour le dérivé ănĭmālĭăm > aumalha / armalha (FEW 24:590a). Les descendants de ănĭmālĭăm ont une large répartition géographique (voir attestations dans FEW 24:590a) et pourtant aucune occurrence dans DOM.
mĭnĭmārĕ > mermar "diminuer, amoindrir"
Conservation (parfois savante, mais aussi populaire : m, n, l, s, r sont "fortes" et ont tendance à se conserver : tempus > tems, vendita > venta, coloratum > colrat, vespa > vespa, ardere > ardre). Et type rotulum > rotle ?
Cette partie est en chantier.
Le groupe bt rejoint pt : subtŭs > sota "sous".
En latin classique, les groupes primaires cb, cd, cf, cg, cm, cn, cp, cv (CV) n'existent pas (sauf dans les emprunts aux autres langues).
Par contre, cl, cr sont des muta cum liquida très représentées, et x (= cs) et ct sont également très représentés.
Voir dans la Romania orientale : ct > pt (Wikipédia balkan romance languages) : cŏxăm
> roum coapsă
Voir diphtongaison conditionnée devant i < k + consonne.
laxārĕ > oc laissar, a.fr. laissier "laisser"
Voir dans la Romania orientale : ct > pt (Wikipédia balkan romance languages) : ŏctō > roum opt "huit"
Voir l'étude particulière ci-dessous : ct, gd.
Dans ce paragraphe, je développe des idées personnelles (mars 2021).
Au départ, g semble avoir
souvent évolué en
Pour *frĭgdŭs, -ă "froid" (voir frīgĭdŭs), l'évolution est nettement différente en occitan et en français : au féminin, la consonne devient /dj/ en occitan (freja, vueja), mais reste d en français ("froide", "vide") (le t dans vŏcĭtŭs a eu le temps de se sonoriser > d).
(IPHAF:46) :
frĭgdă(m)
> */fré
Pour l'occitan, selon moi on doit envisager une palatalisation progressive de d (> /dj/) > freja.
Voir frīgĭdŭs.
Voir aussi vŏcĭtŭs (> *vŏgdŭs).
Le groupe gl
nĕglēctŭm
> AO
nel
> a.fr. anelei "tort, faute".
On y voit que la consonne l n'a pas été palatalisée. Le g n'a laissé aucune trace en occitan comme en français ; il est donc difficile de proposer un scénario sur l'évolution de g.
Le même mot nĕglēctŭm a une descendance connue en italien dialectal : (Arcevia) neghetta "miseria estrema", dérivé neghittoso "négligé ; négligent" (FEW 7:89a). Il est remarquable qu'en Italie, ce soit la première consonne g qui soit conservée (à étudier).
Dans cŏāgŭlārĕ
> *cŏāglārĕ
> calhar, "cailler" etc.,
au contraire, pour gl
Certains mots d'origine grecque contiennent gm,
mais aussi certains mots latins. La consonne g
devant m a évolué en /
Pour l'occitan et le français (IPHAF:47 pour le français) :
σάγμα (ságma) "charge,
bât" > sagmă(m)
> */sa
φλέγμα
(phlégma) >
phlegmă(m)
"inflammation" > */fle
Seulement pour l'occitan :
φρἀγμα (phrágma) latinisé en *fragmă ? > frauma "Obione faux-pourpier (plante)" (FEW 8:399b).
tĕgmĭnĕ(m) > tèume "portion de tillac formant une sorte de cabane à l'avant d'un bateau non ponté", voir proparoxytons en m-n.
Rarement, la consonne g a
été vocalisée : Santa Agnès (S. Agnetis vers 1160) > Santa
Aunès "Saint-Aunès" (
Sinon, voir gn à "Troisièmes palatalisations".
Le latin possède queques mots avec gr
Le scénario serait (pour flagrārĕ > flairar, "flairer" : pour le français : IPHAF:45, 57, 76, 80, 184) :
fragrārĕ
"exhaler une odeur (suave)" >
*flagrārĕ >
agrŭm "champ" > AO aire "champ ; nid, aire d'oiseau".
fragrārĕ > *flagrārĕ "exhaler une odeur (suave)" > AO flairar "flairer"
ĭntĕgrŭm > AO entieir ; "entier" (voir ĭntĕgrŭm à "Diphtongaison conditionnée")
nĭgrŭm >
AO
n
Il existe une assimilation progressive ancienne mb > *mm, puis > m par dégémination, affectant l'espagnol, le gascon, une partie du languedocien (voir TDF paloumbo / paloumo, espagnol paloma, de lat palumba), et également en Italie : (GSLID1:359, §254) .
lumbus > esp. lomo ;
novembrem > *novemme> gascon noubéme
palumbam > paloumbo / paloumo, espagnol paloma ;
plumbum > esp. plomo, ambos > ancien esp. amos, esp. mod. ambos.
Dans GIPPM-2 il n'existe pas de mention de cette assimilation.
En général, nd est conservé :
ĭndĭgnārī > oc endenhar, fr indigner ;
mĕndīcārĕ > oc mendigar, fr mendier ;
ŭndăm > oc onda, fr onde ;
vĭndēmĭăm > AO vendẹmia, vendẹmnha, vendẹnha "vendange".
Cependant, quelques cas montrent une assimilation
- Vindasca, Vindausca (IVe siècle) > Venasca
"Venasque" (84) (Venasca,
- ĭnfŭndĭbŭlŭm > AO enfonilh, efonilh "grand entonnoir", OM enfonilh à
l'ouest du Rhône (voir TDF), Vel enfonhilh (avec [
- prēndĭs > prenes "(tu) prends" ; mais le paradigme de prendre serait influencé par pren "(il) prend" selon GIPPM-2:217.
- Voir aussi la discussion à l'étymologie de anar "aller", it andare (< *ambĭtārĕ ?)
Je me demande si une tendance ne s'est pas dessinée dans le cas de nd + i, tendance qui s'apparenterait à nd + ĭ en hiatus, dans les cas ĭnfŭndĭbŭlŭm, prēndĭs, où l'on obtient des variantes en n et nh.
On connaît aussi l'évolution inverse : nn > nd (ci-dessous).
hapsŭ(m)
> aus "toison"
capsă(m) > caissa
capsŭ(m) > cais "mâchoire"
capsŭlă(m) > caussula
exlapsŭ(m) > a.lim. eslaus "ouverture par laquelle s'échappe le trop plein d'un étang" (FEW 5:177b).
ĭpsŭ(m) > AO ẹis, ẹps, ẹus, ẹs...
Typiquement, on aurait : pt
> tt > t : sĕptĕm
> sèt "sept" (GIPPM-2:165). Le groupe pt
rejoint le groupe bt : sŭbtŭs > sota "sous".
*accaptāre (< ad + căptāre ou < acceptāre) > acaptar "se procurer ; acheter..."
aptŭm "approprié, adapté" > AO at "besoin, profit", a.frpr. ait "bien né" (GirRouss in FEW 25:62a)
captare > a.lyon. chattar (FEW 25:62a)
captīvŭ(m) "prisonnier..." > AO cautieu, caitieu, catieu "captif ; aussi "chétif", Roland caitif ; à étudier : captīvŭm aurait évolué en *cactīvŭs (FEW 2:332a,b, CNRTL "chétif"), peut-être croisé avec gaul *cactos "serviteur".
ădaptŭ(m) (attesté au VIIe siècle) > asaut, asautar... adaut, adautar...
rŭptŭ(m) "rompu" > rot, rŭptă > rota
Voir S-N à "évolution des proparoxytons".
ăsĭnŭm > (sud-ouest) aine "âne"
patrem > paire
matrem > maire
fratrem > fraire
petram > pèira
potrire > poirir
Je réunis dans le même paragraphe l'évolution de ct et gd
Voir ctĭ, ctĕ + voyelle (făctĭōnĕm > façon, faiçon).
Pour /kt/ latin, on peut distinguer trois aboutissements occitans principaux : it, ch, ich (GIPPM-2:171-186). Le type ich me semble peu caractérisé (voir 3 ci-dessous). Par ailleurs il existe un type
Voir notamment :
dīrēctăm > dreita, drecha, dreicha "droite", carte 0427 de l'ALF.
strĭctăm > estreita, estrecha, estreicha, carte 0524 de l'ALF.
(GIPPM-2:173 cite ces deux cartes de l'ALF).
Schéma général (après voyelle tonique ou atone) :
| -ct- latin | > / |
> / |
|
|
(dīrēctăm) |
> /t |
> /t |
|
| > /yt |
> , ∅ en fin de mot |
(1) Pour le type dreita, on perçoit immédiatement le rapprochement avec le français "droite" (a.fr. dreite ; puis éi̯ > ói̯)
(2) Pour le type drecha, on perçoit immediatement le rapprochement avec l'espagnol derecha.
(3) Le type dreicha
est certes nettement représenté dans la carte ALF "droite", mais ce type (
Pour les détails de l'évolution
phonétique, voir ci-dessous.
lactĕ(m) > AO lach, lag, lait, layt "lait"
lactūcă(m) > AO lachuga, laytuga "peinture"
trŭctă(m)
> AO tr
Voir ctNSP, GIPPM-2:179-181 (étude peu claire), IPHAF:74, 136.
Schéma général (après voyelle tonique ou atone) :
| -nct- latin | > AO /ñt/ > /nt/ (oc ponta) | > |
|
(pŭnctăm) |
> /nt |
(1) La variante pointa est donnée en (d) par le TDF ; à mon avis on a affaire à un i diphtongal de type français devant /ñ/ implosif.
Pour étudier les descendants des mots latins en
Mais l'étude des toponymes en Sanch
(ci-dessous) permet de constater une assez bonne correspondance
géographique entre "la zone drecha"
(ALF carte
0427) et "la zone Sanch".
Cela permet de supposer que l'évolution de
Voici quelques exemples montrant les différents aboutissement AO de
*complanctă(m) > AO complancha, complansa (peut-être pour /kó̃plãtsa/), complanta, complainta "complainte"
jŭnctă(m)
> AO j
*pĭnctūrăm (< pĭctūrăm) > AO penchura, peintura, pintura "peinture"
pŭnctă(m)
> AO p
pŭnctŭ(m)
> AO p
sanctŭ(m)
> AO sant,
san, sanh, sayn, sanht, saint... (et les f.dial. en e
: senh...), sanch
(type Sanch Amans...) "saint"
tĭnctă(m) > AO tencha, tenta, tincha "teinte"
ŭnctŭ(m) > AO onh "matière onctueuse", onhz (au cas sujet, ci-dessous GIPPM-2:180-181), onch (voir onchar "oindre")
Proclises sanctu > santu, sanch > san
GIPPM-2:180 (r.g.f.d.a.) "Hors certains noms de lieu, le
continuateur de sanctu, -a a
partout -nt, -nto ~ -a ~ -e
[...], ce qui peut être dû à la fréquence d'un débit rapide en mi-proclise
latine, san(c)tu, ou en proclise
romane devant consonne, exemple san(ch)
GIPPM-2:180-181 (r.g.f.d.a.s.p.) "On rencontre en
Notamment dans les toponymes issus de Sanctŭs,
Sanctă + nom de saint(e) commençant par une voyelle, on a
souvent obtenu la forme
Dans ces cas, la mécoupure est ancienne et déjà fréquente en occitan,
c'est-à-dire que le nom originel du saint n'a plus été reconnu déjà à
une époque ancienne : Sanch Amans
a été perçu comme Sant Chamans.
Voir Sancti Chalumundi (année 1247) pour "Saint-Chamond" (42) (voir ci-dessous dans le tableau Sanctŭs Annemŭndŭs).
Saint Chélir (1230-1231) pour Saint-Chély-d'Apcher (48) (voir ci-dessous dans le tableau Sanctŭs Hĭlărĭŭs)
HLPA:45 : "Ainsi, sanctus
Amantus (nom d'une chapelle et d'un quartier suburbain) était
devenu sanct Aman et sanch
Aman. Le vulgaire a transposé le ch
et en a fait san Chaman, forme
qui est restée, et c'est sous ce vocable qu'est connu actuellement ce
quartier."
De très nombreux autres Sanctŭs + nom de saint commençant par une voyelle ont donné Sant... Les Sant Amans, Sant Andrieu, Sant Ilari... sont légion. En voici l'explication :
- certaines de ces formes sont susceptibles d'avoir été "rectifiées" en redonnant le bon nom du saint précédé de Sant (les formes anciennes écrites sont à rechercher au cas par cas ; on peut trouver des formes en Sanch) ;
- surtout, le toponyme se trouve dans la
zone dreita et non drecha
de la carte
0427 de l'ALF. Une rapide analyse montre une assez bonne
coïncidence de la "zone drecha"
avec la "zone Sanch" (voir ces
toponymes dans le tableau ci-dessous). De l'est vers l'ouest, les
départements contenant un ou des toponymes en Sanch
sont : 13, 84, 30, 48, 34,
12, 15,
19, 46, 24, 16, 33
; ils correspondent (parfois marginalement) aux zones actuelles où l'on
dit drecha ou dreicha
pour "droite". Par ailleurs en
Je donne ci-dessous les cas où la forme
|
latin
LPC
|
|
occitan
|
|
français
|
|
Sanctŭm
/ -ăm |
|
Sanch
(perçu
comme Sant Ch..., Sant S...)
(1) |
|
(souvent) Saint-Ch... |
|
|
|
|
|
|
| Sanctă(m) Agathă(m) |
|
(Sancha Ata) Sant Chate (30) | Saint-Chaptes (30) | |
| Sanctŭ(m) Albīnŭ(m) |
|
Sanch Albin (24) |
|
Saint-Aubin-de-Lanquais (24) |
|
|
|
|
|
|
| Sanctŭ(m) Amandŭ(m) (1) |
|
Sanch Amant (24) |
|
Saint-Amand de Coly (24) |
|
|
|
|
|
|
|
Sanctŭ(m) Amantĭŭ(m) (et Amāsĭŭm?) (2)
|
Sanch Amàs (13) |
Saint-Chamas (13) | ||
|
|
(84, quartier d'Avignon) |
|
Saint-Chamand (84) |
|
|
|
Sanch Amans (15) |
|
Saint-Chamant (15) |
|
|
|
|
|
|
|
| Saint-Chamand (63, comm. de St-Julien-de-Coppel) | ||||
| Saint-Chamand (63, comm. de Busséol) | ||||
|
|
|
|
|
|
| Sanctŭ(m) Amarandŭ(m) |
|
Sanch Amarant (46) |
|
Saint-Chamarand (46) |
|
Sanctŭ(m) Andreŭ(m) (3) |
|
Sanch Andreu (3) |
|
Saint-André (3) |
|
Sanctŭ(m) Anĭānŭ(m) |
Sanch Inhan (34) (4) | Saint-Chinian (34) | ||
|
|
Sanch Inhe (4) |
|
Saint-Chignes (46, comm. de Gramat) | |
|
|
Sanch Inhe (4) |
|
Saint-Chigne (46, comm. de Saignes) | |
|
|
|
|
|
|
|
Sanctŭ(m) Annemŭndŭ(m) (5) |
|
Sanch Amont (42) |
|
Saint-Chamond (42) |
|
Sanctŭ(m) Arĕdĭŭ(m)
ou Arĭgĭŭ(m) |
|
*Sanch Eriés > Sant Seriés (34) (1) |
|
Saint-Sériès (34) |
| Sanctŭ(m) Astĕrĭŭ(m) |
|
Sanch Astier (24) |
|
Saint-Astier (24) |
|
|
|
|
|
|
| Sanctŭ(m) Ăvītŭ(m) (6) | Sanch Abit (24) | Saint-Chabit (24 commune de St-Sernin-de-Reillac) | ||
| Sanch Avit (24) | Saint-Avit-de-Vialard (24) | |||
| Sanch Avit (24) | Saint-Chavit (24 commune de Saint-Pierre-de-Côle) | |||
|
|
|
|
|
|
| Sanctŭ(m) Ēlĭgĭŭ(m) (7) | Sanch Èli (12) (7) | Saint-Chély-d'Aubrac (12) | ||
|
|
|
|
|
|
|
Sanctŭ(m) Eparchĭŭ(m) |
|
*Sanch Ibars > Sant Cibars (24) (1) |
|
Saint-Cybard (24, comm. de Mouleydier) |
|
|
*Sanch Ibars > Sant Cibars (33) (1) |
|
Saint-Cibard (33) | |
|
|
*Sanch Ibars (16) (1) |
|
Saint-Cybard (16) | |
| *Sanch Ibars d'Euse (16) (1) | Saint-Cybardeaux (16) | |||
| Sanch Ibars (19) (1) |
Saint-Ybard (19) | |||
|
Sanctŭ(m) Eumachĭŭ(m) |
|
Sanch Amaci (24) |
|
Saint-Chamassy (24) |
|
|
|
|
|
|
| Sanctŭ(m) Hĭlărĭŭ(m) (7) | Sanch Éler
(Sanch Ílir)
(48) (7) |
Saint-Chély-d'Apcher (48) | ||
| Sanch Éler
(48) (7) |
Saint-Chély-du-Tarn (48) | |||
|
|
|
|
|
|
| Sanctŭ(m) Hippŏly̆tŭ(m) |
Sanch Apòlit (13, quartier d'Aix-en-Provence) | Saint-Hippolyte (13) | ||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : conservation de Sanch dans les noms de lieu
mécoupés.
(1) Dans les régions où ch est réalisé [ts], on a
perçu Sant S... (Sant
Cibars, Sant Sériés...). Dans ces derniers toponymes, l'absence
d'uniformité orthographique provient d'habitudes ; la logique exigerait
plutôt Sant C... (Sant Ceriés).
Remarque : le -s dans Sant
Cibars, est attesté en AO ("Ibarc"),
Wikipédia donne Sanch Ibarch (19), à étudier (c + ĭ en hiatus).
(2) Plusieurs noms de saints ont pu se confondre dès le Moyen Âge, et
la situation est confuse : sanctŭs
Amantĭŭs, sanctŭs Amāsĭŭs (SDBDR2:930 : pour "Saint-Chamas", année 1328 : "Amantius paraît être mis pour Amasius, évêque d'Avignon", mais TGF3:1612
: année 969 : S. Amantium). Il
existe aussi sanctŭs Amandŭs
et sanctŭs Amandĭŭs. En toute
logique, Amantĭŭm donnerait
(3) Pour Sanctŭ(m) Andreŭ(m) >
Sanch Andreu, ma source est GIPPM-2:180 : Sen
Chandreu, "périgourdin en 1247".
(4) Pour Sanctŭs Anĭānŭs,
voir notamment ctNSP:607. Pour le i
dans Sanch Inhan, voir type
Montānĭācŭm > Montinhac.
Sanch Inhe correspond à
"Saint-Igne" du Tarn-et-Garonne ; ce serait le même saint qu'Agnan
ou Aignan ? À éclaircir.
(5) Voir Annemŭndŭm > Aunemŭndŭm.
(6) Pour Sanctŭs Ăvītŭs : ctNSP:607. Les autres "Saint-Chavit" du sud-ouest de la France ont probablement la même origine.
(7) Pour Sanctŭm Ēlĭgĭŭm
"Saint Éloi", dès 1266 il y a confusion entre le nom de cette commune (12) avec Sanctŭm
Hĭlărĭŭm "Saint Hilaire" (TGF3:1612 : S.
Yleri). Sanch Éler
semble partout prononcé /sãt
|
latin LPC
|
|
occitan
|
|
français |
|
Sanctă(m)
|
|
Sancha
(perçu comme Sant Ch... : changement de genre !) |
|
(souvent) Saint-Ch... |
|
|
|
|
|
|
| Sanctă(m) Agăthă(m) |
Sancha Ata > Sant Chate (30) | Saint-Chaptes (30) | ||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : conservation de Sancha dans les noms de lieu mécoupés.
Anthoine Thomas (EPF:136-139) fait remonter Sant
Chier (actuellement Saint-Chef,
Selon F. de La Chaussée (IPHAF:46) :
"En Gaule et dans la
Toujours selon F. de La Chaussée, comme il n'y a qu'un déplacement
horizontal de la langue, vers l'avant : k
>
Exemples (IPHAF:46) :
factŭ(m)
>
Pour /ks/ (x)
(ci-dessous) :
laxāre
/laksaré/ >
ŭxōrĕm > AO oisọr "femme, épouse"
(GIPPM-2:176)
"ct devient donc un groupe de
consonnes mouillées, donc mal occludées, à points d'articulation
rapprochés. Les résultats attendus d'un procès de fixation sont en
première ligne it
(différenciation d'aperture et de mouillure en conservant à peu près les
points d'articulation primitifs) et ch
(fusion en un seul phonème à point d'articulation moyen [...])."
On peut résumer ainsi la pensée de Jules Ronjat : /kt/ peut évoluer
soit en /yt/, soit en /t
On voit que J. Ronjat ne donne qu'une explication vague notamment pour
/kt/ > ch. Je propose un
détail de cette évolution ci-dessous.
Selon certains linguistes, les formes en ch
/t
Pour l'occitan : sources à chercher.
Pour l'espagnol : les formes espagnoles en ch
< ct montrent les mêmes aboutissement que les formes
occitanes en ch < ct : oc nuech
/ esp noche
"nuit", oc drecha
/ esp derecha
"droite", oc estrecha
/ esp estrecha
"étroite", etc. Les deux idiomes ont également nct
> nch : AO sanch
/ AE sancho
(voir ci-dessous).
Voici par exemple les explications de RLHI pour
l'espagnol (l'auteur reste vague sur /kt/ > ch
; il développe surtout le blocage de la diphtongaison romane, mais noter
la chronologie /kt/ > /yt/ > ch) :
RLHI:83-84 :
(trad.angl.,
s.p.s.)
"(...) les groupes [kt], [kl], [ks], [lt], au cours de leur
palatalisation, génèrent un [
Les voyelles simples proviennent des diphtongues secondaires comme on l'a vu juste ci-dessus, avec [éy], [èy], [ay] évoluant en [é], [é], [é]. Les évolutions typiques sont :
strĭctu "étroit" > [estrekto] > [estréyto] > [estrétʃo] estrecho
pĕctu
"poitrine" > [pèkto]
> [pèyto] > [pétʃo] pecho
lacte "lait" > [lakté] > [layté] > [létʃé] leche
Les voyelles
mŭltu
"beaucoup" > [móltó]
> [móytó] > [m
nŏcte "nuit" > [nokté] > [nòyté] > [nòtʃé] noche
De toute évidence l'évolution [óy] > [
Pour sanctum > fr "saint" : IPHAF:74 donne : *sanytu
> *saintu (mais comment concevoir *sanytu
avec [
Henri Gavel (EEPC:17-19) donne deux scénarios possibles pour
l'espagnol, tous deux plaçant l'aboutissement ch
comme résultant du premier aboutissement it.
Voici ces deux scénarios pour lactem
"lait", avec de plus la mention a
> e (lactem > leche)
; il emploie i̯ qu'il appelle
"i consonne" (ce serait donc
plutôt
Première hypothèse de H. Gavel :
lactem > *laite > *leite > (métathèse
it > ti)
*letie > leche ("on serait passé aux formes actuelles par un
simple changement du groupe t
+ i̯ en t +
Seconde hypothèse de H. Gavel :
lactem > *laite > (mouillure du t par i̯) *laiche > *leiche > leche ;
ou lactem > *laite > *leite > (mouillure du t par i̯) *leiche > leche).
H. Gavel estime que la seconde hypothèse est plus vraisemblable, et signale que c'est celle adoptée par R. Menéndez-Pidal.
É. Bourciez (EEPC-cr:382) estime que H. Gavel aurait dû supprimer les "singulières hypothèses de la p. 17 sur l'évolution du groupe ct" ; il doit faire allusion à la première hypothèse ci-dessus, en effet développée à la p. 17 (mais je ne vois qu'une et non des hypothèses), et il ne se justifie pas. En tout cas, je reprends l'idée d'une métathèse juste ci-dessous (mais sans passer par un stade /yt/).
Je propose une explication détaillée dans le cadre du premier scénario ci-dessus, avec deux voies parallèles (non successives). Pour "la voie 2", j'estime qu'il y a eu une métathèse dans le "domaine occitan drecha" et dans le domaine castillan :
voie 2 : /kt/ > /
Arguments :
- Dans ct, la consonne t est en position forte ; phonétiquement, elle est difficile à faire évoluer (cela dit, une telle consonne peut subir l'influence de la consonne précédente dans certains cas) ;
- Les palatalisations de ke, ki, puis ka, ont existé même en position forte, mais avec l'influence de e et i (puis a) subséquents.
- Cette métathèse a dû être favorisée par l'existence de nombreuses
- Cette métathèse est à rapprocher de */fréjda/ > /frédja/.
- Mots occitan en voyelle-it- sans qu'il n'existe de variante en -ch- : (en dehors des cas comme boita < en fait boista, etc., de variantes uniques de ct comme fuita, apeitar < expectare) :
coitivar (< cultivare)
suita, persuita
PRONONCIATION de -ct- :
*wahta > gaitar / gachar "guetter".
Ainsi (proposition personnelle) :
| /kt/
> */ |
> (voie 1 : vocalisation) /yt/ |
|
(dīrēctăm)
|
> (voie 2 : métathèse) */t |
De même pour le cas
| / |
> (voie 1 : palatalisation de n) /ñt/ |
|
|
> (voie 2 : métathèse) / |
(Voir notamment SSMML et ÉGCOL, le second article va plus loin dans les conclusions).
(PHL4:172, Remarque).
L'expression muta cum liquida provient des grammariens
latins qui étudiaient la
L'ambiguïté ainsi décrite par les auteurs antiques a induit en erreur
les linguistes contemporains, selon ÉGCOL : les auteurs antiques ont décrit un
système adadémique, artificiel, mais qui ne correspondait pas au latin
parlé, qui considérait toujours les muta cum liquida comme
Dans une première approche, on peut
dire que les muta
cum liquida sont des groupes
de deux consonnes capables de former une
Cette particularité des muta cum
liquida existe dans de nombreuses langues (réféfences ?). Elle
repose sur le
La notion de muta cum liquida
a d'abord été développée dans la
La
Par exemple le vers ci-dessous montre que vŏlŭcrĭs "oiseau" a une deuxième syllabe légère à la première occurrence, et lourde à la deuxième (vŏ-lŭ-crī puis vŏ-lŭc-rĭs), voir hexamètre dactylique.
(PHL4:174, ÉGCOL:306)
et primo similis volucri, mox vera volucris :
et prī | mō sĭmĭ | lĭs vŏlŭ | crī, mox | vēră vŏ | lŭcrĭs
| ͜ ͜ | ͜ ͜ | | ͜ ͜ |
"et d'abord semblable à un oiseau, puis un
véritable oiseau"
(Ovide, Les Métamophoses, 13, 607)
Pour le grec, les muta cum liquida
sont : t, d, th, k, g, kh, p, b, ph
suivis de l ou r
(AQSLM:16). Par exemple tr
dans πολύτροπος (polutropos)
"qui erre çà et là", avec uspilon bref. La
Sunt etiam syllabae, quæ communes dicuntur, cum aut correptam vocalem duæ consonantes secuntur, quarum prior aut muta quæpiam est aut f semivocalis et sequens liquida; aut...
"Il y a aussi les syllabes nommées communes [ambivalentes : parfois lourdes, parfois légères], composées soit d'une voyelle brève suivie de deux consonnes dont la première est en quelque sorte muette (muta, c'est-à-dire
Vers les mêmes années, Aphthonius, Charisius, puis Diomède développent aussi ce concept (leurs passages mériteraient d'être traduits et étudiés ici).
Concernant la consonne f, il faut ainsi remarquer que les grammairiens comme Donat étaient conscients que cette lettre joue le même rôle que des muta (
Voir aussi combinée,
groupe combiné.
Il s'agit de :
bl, br
cl, cr,
dr,
fl, fr,
gl, gr,
pl, pr,
tr
Deux combinaisons ne sont pas tolérées en latin : tl
et dl. Lorsque ces
combinaisons parviennent dans la langue latine, soit par
(TP:320) :
"Ainsi les groupes tl et dl sont inconnus et impossibles dans la plupart des langues romanes et l'étaient déjà en latin vulgaire (cf. fr. épingle de *épindle, lat. vulg. ueclus de uet(u)lus)."
En ancien occitan, dl n'est
pas connu, mais tl est bien
attesté à l'écrit. La prononciation était probablement bien [tl] (à
étudier). Voir les mots empruntés au grec, qu'on prononce naturellement
en français : athlète, atlas, et aussi avec les syncopes : att'ler,
pat'lin, pot'lé.
batlegua (var banlega "banlieue")
brutle "bruit"
butlada "les boyaux" (du latin bŏtellus ou bŏtŭlŭs "boyau")
crotlar "branler, trembler ; crouler" (de *crŏtălāre "secouer", ou moins probablement de *corrŏtŭlāre : CNRTL "crouler")
cr
espatla
"épaule" (var espala,
de spăthŭlăm
"spatule ; omoplate")
espitl
rotlar,
rutlar "rouler" (var
rolar, roclar < *rŏtŭlārĕ
ou *rŏtĕllārĕ)
r
rutlọṉ " (var rolọṉ, "rouleau" de drap)..."
sotlar
"soulier" (< sŭbtĕlārĕm).
Le phonème [v] n'existait pas en latin classique. Voir le V latin à nature
du waw ; voir l'apparition du phonème [v] à convergence
de b, v, f
invervocaliques. Au cours de l'évolution du latin vers les langues
romanes, vl et vr
ont été susceptibles d'apparaître dans d'assez nombreux mots.
On ne connaît aucun mot en AO ni en a.fr.
contenant le groupe consonantique vl.
Cependant dans le domaine d'oïl, tavle
"table" a existé dans le dialecte du Ponthieu dans la Somme.
Le groupe consonantique vr
est naturel en français : "chèvre", "lèvre", "sevrer", "vivre"...
Il faut noter que vr a bien
une nature de muta cum liquida
en Gaule du nord puisqu'il ne fait pas entrave :
fĕbrĕm
> fièvre, lĕpŏrĕm
> lièvre
caprăm
> a.fr. chièvre
(> "chèvre"), labrăm >
"lèvre", voir diphtongaison
française de a.
bĭbĕrĕ
> a.fr. boivre
(> "boire"), voir diphtongaison
française de é.
En AO, vr existe mais il semble marginal. L'évolution phonétique typique de l'occitan suit les schémas :
pr > br (caprăm
> cabra) ;
v'r > ur (vīvĕrĕ
> viure) ;
br > ur
(lībrăm > liura).
En chantier.
(Venasca:166) : "De toute façon, la coupe syllabique varie dans une même langue selon le temps, ainsi il est admis que le latin coupait jadis pat-rem [...]"
L'évolution des muta cum liquida est aussi abordée dans d'autres parties (cliquer sur les liens).
| br |
cr |
dr |
gr |
pr |
tr |
| bl |
cl |
dl (1) |
gl |
pl |
tl
(1) |
(1) dl et tl
ne sont pas tolérés en latin, mais ils peuvent apparaître soit par
Selon (TMCL.) (SSMML.)
cathedram > *catédra ? > cadiera "chaise" ;
(de même intĕgrŭm > entier, tonitrum > tonerre...) ;
Effet facilitateur sur les syncopes
(leporem > lèbre "lièvre")
Voir aussi la syncope "tardive" spīrĭtŭs > esprit.
(Voir SSMML)
Ce type de métathèse est fréquent.
(GIPPM-2:407 : "Les tendances notées § 441 font de
toute l'Aquitaine un pays d'élection pour les métatèses de
Schéma général :
Exemples :
baccla > blacca
bafrar > brafar
gaulois bistlos "bile" > bescle "rate" > prov. actuel blesque, blesquin (FEW)
buccula > buccla > bloca, bloquier (bouclier)
cambra > cramba "chambre" (dans une quinzaine de départements du sud-ouest de la France)
cancrem > cranc
capra > craba (gascon, languedocien, béarnais)
castrare > crestar
comprare > crompar
cŏnflāre > coflar / clofar,
gonflar / glonfar "gonfler"
cŏntrā > (gascon) cronta
cooperire > crobir, cobrir, curbir ; cooperculum > crubecel
corbem : gorbin > grobin (dauphinois : TDF)
fēmĭnăm > *femra
> frema
fimbria > latin *frimbia > frẹmja "frange"
Gabrĭēl (DFL, hébraïque) > Grabieu
paupĕrĕm / paupĕrŭm > paupre > paubre > praube "pauvre" (sud-ouest) (paupĕr)
(rĕ)cŭpĕrārĕ : cobrar, crobar (ǫ), crubar
tabir ou tabur ou tubul > AO trempe "tambour"
tĕmpĕrārĕ > temprar > trempar
"tremper"
tigra > AO triga
"tigresse"
tufera > trufa (trufar > it. truffare (Treccani))
Schéma général :
Exemples :
berbīcĕ(m) (< vervīcĕm) > fr "brebis" (voir verbice > berbice)
burliera > bruliera (voir burliera)
corpatas > cropatas
(claustrum > claustra, crausta : ?)
fĭrmārĕ > fermar, fremar
formātĭcŭm (caseum) > fromatge "fromage"
pulvis > pọlvera, pọrba, prọba
thyrsus > torç, troç
tŭrbare > (AO) torbar,
trobar "troubler"
tŭrbŭlare > (AO) troblar,
treblar, trebolar "troubler"
Processus phonétique
Le processus phonétique est signalé :
(ÉDAF:455) "Les propriétés perceptuelles et articulatoires de la rhotique interagissent pour la rendre susceptible à des métathèses (par exemple formage > fromage ; berbis > brebis, surtout dans les syllabes non accentuées [...]".
brittisca (bretèche, échaffaudage) > bertresca
carta > cartra
tarta > tartra (AO)
*termitem > tèrtre
Voir apocope après muta cum liquida ?
Le s impur est le s
initial suivi d'
Diachronie
Une syllabe ne peut normalement pas commencer par deux consonnes à part
les cas de muta cum liquida : crassus,
blandus. C'est un phénomène universel. Le groupe s
+ consonne demande un effort articulatoire ; il est plus facile à
prononcer avec e ou i
devant.
Dans toutes les langues du monde, la structure d'une syllabe est
normalement la suivante :
L'échelle de sonorité ci-dessus
montre que les groupes sco- (schŏla), spi-
(spīna), scri-
(scrĭbĕre)... enfreignent le
Dans la
schŏlă
> ĭschŏlă [iskola] > escòla [éskòla] (occitan) > école
(français)
Dans la
schŏla(m) > escola "école"
scrĭbĕre > escribere "écrire"
spīna(m) > espina "épine"
squāma(m) > escama, escauma
"écaille"
stātu(m) > estatu "état"
etc.
Les mots français comme "scorpion", "squelette", "statue", sont des emprunts au latin, avec abandon de formes populaires comme estatües (forme du début XIIe siècle).
Je traite ici essentiellement de la vague d'épenthèses qui a concerné une période de l'Antiquité. Il faut y joindre la notion d'analogie sur groupes consonantiques (ci-dessous).
(IPHAF:111) À la fin du IIe siècle et
au début du IIIe siècle, une grande vague de
- Exception 1 : dans le cas cr + voyelle post-tonique, il n'y a pas encore de syncope à cette époque : lacrima "larme" (IPHAF:111).
- Exception 2 : en occitan, de très nombreux
mots, parfois des variantes dialectales, n'ont pas subi cette syncope.
C'est ainsi qu'on trouve tremola
"(il) tremble" (< trĕmŭlăt),
pibol "peuplier" (< pōpŭlŭm), cese
"pois chiche" (AO ceze, cezer
< cicerem), nàisser
"naître" (< nāscĕrĕ,
le français a connu la syncope > "naître"), Antíbol
(< Antĭpŏlĕm)
alors qu'on a Grenòble (< Grātĭānŏpŏlĕm)...
Ces mots non syncopés sont considérés comme ayant subi une influence
savante.
Ces
On constate que les groupes consonantiques inhabituels ont été changés par l'insertion d'une consonne supplémentaire entre les deux consonnes originelles : ml > mbl, mr > mbr...
F. de La Chaussée fournit des explications phonétiques mécaniques, automatiques, pour l'apparition de telle ou telle consonne épenthique (IPHAF:140-141) (je les donne ci-dessous pour chaque cas concerné). Il considère que l'épenthèse est "une conséquence du renforcement articulatoire" (IPHAF:140) ; cette notion de renforcement articulatoire n'est pas claire chez l'auteur.
Il me semble qu'on doit compléter le raisonnement de F. de la Chaussée
par la notion d'analogie sur groupes
triconsonantiques :
● La combinaison nl
devrait, comme il le signale lui-même, mener à ndl
si une cause cause purement mécanique était intervenue. Mais en français
on a eu nl >
ngl ; ainsi spīnŭlăm > "épingle" doit être expliqué
plutôt par une analogie,
par exemple sur cĭngŭlam > a.fr. cengle
"sangle" (IPHAF:140). D'ailleurs cette épenthèse nl
> ngl n'est pas attestée en AO, où comme aboutissement de spīnŭlăm
on ne connaît que espila, espinla,
espinola. On connaît aussi espanla
"épaule", amenla "amande", ce
qui prouve que le groupe consonantique nl
était accepté en AO. Le latin classique aurait mené à ll
: ĭnl- > ill- (illūmĭnārĕ...)
; le même phénomène a dû se produire pour spīnŭlăm
> espila : *inl > *ill
> il. En occitan comme en français, les mots en
● On doit poursuivre ce raisonnement pour expliquer sl > scl. La syncope des mots latins assŭlăm et i(n)sŭlăm a mené à oc ascla, iscla. En prononçant énergiquement la combinaison sl, on pourrait produire une combinaison s'apparentant à stl. Mais la combinaison retenue dans l'occitan a été scl, sans doute par analogie sur les schémas familiers du latin ou du grec : asclēpĭăs, dĭsclūdĕrĕ, masc(ŭ)lŭs, mĭsc(ŭ)lārĕ, *rasĭcŭlārĕ > *rasclārĕ...
Des phénomènes du même type se sont produits dans des contextes un peu différents (voir ci-dessous tableau d'exemples) :
- épenthèses
lors des
sl.pr. *slovēninŭ > *sclavone > esclau "esclave"
a.b.fr. *slaitan > esclatar "éclater"
...
- l'altération analogique stl > scl :
- lors des
gaulois *bistlos "bile" > AO bescle "rate"
- lors des
ăristŭlăm
> arescle "éclisse",
ūstŭlārĕ > usclar
"brûler" (voir bruslar, brûler...)
Ainsi les consonnes épenthiques ont pu apparaître par un mécanisme
phonétique automatique, mais aussi (et parfois seulement) pour assimiler
à la langue latine des groupes consonantiques inhabituels. Ici
l'épenthèse (sl > scl) et la
substitution de consonnes (stl >
scl) ont agi pour assimiler sl
et stl aux schémas habituels
du latin. Donc des analogies
se sont exercées à partir de mots déjà existants, des "mots modèles". Ces mots modèles sont écrits en
mauve dans les tableaux ci-dessous. On
peut parler d'analogie sur groupes triconsonantiques.
● Dans le schéma ci-dessous, je montre que selon moi, les notions
d'épenthèse et d'analogie sur groupes triconsonantiques se recouvrent en
grande partie, mais pas complètement.
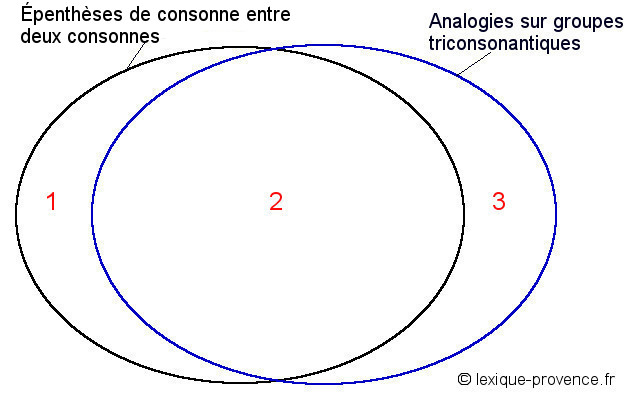
Schéma ci-dessus : création de groupes
triconsonantiques avec influence des épenthèses et influence des
analogies sur groupes triconsonantiques (voir par exemple sl / stl > scl). Pour
expliquer certains groupes triconantiques, les deux notions se
recouvrent largement (2), mais
certaines épenthèses sont peut-être purement phonétiques (1),
et certaines analogies sur groupes consonantiques ne sont pas des
épenthèses (3) : ūstŭlārĕ > *ūstlārĕ
> usclar "brûler". (Je parle des épenthèses de consonnes
entre deux autres consonnes).
Voir le contexte ci-dessus.
Avant la fin du IVe siècle (IPHAF:140), au moment du "renforcement
articulatoire" (?), pour prononcer ml,
mr, nl, nr, "le dernier segment de la nasale s'est dénasalisé,
laissant en place l'
(Voir aussi GIPPM-2:229).
Je propose aussi le rôle de mots
modèles (en mauve ci-dessous) ayant facilité les épenthèses par
analogie (explications
ci-dessus).
Tableau. Épenthèse entre m et l. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.
(1) Pour assemblar et semblar, la racine est différente : respectivement sĭmŭl et sĭmĭlĭs, voir CNRTL "assembler". Pourtant, DFL réunit assimulare et assimilare dans le même article : à mieux étudier. En remontant le temps, sĭmŭl et sĭmĭlĭs proviennent de la même racine, voir sĭmŭl / sĭmĭlĭs dans les apophonies.
(2) Pour Chambly, Chambley, voir m-ly.
(3) Pour flambar,
(4) Pour hŭmĭlĕ(m),
les mots courants, oc umble, fr. "humble" sont
(5) DENLF:721b donne villa
"domaine rural" de Mummulus,
nom de personne germanique. Voir aussi TGF2:994. Les sites internet propagent "villa
Mummole, vers l'an 800", dont je ne trouve pas la source.
Tableau. Épenthèse entre m et r. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.
(1) L'évolution cammărŭs > cambărŭs est déjà attestée en latin tardif, probablement par l'influence de camba "jambe" (FEW 2:144a) ; voir l'italien gambero "crevette". Le mot n'entre donc pas dans les épenthèses causées par la syncope, mais a pu au contraire renforcer l'influence analogique de ŭmbra.
(2) L'évolution ămĕrīnă > *amera est postulée par les
représentants fr.pr.
de type ambra, par des attestations dialectales normandes du XVIe
siècle (ambre), peut-être par les toponymes Ambrières / Ambriers
(53, 72),
et par une glose du IXe siècle (amera genus salicis) (FEW 24:433-434). Le sud-est de la France a le
type amarina.
(3) cambrar est peut-être un
|
latin
LPC
|
|
occitan (et français)
|
| cĭng(ŭ)lăm, ŭng(ŭ)lăm, ang(ŭ)lŭm, strangŭlārĕ... | cengla, ongla, angle, estranglar... | |
| n |
> | |
| spīnŭlă(m) |
espingla ( |
|
|
|
|
|
Tableau. Épenthèse entre n et l. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.
(GIPPM-2:229-230, ALF:210 "cendre" < cĭnĕrĕm, ALF:1359 "vendredi" < diēm Vĕnĕris)
D'après GIPPM-2:229-230, le traitement général est n
- "à Menton et Fontan, au Val-Saint-Martin, à Bobbio et Villar-Pellice, en Queiras" ;
- "à Aurillac" (15) ;
- "en
Voici quelques précisions :
- Pour la première zone, on est proche de l'Italie, où l'évolution se fait sans syncope : cĭnĕrĕm > piém sëner (piemunteis.it, GDPI:1036b), gén çénie (DGI:209b), it cenere.
- Pour la seconde zone, je n'ai que trouvé que très peu de précisions (. ERMC.)
certaines vallées des Alpes jusqu'à Menton : Fon06 , Men06, en Queyras (05) et dans le Piémont italien (mais en Queyras, ;
Le Val Saint-Martin, à Bobi [sãré], Maïsette [sãró], au Villar ;
Exemples : cĭnĕrĕm "cendre" :
- Fon06,
Men06 cènre
(GIPPM-2:230), Fon06 [s
à Bobi [sãré], Maïsette [sãró])
Également en AO, on a nr et ndr (il faudrait étudier si on peut connaître la provenance géographique des attestations).
L'évolution n
|
latin
LPC
|
|
occitan (et français)
|
| ANDR
: andro- (ἀνδρός) ÉNDR : fĭnd(ĕ)rĕ, prēnd(ĕ)rĕ ÈNDR : dēscĕnd(ĕ)rĕ, pĕnd(ĕ)rĕ, (ĭn)tĕnd(ĕ)rĕ, vĕnd(ĕ)rĕ ÒNDR : respŏnd(ĕ)rĕ ÓNDR : *abscŭnd(ĕ)rĕ (3) |
— fendre, prendre deissèndre, pèndre, tèndre, vèndre respòndre escondre |
|
| n |
> | ndr (rarement nr ↑) |
| cĭnĕrĕ(m) |
cendre "cendre" | |
| gĕnĕrĕ(m) |
gèndre (gènre) |
|
| a.fr.
graindre "plus grand" (1) |
||
| hŏnŏrārĕ |
AO ondrar... "honorer" | |
| a.fr. juindre, joindre "plus jeune" (2) | ||
| mĭnŏr |
mendre "moindre" | |
| pōnĕre |
pondre "pondre" | |
| AO
som |
||
| tĕnĕrŭm |
tèndre "tendre" | |
| tendrai "tiendrai" | ||
| Vĕnĕrandŭ(m) |
Vendran (n.d.f.) (Venerand) |
|
| Vĕnĕrĭānĭcīs |
*Vendrargas > Vendargas "Vendargues" (34) | |
| diēm Vĕnĕris
; Portŭm Vĕnĕris |
divèndre "vendredi" ; Pòrtvendres "Port Vendre" |
|
| *veniraio |
vendrai "viendrai" | |
Tableau. Épenthèse entre n et r. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.
(1) Pour grandĭŏr > *grannĭŏr > graindre, le d épenthique apparaît (PHF-p:163), et par ailleurs un i diphtongal apparaît : *grañdr > graindre. Y. Ch. Morin critique le fait que d dans graindre soit épenthique (SADP:160, note 57).
(2) Pour jūnĭŏr > juindre, joindre, même remarque que ci-dessus concernant le d épenthique et le i diphtongal. Pour la variante joindre, voir jūnĭŏr (abrègement de longues toniques de proparoxytons).
(3) Pour *sŭbmŏnērĕ > *sŭbmŏnĕrĕ (réarrangements
en proparoxytons), il y a évolution "régulière" vers
un ŏ > o fermé. Par contre pour *abscŏnd(ĕ)rĕ,
il faut peut-être supposer un *abscŭnd(ĕ)rĕ > escondre (et non
(GIPPM-2:229 cite essĕrĕ, consuĕrĕ, lazărŭm).
Voir le contexte ci-dessus.
Selon IPHAF:140, avant la fin du IVe siècle
au moment du "renforcement articulatoire" (?), pour prononcer ssr,
zr, (j.m.c.g.)
"l'élévation énergique de l'
Je propose aussi le rôle de mots modèles (en mauve ci-dessous) ayant facilité les épenthèses par analogie (explications ci-dessus).
Il faut remarquer qu'en occitan, pour la combinaison s-r,
la tendance est à éviter la
|
latin
|
|
occitan, français
|
| s |
str (surtout domaine d'oîl) |
|
| astrŭm,
castrŭm, fĕnestrăm,
măgĭstrŭm... |
astre,
fenèstra, maistre... |
|
| -scĕrĕ > *-i̯ (crēscĕrĕ...) |
d, a, a.fr.
creistre
"croître" (1) crèisser "croître" |
|
| n. antĕcĕssŏr > *antcess'r |
ancèstre
"ancêtre" (2) |
|
| essĕrĕ |
èstre "être" èsser "être" |
|
| tĕxĕrĕ |
> > |
a.fr. tistre
"tisser" tèisser "tisser" |
| z |
zdr > dr (surtout domaine d'oïl) |
|
| consuĕrĕ > *cosĕrĕ |
a.fr. cosdre,
fr coudre cóser "coudre" |
|
| lazărŭ(m) |
lazdre > ladre
"ladre" Làzer "Lazare" |
|
| sīcĕrăm
> sīsĕrăm
> *sizra |
a.fr. sizre,
fr cidre |
Tableau. Épenthèse entre s
/ z et r (en rouge).
En occitan, la voie par
(1) Pour les verbes en -scĕrĕ,
voir verbes
en -scĕrĕ (deuxièmes
palatalisations).
(2) Pour antĕcessŏr,
c'est le CS qui est resté dans la langue, en occitan comme
en français. Le CR ances
Voir le contexte ci-dessus.
Pour s'l > scl, on ne peut trouver aucune explication phonétique "automatique" (voir ci-dessus altération par analogie sur groupe triconsonantique).
Il est possible que l'évolution s
- scl conservé (iscla) > nord-occitan icl, cl (eiclatar, eclatar)
- (amuïssement de la consonne centrale comme dans a.fr. masle) sl (isla) > nord-occitan l (ila).
Cependant les variantes de type isla
(inla, irla), ila peuvent provenir simplement de *īsŭlăm.
Voir la variante isola
avec basculement
d'accent (mais pour isola,
y a-t-il eu influence savante ?).
|
latin
|
|
occitan
|
| asclēpĭăs (Ἀσκληπιός), cīsc(ŭ)lārĕ, masc(ŭ)lŭs, mĭsc(ŭ)lārĕ, *rās(ĭ)c(ŭ)lārĕ... |
gisclar,
mascle, mesclar, rasclar... |
|
| épenthèses |
||
| s |
> |
scl |
| assŭlă(m) |
ascla "éclat de bois ;
fêlure..." |
|
| insŭlăm > *īsŭlă(m) | iscla "île" |
|
| sl |
> |
scl |
| a.b.fr. *slag | esclau "trace, vestige..." |
|
| a.b.fr. *slaitan | esclatar "éclater" |
|
| m.ne. *slimb | esclemba "écharde" |
|
| sl.pr. *slovēninŭ > *sclavone (1) | esclau "esclave" (1) |
|
| altérations analogiques (ci-dessus altérations, voir aussi évolution de tl après consonne) |
||
| st |
> |
scl |
| *ărĭstŭlăm |
arescle, ariscle "éclisse" |
|
| ūstŭlārĕ |
usclar (bruslar...) "brûler" |
|
| stl |
> |
scl |
| gaul. *bistlos | AO
b |
|
|
|
|
|
Tableau. Épenthèse dans le groupe sl issu de syncope (lettre épenthique en rouge). En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.
(1) Pour sl.pr. *slovēninŭ "slave" > *sclavone : ce dernier a été pris
pour un accusatif (voir CNRTL
"esclave") d'où *sclavo > *sclavum
ou *sclavem. "Le changement de sens "slave" > "esclave"
s'explique par le grand nombre de Slaves réduits en esclavage dans les
Balkans par les Germains et les Byzantins pendant le haut Moyen Âge" (CNRTL "esclave"). Pour
"esclave", le mot latin était servŭs.
Avant la fin du IVe siècle selon IPHAF (p. 140), au moment du renforcement
articulatoire, pour prononcer -lr-,
"l'application des bords de la langue s'est faite trop rapidement avant
que la pointe (en contact
stable pour l) ne se fût
libérée afin d'exécuter le premier battement de r
- d'où l'occlusion totale sur le pourtour de la voûte et apparition d'un
d entre les sonores l
et r."
Cependant en occitan, peut-être à cause de l'absence de -ldr-
en latin (à prouver), cette épenthèse de d
semble limitée. En effet, en AO, on a m
Mais tŏllĕrĕ > t
Il faut que j'étudie le groupe de absŏlvĕrĕ
> "absoudre", dont apparemment aucun équivalent en AO ne présente de d
(absolver, absolre, absolbre...).
Voir composés en
|
latin
LPC
|
|
occitan
|
| l |
> |
ldr |
| ălĭd
+ rĕm > *alrem |
AO aldre "quelque chose d'autre" | |
| cŏrŭlŭ(m)
>
*cŏlŭrŭ(m) |
AO c |
|
| dŏlērĕ > *dŏlĕrĕ | AO d |
|
| ŏlērĕ > *ŏlĕrĕ | AO |
|
| tŏllĕrĕ |
AO t |
|
| vŏlērĕ hăbĕō > *vol(ē)raiō (fut.pér.) | vodrai "voudrai" |
|
| lv |
> |
ldr |
| pŭlvĕrĕ(m) |
AO poldra,
p |
|
| sŏlvĕrĕ |
a.fr. soldre ("absoudre", "dissoudre"...), mais AO solver (1) |
Tableau. Épenthèse entre l
et r. Il est probable
que l'absence du groupe -ldr-
en latin ne permette pas une large diffusion de cette épenthèse.
(1) Pour sŏlvĕrĕ, voir l'origine
sē + lăvō.
Le verbe latin dŏmĭtāre
"dompter" a subi la
En AO les formes suivantes sont attestées : domdar, domtar, dondar, domptar, dompdar. Les deux dernières montrent donc aussi une épenthèse de p. Cependant oc. comte, fr. "comte" < cŏmĭtĕm, "fiente" < fĕmĭtăm, a.fr. "friente" (bruit) < frĕmĭtŭm, fr. "sente" < sēmĭtăm n'ont pas cette épenthèse.
L'apparition du p est sans doute en partie liée à l'influence analogique de temptāre > tentar, compŭtāre > comptar.
En latin, il a existé une épenthèse du même type dans *em-tos > emptus "achat", *sum-tos > sumptus "dépense", également en anglais dans empty < œmettig (voir CNRTL "dompter").
Pour le grec ancien, l'évolution lamedh > lambda (nom de la lettre grecque λ), avec b épenthique, est semblable.
Pour les
Cette partie est construite notamment à partir des études de LDR, de DGmmnn, ainsi que de réflexions personnelles.
Selon Georges Millardet (LDR:290), le contact de m
et n à l'intérieur d'un mot
amène à des résultats différents en fonction des forces qui l'ont
emporté : la force conservatrice, la force assimilatrice, la force
différenciatrice.
Dans les différentes parties de l'Empire Romain, mn
primaire a un destin souvent différent de mn
Le groupe
1. Origine
indo-européenne :
2. Syncope ancienne :
(ce n'est que le début d'une longue
série de syncopes m'n, voir
ci-dessous mn
secondaire)
-mĭn- :
cŏlŭmĭnă > cŏlŭmnă "colonne"
dŏmĭnŭs "maître", dŏmĭnă
"maîtresse de maison" sont dans le même cas : on prononçait dŏmnŭs / dŏmnă
bien qu'on continuait à écrire les formes non syncopées en latin
classique, voir syncopes
attestées à l'époque républicaine.
3. Anciens
groupes bn et pn :
Voir la
loi "
-bn- :
pr-i-e.
pr-i-e.
-pn-
:
pr-i-e.
4. Emprunts
au grec (amnesia, gymnasium,
rhamnus...), eux-mêmes d'origine variable en grec. Apparemment
sans descendance vraiment populaire.
Les constatations ci-dessous permettent de supposer que dès
l'Antiquité, des tendances s'opposaient en fonction des régions de
l'Empire Romain. On remarque notamment une opposition entre l'Espagne et
le nord de la Gaule. La région intermédiaire (Catalogne et domaine
occitan) montre des traits plutôt hispaniques (mn
> nn), mais aussi des traits originaux (amn
> aun).
Par la voie populaire, mn
s'est souvent conservé en
(exemples de LDR:290)
- en roumain dans le groupe omn : somn "sommeil" ;
- en dalmate dans les groupes omn et amn : somnŭs > samno, damnŭs > damno.
L'assimilation progressive mn > mm semble être assez caractéristique de la Gaule du nord :
cŏlŭmnăm > dial.oïl coulomme "colonne", forme vraiment populaire avec coulombe (A. Thomas in DGmmnn:74) ;
damnŭs > "dam" ; "dommage"
dŏmnăm > dame ; *dŏmnĭcĕllăm > "damoiselle", "demoiselle" ; *dŏmnĭcĕllŭm, > "damoiseau" (voir dŏmĭnŭs > dŏmnŭs ci-dessus) ;
scamnŭm > a.fr. eschame "escabeau", dial.oïl chame "escabeau ; chaise" (FEW 11:278a) ;
sŏmnŭm >
"somme" (action de dormir) ; sŏmnĭcŭlŭm
> "sommeil"
En latin, l'assimilation progressive est notée par
columnam et consules exempta n littera legimus
"nous lisons columnam et consules sans prononcer la lettre n".
Selon DGmmnn:81, dans ce cas columnam devait se prononcer avec m
Pour consules, voir ns > s.
n quoque plenior in primis sonat, et in ultimis partibus syllabarum, ut nomen, stamen ; exilior in mediis, ut amnis, damnum
"Également n est prononcé pleinement en début et en fin de syllabe comme dans nomen, stamen ; plus faiblement dans à l'intérieur comme dans amnis, damnum.
L'assimilation régressive mn > nn semble être très marquée dans la péninsule ibérique. On la rencontre aussi dans d'autres domaines.
● En occitan : cŏlŭmnăm
> AO
colonna (et colomna)
● En français : cŏlŭmnăm > "colonne" (voir ci-dessous le modèle cŏlŭmnăm).
En français dialectal, on doit aussi noter : dŏmĭnam > danne : par exemple : Dannemarie-sur-Crête (25) < Domna Maria en 1110 , Dennemarie en 1268. Aussi : Dannemarie (78), Donnemarie (52, 77). (Voir dŏmĭnŭs > dŏmnŭs ci-dessus).
● Notamment dans la péninsule ibérique, on constate un traitement identique pour nn et pour mn latins :
annŭs > esp año,
cat any
/añ/ "an" :
damnŭs > esp daño , cat dany /dañ/ "dommage" ;
dŏmnă > esp dueña "maîtresse de maison",
esp doña
"dame noble" (voir dŏmĭnŭs
> dŏmnŭs ci-dessus) ;
scamnŭm > esp escaño "siège" ;
somnŭm > esp sueño "sommeil ; songe"
On peut penser qu'il y a eu une assimilation régressive (mn > nn) (LDR:291).
Celle-ci semble annoncée par les inscriptions latines d'Espagne (LDR:291).
Voici des exemples :
(in NVER:46)
danno (damnum) "dommage" (CLE 1339, 19) ;
alonnus (alumnus) "nourrisson ; élève" (CIL iii. 2240) (ŭ > ó) ;
interanniensis (interamniensis) "d'entre les eaux"(CIL ii. 509, 510, 511) (Interamnium Flavium dans le nord de l'Espagne).
En graphie médiévale, le
Que penser du p dans mpn
? S'agissait-il d'un réel p
prononcé ? Ou d'un p
signifiant simplement qu'il faut prononcer le m
Selon Georges Millardet, ce p était vraiment prononcé, et il résulterait d'un phénomène phonétique de différenciation se réalisant pour contrer l'assimilation (LDR:291-293).
(LDR:291-292) "Mais, dès la fin de l'époque latine, l'assimilation de mn en mm ou en nn est sentie comme un danger pour l'intégrité du système articulatoire de la langue. C'est alors que, par réaction contre la tendance assimilatrice, se fait jour une tendance différenciatrice. Sur des inscriptions tardives et dans les manuscrits de la basse époque [n.d.l.r "bas latin" : du IIIe au VIe siècle] apparaissent dampnum, sollempnis, calumpnia, dampnare, etc. Ce traitement s'est maintenu partiellement en vieux provençal, dampnatge, dompna, en vieux français dampnos, dampnosement et même en vieil espagnol dampnado, dambnado (Staaf, Sa., 245).
Ces formes ne sont pas de pures graphies,
comme on l'a prétendu à tort ; car les faits romans sont parallèles aux
faits scandinaves par exemple dont le caractère phonétique semble assuré
: vieux suédois nampn < namn
"nom" et d'autres cas semblables. D'autre part on ne peut soutenir que
prov. dampnatge soit une pure
survivance graphique du bas latin dampnum,
puisqu'on a en provençal ancien non seulement dompna
-, qui, à la rigueur, peut s'expliquer par le bas latin, puisque pour ce
mot la syncope domna est
ancienne, - mais encore fempna <
feminam, où le p ne
peut avoir aucune base dans une tradition latine quelconque."
Selon Manuel Alvar (DDJ:218-220), outre G. Millardet ci-dessus, les auteurs Menéndez Pidal et Ynduráin soutiennent que p a une valeur phonétique.
Au contraire Manuel Alvar estime que p dans mpn n'a qu'une valeur graphique, destinée à maintenir à la lecture la distinction entre m et n. L'auteur note les formes costunpne, fenpnas, dompno dans les documents en ancien aragonnais de Jaca. Il cite aussi d'autres sources de la péninsule ibérique avec nompnadas, sempnar, acostumpnado, danpnificado, sollenpnidat...
(DDJ:220) (trad.esp.) " La graphie
Pour cŏlŭmnă "colonne", DGmmnn propose le schéma d'évolution ci-dessous
(au moins pour la Gaule).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mn (cŏlŭmnă) |
> (ass.r.) | nn (colonne) |
> (diff.) | nd (colonde) |
> (infl.a.)
(1) |
ndr (colondre) |
|
|
>
|
(voir AO garenda)
|
|
|
||
| > (ass.p.) | mm (colomme) |
> (diff.) | mb (colombe voir "colombage") |
|||
|
> (épen.?)
|
&mpn
(AO
colompna) |
&
|
&
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Évolution du groupe consonantique
primaire mn
(d'après DGmmnn:62, adapté et développé).
(1) Pour expliquer "colondre", FEW 2:935a penche pour un croisement kylindros (→ *kolendro) x cŏlŭmnă.
Les mots masculins et neutres en -mnŭm aboutissent à l'absence
Pour somnŭm :
somnŭm > *sommŭm > "somme" (action de dormir), occitan sòm.
damnŭm > dan, dam, daun "dommage"
autumnum > autom
Remarque : voir l'alternance semblable ci-dessous : scamnŭm / scamnĭŭm.
Pour somnĭŭm "songe", je propose de reconstituer les voies suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sōmnĭŭm |
> (ass.r.) | *sōnnĭŭm |
> (diff.) | *sōndium |
> (1es
pal.) |
AO sọnge |
| > (1es
pal.) |
AO sọmnhe | |||||
| > (v.sav.) | AO sọmi, sọmni "songe" | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| sŏmnĭŭm |
> (1es pal.) |
*sŏmñŭm
|
> (ass.r.) | *sòññu |
> (d.cond.) | AO suenh "soin" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposition d'évolution de somnĭŭm.
- sōmnĭŭm > *sŏmñŭm > *sòññu > suenh "soin" (occitan, voir diphtongaison conditionnée par ñ) ;
- sōmnĭŭm
> AO sọmnhe
"songe", a.fr. soingne [soñe] ou [só̃ñe] "songe" ;
- sōmnĭŭm > (voie savante) AO sọmi, sọmni "songe"
- sōmnĭŭm
> *sōndium > (AO) songe.
Je rajoute :
*dŏmĭnĭārĭŭm > *dŏmnĭārĭŭm
> AO,
a.fr. dangier
"danger" (voir
Voir évolution
de m-n.
Louis Remacle constate : « Pour le groupe
secondaire
m
L'auteur cite quelques formes toponymiques en nd de Suisse romande, issues de dominus (-a) : vicedomina > vidonda in n.d.l. Vedondoz, Vidondoz, Pravidonda "pré de la vidamesse". Le cas est voisin de nn > nd ci-dessous. Il cite aussi AO dombredeu, dambredeu "seigneur Dieu", à rattacher au type espagnol hembra "femme", qu'il exclut de son étude.
L. Remacle ne donne pas de déduction de la quasi-absence des groupes
différenciés en mb, nd pour le
groupe secondaire m
(LDR:293 !)
Cette évolution semble marginale dans le domaine occitan, mais elle existe :
Le n peut facilement devenir r au contact d'une consonne.
Feminam > *femna > *femra > frema "femme"
Dominum Deum > AO dombredeu, dambredeu "seigneur Dieu"
G. Millardet (LDR:231) donne damnŭm
> (différenciation)
g daun
/da
Jules Ronjat (GIPPM-2:213-214) signale bien : mn
> un, mais il ne distingue par
Par exemple : scamnŭm
> AO escaun
"banc, escabeau, étagère"), *scamnĭŭm
> AO escanh
"idem". Cette évolution est connue en roumain, istroroumain et
anglo-normand (NTOP-2:5). Scamnum
> ro scaun
"chaise" (REW:576). (Pour -mnŭm
/ -mnĭŭm, voir aussi ci-dessus somnŭm / somnĭŭm).
Aussi :
amnĭs "cours d'eau" (descendants connus seulement dans les noms de lieu, FEW 24:462a) : ĭntĕr + amnēs "entre les eaux" > n.d.l. Entraunes "Entraunes" (06), Antrain (35), Entrammes (53), Antran (86).
À cette évolution, je pense qu'il faut rattacher ann > aun dans manna > mauna "manne", sanguinăt > *sangna > *sanna > sauna "(il) saigne".
Aussi : Sanctŭm Annemŭndŭm
> Sanctum Aunemundum
(années 976, 1173) > Sanch Amont
(Saint-Chamont, 42)
Aussi dans mn
Voir aussi le développement intéressant sur l'accent de l'Anjou (et de Normandie, Bretagne ?) à la toponymie du Mans, Wikipédia où est cité Jacques Peletier du Mans au XVIe siècle : "iz prononcet l'a devant n un peu bien grossement é quasi comme s'il i avoèt aun par diftongue ; quand iz diset Normaund, Aungers, le Mauns, graund chose". On pourrait proposer ann > aun pour au moins deux mots : Ceromannos (bien attesté avec nn) > Le Mauns (pour "Le Mans"), Nortmannos > normauns pour "normands". Peut-être Andecavis > *Anngavi > Aungers pour "Angers".
Selon Peter Wunderli à propos de amn > aun, "une explication homogène et tenant compte aussi de l'extension géographique manque cependant jusqu'à date actuelle" (NTOP-2:5).
Max Wheeler propose (SAHC:16 pour cat llauna "fer-blanc" < lat lamina) une dissimilation de nasalité avec une évolution m > b > u ("dissimilation of nasality /m/ ... /n/ > /b/ ... /n/, with subsequent lenition of /b/ to /v/ (> [w])").
Quelques mots latins ont perdu une voyelle atone, menant à un groupe nm : ănĭmăm > *ănmă "âme", ănĭmālĕm > *ănmālĕ "animal", ănĭmālĭă(m) / *ănmālĭă "les bêtes à cornes (sens collectif)", mĭnĭmŭm > *mĭnmŭ "le plus petit", mĭnĭmārĕ > mĭnmārĕ "diminuer" (FEW, 6/2:113-114).
Schéma général : n
(GIPPM-2:215) "n
(FEW, 24:592b "animal") "Dans animal comme
dans animalia, le traitement galloroman presque unanime du
groupe
ănĭmă(m) "âme" > AO anma, arma "âme" ; g amna (dans l'aire de hemna < feminam) ; arma est conservé seulement dans l'exclamation pér per mon arma !, et dans le pronom indéfini auv narma < una arma "on". Partout ailleurs on a le francisme ama. (GIPPM-2:215-216).
Le n peut
facilement devenir r
devant une consonne (ci-dessus).
Les dégéminations,
ou simplifications des
Pour le domaine d'oïl, la
simplification des géminées est datée du VIIe siècle (IPHAF:93).
Remarque pour l'italien :
l'italien ne connaît pas les dégéminations ; les consonnes géminées à
l'écrit sont géminées à l'oral : seppellire,
stella, vacca, davvero, fatto, rosso, gabbia...
Dans un premier temps, la
gémination protège les consonnes doubles intervocaliques des sonorisations
(vers l'an 400) : les sons /p, t, k, s, f/ sont maintenus. Les sons /b,
d, g, y, l, m, n, r/ sont également maintenus. Tous ces sons étaient
Dans un deuxième temps, vers le VIIe siècle, les dégéminations se réalisent : les sons ci-dessus se prononcent de façon plus brève.
Lorsque l'occitan apparaît à l'écrit
(Xe-XIe siècles), les descendants populaires des
mots latins comportant des
ăddūcĕrĕ > AO aduire,
adurre, aduzer
"amener"
ăffĭrmārĕ >
AO
afermar "attacher, renforcer"
bŭccă(m)
> AO b
...
Remarque : les préfixés
latins en ăd- montrent
très généralement une assimilation de d
par la consonne suivante ; donc ils fournissent de nombreux exemples de
mots avec consonnes
abbātĕm > AO abat "abbé"
ăd + brĕvĭārĕ > abbrĕvĭārĕ
> AO abreujar
"abréger"
*blaccă(m) > blaca "taillis"
bŭccă(m)
> AO b
vaccă(m) > AO vaca "vache"
Voir aussi les palatalisations cce, cci :
baccĭllŭm > bacèu
baccīnŭm > bacin
Voir aussi les palatalisations cc + ĭ, ĕ + voyelle.
ăddūcĕrĕ > AO aduire, adurre, aduzer (mais addusir : graphie latinisante d'une variante obtenue par voie savante) "amener"
ăd + fĭrmārĕ > ăffĭrmārĕ > AO afermar "attacher ; consolider"
ŏb + fĕrrĕ > offĕrrĕ > ofrir "offrir"
ăggrăvārĕ > AO agravar "alourdir ; aggraver"
Le groupe jj ne semble pas
avoir été écrit, mais il doit se confondre avec dj
ou j simple : voir réalisation
de yod.
(Les mots latins préfixés avec ăd montrent généralement une assimilation de d par la consonne suivante : voir préfixés avec ăd, donc on peut considérer que ădjŭngĕrĕ est équivalent à *ăjjŭngĕrĕ).
ădjŭngĕrĕ
> ajónher "réunir"
ădjūtārĕ > ajudar "aider"
(GIPPM-2:148-150)
avellānă(m) > avelana "noisette"
bĕllă(m) > bèla
bĕllŭ(m) > bèu
bŭllicāre > bolegar
bŭllīrĕ > bolir
căballăm > cavala "jument"
căballārĭŭ(m) > cavalier
gallīnă(m) > galina
stellă(m) > estèla "étoile"
Aboutissement lh en languedocien occidental
(GIPPM-2:149)
(e.d.a.r.o.) L'évolution ll > lh "se rencontre dans les parlers languedociens voisins du catalan ; il semble assez régulier à l'Ouest (hautes vallées de l'Aude et de l'Ariège, Sault, Donezan et Capcir), tandis qu'à l'Est (Fenouillet, Peirepertusès, Termenès, narbonnais Sud) il est limité à certains parlers et à certains mots."
căballăm
> cavalha "jument"
Voir aussi ci-dessous -llī, -nnī.
Pour esquilhar (dérivé de squilla ?), il est possible
d'invoquer *squillea.
Pour les groupes ll + ĭ, ĕ en hiatus (pĭllĕŭm > pelha "haillon") :
voir ll + ĭ, ĕ en hiatus.
Il s'agit de cas particuliers : voir ci-dessous nasales
géminées.
ăd + pārēscĕrĕ > ăppārēscĕrĕ >
AO
apar
ăd + quīrĕrĕ > ăcquīrĕrĕ
> AO aquerir, aqu
Il s'agit de cas particuliers : voir ci-dessous cas de rr et ss.
-attăm
> -ata (auvernhata)
ăd + tĕndĕrĕ > ăttĕndĕrĕ
> AO at
*auctorĭdĭărĕ (IPHAF:47) > *auttrediare > AO autrejar "octroyer"
battŭĭs > *battĭs > bates "tu bats" (voir battŭĕrĕ)
Brĭttānĭă(m) > Bretanha "Bretagne"
cattăm > cata "chatte"
*fŭttŭis > *fŭttis > fotes "tu fous" (voir *fŭttŭĕrĕ)
glŭttōnĕ(m) > AO gloton "glouton"
gŭttă(m) > AO gota "goutte"
mĭttĭs > metes "tu mets"
ădvenīrĕ > *ăvvenīrĕ
> AO avenir
"avenir"
ădventŭm
> *avventŭ > AO
avent
"avent"
ădventūrăm > *avventūră > AO aventura "aventure"
(obvium
> it. ovvio "évident")
Il y a bien eu dégémination, mais la prononciation est restée dure :
rr
/
ss
/ss
Pour le français :
CE:GP:566-567 "Le français ne connaît plus de géminées. [...] Font exception les digraphes tt, rr, ll, les deux premiers étant prononcés, selon certains grammairiens du 16e siècle, avec une plus grande intensité que la consonne simple, et le dernier pouvant représenter l'antériorisation de la latérale."
Quand on a écrit l'occitan aux Xe, XIe siècles
(après les dégéminations), il convenait de faire la distinction entre
les prononciations de r et s restées dures (/
- Le r
simple intervocalique n'avait pas subi de modification depuis le latin /
- Le s
simple intervocalique avait subi les sonorisations, donc il se
prononçait /z/, transcrit /z/ ou /s/ en AO, maintenant s.
Un moyen simple était de conserver à l'écrit la gémination, mais d'autres règles graphiques existaient en AO. D'où les écritures AO asegurar/assegurar, asemblar / assemblar, arestar/arrestar, areire/arreire/arier... Aujourd'hui, les normes occitanes (classique et mistralienne) transcrivent toujours ces sons durs en rr et ss ; le français ne distingue que ss et s.
rr
/
Voir les explications juste ci-dessus.
(GIPPM-2:148)
(e.d.a.) "-rr- > -r- dur, noté -rr- entre voyelles, -r en finale romane"
ăd + rĕstārĕ >
ăd + rĕtrō
>
fĕrrŭm > fèrre, fèrri "fer"
pŏrrŭm > pòrre, pòrri "poireau"
sĕrārĕ
>
sĕrrăm
> sèrra "scie ; crête dentée"
tĕrrăm
>
AO
t
verrūcăm > berruga, barruga "verrue"
a.b.fr.
Dans plusieurs régions occitanes, on
distingue
à la prononciation deux r
correspondant à r et rr
étymologiques.
ss
/ss
Voir les explications juste ci-dessus.
ăd + sēcūrārĕ > *ăssēcūrārĕ > assegurar "mettre en sécurité"
ăd + sĭmĭlārĕ > assĭmĭlārĕ > assemblar "rendre semblable"
bassă(m) > bassa "basse"
lassă(m) > lassa "lasse, fatiguée"
mĭssă(m) > messa "messe"
nassă(m)
> nassa "nasse"
passārĕ > passar "passer"
pressārĕ > pressar
"presser"
fĭssă(m)
> fr "fesse"
Voir aussi voyelle
+ ssĭ, ssĕ + voyelle (messĭōnĕm > meisson "moisson").
À étudier :
glŏssă(m)
> glosa "glose", voir buglossa(m)
> buglossa, buglosa.
(tabassar > tabasar : il s'agit du suffixe -assar)
Voir Hypercorrections de type Măssĭlĭă > Mănsĭlĭă.
Les géminations latines mm et nn sont étudiées notamment dans DGmmnn. Il y a souvent eu simplification (dégémination), mais parfois des différenciations ont eu lieu :
mm > m ou mb
nn > n ou nd
En général, mm > m :
mais parfois des différencations
ont eu lieu :
mm > m ou mb
ăd + mīrāri > ammīrāri
> AO amirar
"admirer"
ăd + mĭttĕrĕ
> ămmĭttĕrĕ >
AO
am
Exemples de différencations :
On a très peu d'exemples.
L'auteur Louis Remacle remet en cause l'étymologie de "flamber",
traditionnellement considéré comme un dérivé
de flammŭlă (ci-dessus),
au profit de flammāre (DGmmnn:120 et suivantes, 140 et suivantes...).
Donc : mm > mb.
nn > n / nn / nd
Voir aussi ci-dessus ann > aun.
La situation est complexe et mal élucidée.
Souvent on observe une dégémination simple :
pĭnnă(m),
(pennăm) > (AO) p
Mais en AO on trouve aussi la variante pennat "garni de plumes ; pourvu d'ailes" (DOM), sans qu'on sache s'il s'agit d'une graphie simplement latinisante, ou si le mot était réellement prononcé avec n géminé.
Pour cannă
"canne", le résultat est constant avec n
simple : (AO)
cana. Graphie classique : cana.
Pour cannăbĭs /
cannăpŭs "chanvre", le nn
intervocalique aboutit partout à n,
voir notamment canet [kanét] (parties de la
Haute-Garonne, de l'Ariège où l'on a annada,
voir ci-dessous). Aussi : [kãnét]
(Le Mas-d'Azil dans l'Ariège).
Pour "année" (< *annătăm voir CNRTL) : on ne trouve en AO que anada mais anal / annal "annuel" (DOM). Par ailleurs l'ALF (carte 0044) montre une partie du Sud-Ouest de la France où l'on prononce n géminé : [annado/a], [onnado/a] (Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lot, partie du Lot-et-Garonne, Cantal, Lozère, Ariège à Castillon). Certaines régions n'ont que an, anh (cat any), ou bien ongan, enguan [é̃gwã] < hōc annō. L'ALF ne donne jamais de prononciation nasalisée [ãn(n)ado/a], mais il faudrait étudier davantage cet aspect : les gens du sud-ouest disent souvent en français [ãn(n)é]. La graphie classique actuelle a choisi nn comme norme : annada, en raison de la prononciation géminée [nn] dans la zone géographique concernée (graphie mistralienne : TDF annado, anado). De même pour la famille de an : (DOGMO) annat "âgé", annal "annuel", annalament "annuellement", annals "annales", anniversari "anniversaire", annuari "annuaire", annuitat "annuité", perènne "pérenne"... Je ne sais pas si le n est prononcé géminé dans les régions concernées pour anniversari, annal (annual)... En catalan, on a : anual, anualment, aniversari, anuari, mais annals, perenne.
Pour les équivalents de "dîner" (< dĭsjējūnārĕ), les variantes AO sont dinar, dinnar, disnar, dirnar. L'ALF:385 "déjeuner, faire le repas de midi", donne des occurrences de [dinna] dans : Landes, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Hérault, et des occurrences majoritaires de [dinna] dans le sud du Lot, de nombreux territoires de Haute-Garonne, d'Ariège, ouest de l'Aveyron, Tarn, Aude. La notation [nn] est assez mystérieuse dans l'ALF, et on peut se demander dans quelle mesure la nasalisation n'a pas été notée, comme dans annada ci-dessus.
Pour le prénom "Anne" (< Hannah) : DOGMO Anna, TDF Ano, (l) Anno, cat Ana. Il faudrait avoir des données fiables sur la prononciation dans le Sud-Ouest.
Le DOGMO donne nn
pour des mots préfixés savants : annèxe,
annexion, connectar, connivéncia, connotacion...
Conclusion :
Il faudrait approfondir l'étude avec des données précises sur la prononciation. La conservation de nn à l'oral semble s'étendre à sept ou huit départements du Sud-Ouest, seulement pour quelques mots (au moins annada "année"). Lexique-provence respecte l'orthographe du DOGMO, qui a l'avantage de montrer une homogénéité pour la famille de "an, année".
En Provence, le n n'est jamais prononcé géminé, comme aucune autre consonne.
Remarque (mots composés) : Dans certains dialectes à l'ouest du
Rhône, le n prononcé géminé
existe aussi dans des mots composés, comme capnegre,
capnegra (avec assimilation de p
à n : [kannégré]
(nom de différentes espèces d'oiseaux à tête noire ; Orchis
ustulata, plante à cime foncée). (Voir TDF, DOGMO).
Remarque : on connaît aussi quelques cas inverses nd > nn (ci-dessus).
L'évolution nn > nd est une différencation
:
hĭnnīre > AO endir "hennir"
*hĭnnītŭlāre > *enditlare > endilhar "hennir" (DGmmnn:47-48).
Johannes
"Jean" > Joan
- dérivés en -nd- : P-d-D Jouandet, Jouandon, Jouhandeau, aussi béar Joandon /djwadʋ/... (avec probablement une influence analogique des dérivés de Durand : Durandeau, Durandet, Durandin) (voir DGmmnn:49).
pré-lat
*varennam
> "garenne",
- variantes en -nd- : (m.fr. 1528) garande "retraite d'un cerf", AO garenda "garenne de chasse", noms de hameaux : Les Varandes (Savoie, Arvillard, corrigé en note en "Les Varandets"), etc., Jersey : guérande, guéranne, varines pl. "terres humides et mauvaises", etc. (DGmmnn:51).
capannam > "cabanne", chavana...
- variante en -nd-
: chavande (vosgien méridional
"bûcher de la Saint-Jean", et Bourgogne) (DGmmnn:56).
-llī, -nnī
Possibilité de -llī
> -lh, -nnī > -nh
Voir pluriels
masculins assymétriques (Réfection des déclinaisons).
(GIPPM-2:156 et suivantes)